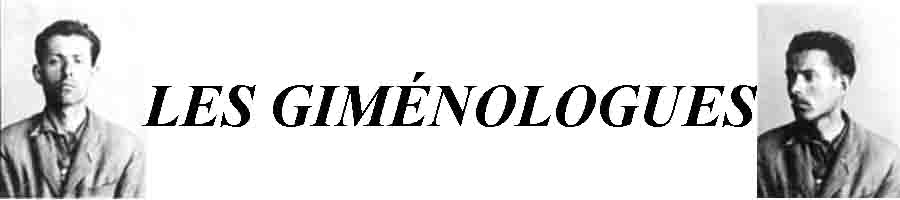Josep Llados Tarrago. Autobiographie. 8. Fin.
Fin du récit de Josep. A ce jour, il vit toujours à bergerac et sa santé est bonne.
Plâtrier
Nous étions une dizaine au bureau de la main-d’œuvre pour passer l’examen physique et technique. On nous fit écrire en français, moi qui commençais à peine à le parler, et on nous présenta un appareil en désordre qu’il fallait reconstituer. Bien entendu, vu mon savoir et mes capacités, ce fut plutôt un fiasco. Avant de repartir, M. Flamant me dit ceci : « Mon pauvre Llados, ce n’est pas jojo ! » Cela voulait tout dire. Et il ajouta : « On te convoquera ! » Et en effet, peut-être grâce au football et surtout grâce à cet homme, je pus entrer dans la section plâtrerie du Centre de Formation Professionnelle Accélérée de Roumagnières.
En attendant cette problématique convocation, j’étais retourné en forêt. Elle arriva deux jours avant le 11 novembre 1947. Je mis tout en règle, je dis au revoir à mes amis, j’embarquai ce que j’avais et je désertai Casteljaloux sans rien dire à mes amies femmes. Une autre vie commençait pour moi. Je logeais chez les Imbert, les aidant pour les travaux et entrai au centre le 12 novembre.
Pendant six mois, nous fîmes des exercices en terre puis en plâtre. Nous faisions aussi du dessin. J’avais un salaire minimum. Je retrouvai mon ami Sellares, lui à la section maçonnerie. Il couchait au centre et moi chez Imbert où je travaillais avant de partir le matin et le soir après la débauche. J’obtins le C.A.P. six mois après l’examen. En réalité on n’avait pas appris grand-chose pendant ce temps. Enfin, je cherchai à me faire embaucher et on m’indiqua chez M. René Lasserre. Il m’engagea et me mit à travailler avec un neveu de sa femme qui ne savait pas plus que moi du métier. Nous faisions des raccords à l’hôpital de Bergerac. Nous avions un grand échafaudage et le neveu eut un jour l’idée de le faire glisser au lieu de le démonter. Finalement, tout tomba en faisant un vacarme infernal sur le plancher. Les employés vinrent en courant voir ce qui s’était passé. Finalement, trois semaines après, je fus débauché et le neveu resta. Pas pour longtemps car ils le débauchèrent à son tour et M. Lasserre revint me chercher. Je fis de gros progrès dans le métier et je resterai 18 ans dans l’entreprise jusqu’à ce que je devienne artisan. Je travaillerai 19 ans en tant que tel. Tout ça me fait une carrière bien garnie, d’autant plus que j’avais 27 ans lorsqu’on m’admit au centre d’apprentissage. Cela faisait déjà 7 ans que je travaillais en France.[1]
Avant cette période d’ouvrier plâtrier et d’artisanat, j’en reviens à mon inoubliable Casteljaloux. En faisant des stères de bois, je changeai trois fois de patron, toujours pour celui qui payait le mieux. Le dernier monta dans cette ville la première équipe de football. Bien entendu, j’en fis partie. Je dis la première équipe car le rugby est toujours le roi dans cette région. On nous équipa et les dirigeants conclurent un match. Moi, j’avais raccroché depuis les Enfants de France de Bergerac, sans entraînement autre que de travailler très dur en forêt, ce qui n’était pas la même chose que courir derrière un ballon. La preuve en est que le soir du premier match j’eus une poussée de fièvre et toute la peau de mes lèvres se transforma en champignon. La peau sèche se taillada jusqu’à tomber. Mais cela ne fut pas un motif suffisant pour m’arrêter car le lundi matin : achat du nécessaire et direction la forêt comme d’habitude.[2]
Lors des examens de fin de stage, nous eûmes tous le C.A.P. et en fûmes bien contents. Les moniteurs ou artisans examinateurs étaient tous des gens de gauche reconnus et très proches de nous les Espagnols. À la section de plâtrerie, nous étions trois Espagnols : deux qui étaient revenus des camps d’extermination en Allemagne, et moi qui avais eu la chance de rester dans le Bergeracois. Notre moniteur, M. Guy Large, connaissait bien son travail de plâtrier. Mais il souffrit énormément pendant le stage car il n’avait pas le tempérament pour commander des hommes et encore moins des galapians de 18 à 32 ans. Les plus jeunes se mettaient à jouer et M. Large surveillait par la fenêtre pour voir si M. Abdelkader, le directeur, venait, il nous passait le mot et tous nous regagnions nos places.
Un jour, se fit un pari. Et il fut tenu par un dénommé Leyni. Pour un saucisson, il devait aller tout nu à la baraque d’à côté, section des peintres. Quelqu’un passa le mot aux peintres, et lorsque Leyni se présenta chez eux ils lui passèrent de la peinture sur tout « le bas ». Bien entendu, il gagna le pari et forcément, nous rigolions tous. Mais lui ne rigolait pas car la peinture lui cuisait. C’est pour celle-là et bien d’autres turbulences que M. Large souffrit tout au long du stage et qu’il ne le renouvela pas. Il retourna chez son ancien patron d’avant stage, et c’est là que nous nous retrouvâmes à travailler pendant des années dans la même maison.
Donc, je travaillais d’une façon régulière et j’avais le salaire de ma catégorie professionnelle. Je quittai les Imbert et pris une chambre en ville à l’hôtel du Périgord, dans la rue du même nom. Pas de chance, la chambre était habitée en plus de moi par des punaises. Je dormais mal, mais je restai quand même. Je n’étais pas hardi pour en trouver une autre. C’était en 1949, et le 14 juillet, fête nationale, il y avait un bal le soir place de la halle. Je vis une jeune fille en haut des marches. J’allai l’inviter à danser, et ce fut le commencement de la vie amoureuse avec celle qui deviendrait ma femme, Ginette Piogé. Nous nous fréquentâmes pas mal de temps, et elle m’avoua un jour qu’elle avait deux enfants, Christian et Jacqueline. Puis arriva ce qui devait arriver : elle tomba enceinte et je l’épousai. Le jour de mon mariage, je reconnus Jacqueline comme étant ma fille, et elle, aussi bien que ses enfants, me le rendent bien. Et comme ma philosophie est que le vrai père est celui qui donne le pain à l’enfant, alors je suis son père et elle est ma fille, comme les quatre autres que nous avons eus ensemble avec ma femme.
Je disais que j’avais été 18 ans chez un patron et 19 ans artisan. Je me suis lancé dans l’artisanat avec mes outils, ma bicyclette et une remorque de 60 cm de large pour 70 de long sur laquelle j’avais posé deux vieilles roues de vélo. Je l’avais commandée à un serrurier chez qui j’avais fait des réparations quand j’étais ouvrier. À un employé des chemins de fer, je fis faire six pieds droits en guise de paiement. J’avais dix ou douze planches que mon patron me prêta... et que je ne lui rendis jamais... cinq chevrons de 0.10 sur 3 mètres, et les outils fournis par M. Lasserre. Cette remorque nous servait aussi pour nous déplacer le dimanche lorsque nous allions chez Joan et Irène, autrement dit chez les Charles. On mettait quatre enfants dans la remorque, un sur une petite selle que j’avais fait mettre sur le tube de ma bicyclette, et un sur le porte-bébé du vélo de ma femme. Chez les Charles, il y en avait quatre et c’était la grande fête pour eux, et aussi les bêtises. Mes enfants et moi, on reparle souvent de ces après-midi chez Joan et Irène. Très souvent, ils nous gardaient à souper. Ils n’avaient pas grand-chose et n’étaient pas plus riches que nous. Une soupe et une omelette et c’était la joie pour tous. Tous les bienfaits de cette époque, je les ai rendus depuis, car depuis des années je les emmène là où ils ont besoin d’aller avec ma voiture. Et Joan est venu en Espagne de nombreuses années. Nous sommes toujours en très bonnes relations, et lorsque je vais les voir il faut que j’accepte d’emporter de la soupe et bien d’autres choses. Ce qui ne veut pas dire qu’ils me nourrissent en m’invitant à manger. J’apporte ce qu’il faut, ou ce qu’ils me disent d’apporter au préalable. Je les invite aussi chez moi. Pour faire à manger pour les autres, je ne suis pas trop qualifié mais je fais de mon mieux. Tout est prêt à l’heure. Ils mangent, disent que c’est bon et je suis content. On se quitte ou je les ramène chez eux, joyeux d’avoir passé une soirée ensemble, et à la prochaine.
Revenons sur le travail, chose très importante car à la maison il y avait ma femme Ginette et six enfants. Les besoins étaient alors très importants. Très souvent après ma journée chez mon patron, je débauchais et continuais à faire des petits travaux pour m’en sortir, jusqu’à dix ou onze heures, alors qu’il me manquait des bricoles pour moi. Des artisans demandaient si je ne pouvais pas les dépanner, et cela m’arrangeait moi aussi. Je n’attendais qu’une chose, que le dimanche arrive pour faire une journée plus complète que les autres. Je travaillais au mètre carré pour les artisans, par conséquent je gagnais plus que chez mon patron. Et pourtant j’étais bien payé. René Lasserre, ce patron qui m’avait pris à ma sortie du centre, m’avait permis de faire toutes mes gammes jusqu’à devenir un bon ouvrier travaillant pratiquement toujours en parfaite autonomie. Les principes appris du moniteur M. Guy Large furent retenus et me servirent pour tous les progrès réalisés pendant 18 ans, avant de devenir artisan. J’avais surtout la volonté de me prouver que j’étais capable de me commander tout seul, ma bonne santé et une solidité à toute épreuve. Je peux le dire maintenant que c’est du passé. Le travail ne me manqua jamais. Toutes les péripéties que j’étais obligé de faire pour transvaser l’échafaudage avec la petite remorque et pour remporter les gravats, je pourrais écrire jusqu’à demain et vous ne le croiriez pas. Imaginez simplement la remorque dans laquelle je transportais des chevrons d’échafaudage de 4 mètres de long à l’aide de ma vieille bicyclette sur le Vieux-Pont de Bergerac. Il n’y avait peut-être pas la même circulation que maintenant. Quelquefois, un maçon me le transportait quand il était intéressé à ce que je lui fasse le chantier.
Puis on fit quelques économies et on put acheter une voiture après que j’eus passé le permis de conduire. J’échouai cinq fois. À la sixième je bus un rhum avant de partir de la maison, chose inhabituelle pour moi, mais l’ingénieur des mines m’intimidait. Ce jour-là, j’obtins le permis. J’allais doucement au début puis comme d’autres je m’habituai à conduire. Les temps de la remorque derrière la bicyclette étaient bien révolus. C’était une Peugeot 504 de 117 000 km. Ce fut une bonne occasion car elle ne tomba jamais en panne tout le temps qu’on la garda. Nous allâmes avec elle en vacances en Espagne avec toute la famille. Elle servait au travail et au tourisme. Je la gardai cinq années puis on acheta une 505 couleur lie-de-vin de 95 000 km qui nous rendit vraiment les plus grands services. D’abord, je fis mettre une impériale solide et à chaque angle des fers montants de 0.20cm. Cela retenait mes planches lorsque je transportais l’échafaudage attaché par-dessus. C’était vite fait et solide. Puis j’achetai une remorque et fis installer un attelage. Ce qui faisait environ 10 mètres de long entre la voiture et la remorque. Et cela me permettait de charger le tout pour un autre chantier quand j’en avais fini un. Mais quand on devait aller quelque part, je la laissais à la maison et ma femme avait besoin de tout l’après-midi pour la nettoyer.
C’est comme ça que les voyages en Espagne/Catalogne continuèrent pour les vacances, ainsi que tous les déplacements pour le football féminin pour lequel nous fîmes les quatre coins de la France.[3] Elle non plus ne nous laissa jamais en rade. C’étaient de bonnes occasions.
Ma femme Ginette, vu les six fois que je me présentai pour passer mon permis, me dit un jour qu’elle ne monterait jamais en voiture avec moi. Cela était un minimum justifié, mais de toute évidence ce fut dit trop vite car elle n’avait pas d’autre solution. Elle fit beaucoup de kilomètres à mes côtés. Elle finit pas se détendre et même, chose rarissime, par s’assoupir. Il n’y avait qu’en montagne qu’elle se voyait toujours trop près du bord, elle était toujours moite. On était tout de même très contents de pouvoir partir où nous voulions quand nous voulions.
RETRAITE
Mais tout a une fin. Finis les déplacements du football. Puis la santé de Ginette se détériora. Elle nous quitta le 23 février 1983. Les chantiers continuèrent même si je pleurais en travaillant. Puis vint ma retraite que je pris à 65 ans et 3 mois. Je continuai trois mois de plus pour écouler mes chantiers entamés, ce qui fit 65 ans et 6 mois. Un jour, tout en travaillant, me vint l’idée d’aller voir mon client et cardiologue, M. Andrivet. Ce n’était pas parce que j’avais mal quelque part, non. C’était tout simplement pour savoir dans quel état se trouvait mon corps pour affronter la retraite. Je pris rendez-vous à la polyclinique et le docteur Andrivet fut tout étonné de me voir en consultation, lui qui m’avait vu travailler et savait combien je travaillais dur. Je lui expliquai mon idée et il m’examina. Tout allait bien mais il trouva ma tension un peu forte. Il m’ordonna un cachet et me dit de revenir dans trois mois. Je repartis un peu surpris quand même car je n’avais jamais été malade. Je n’avais jamais pensé que je pouvais en effet avoir quelque chose. C’est lors d’une de ces visites trimestrielles qu’il me demanda un jour si j’urinais bien, et vous connaissez la suite.
Suivirent plusieurs opérations en l’espace de treize ans. À vrai dire, elles ne me mirent jamais complètement à plat, un peu diminué surtout pour la deuxième intervention sur la prostate. Puis la première plaie de l’aisselle droite qui mit six mois à guérir complètement. Les autres se passèrent beaucoup mieux.
Mais ne croyez surtout pas que j’étais cloué à la maison, non. Quand arrivait le mois de juillet, avec mon ami Charles, vu que nous sommes du même village, nous commencions à planifier notre départ pour Alcarràs en Catalogne espagnole. On en parlait et on partait tous les deux car ma femme était décédée et la sienne ne voulait pas venir. Mais avant le départ, je me rendais au cimetière dire au revoir à ma femme : « Je m’en vais sans toi... » Nous achetions des cadeaux pour nos familles de là-bas et nous prenions la route le 27 ou 28 août à cause de la foire qui commence le 29.
Mais les choses changent, mon ami Joan arrive à 80 ans et sa santé a plus ou moins diminué. Et soit l’un de ses fils nous emmenait, ou bien sans le dire il commençait à avoir peur de venir avec moi. Le fait est que depuis 1996, nous ne sommes plus partis ensemble. Et maintenant que j’ai plus de 80 ans, je préfère qu’il en soit ainsi. Je pars tout seul comme un grand, mais je suis très conscient que mes moyens diminuent et que tout peut arriver sur la route, comme à tout le monde.
Ces voyages aller et retour en toute liberté et à notre façon, on commençait à en parler un mois avant le jour du départ. Puis on en reparlait souvent pendant ce mois-là. Je faisais réviser la voiture et je faisais le plein, la valise, médicaments et casse-croûte la veille du départ. On disait ensuite au revoir et en route. À Roumagnières, on commençait à s’inquiéter d’acheter le pain et dès qu’on voyait une boulangerie, on s’arrêtait. Vers 9h10, on s’arrêtait sur une aire de repos et on ouvrait nos sacs : œufs durs, jambon des deux couleurs, pâté, tomates, fromage, vin et café. On sortait nos couteaux soit de la poche, soit de la boîte à gants et on mangeait en regardant passer les autres voitures en se disant : « Aujourd’hui, c’est nous qui partons en vacances ! » Nous mangions chacun de ce que l’autre avait apporté. Joan me disait : « Tu ne veux pas de ça ? » et je lui répondais : « Tiens, goûte cela ! Tu veux une tomate ? » Et si l’on ouvrait une bouteille, on en buvait un peu. Et on ne mangeait pas beaucoup, j’ai toujours eu pour habitude de manger peu en voiture. Puis on prenait notre café et on pliait le tout. On repartait après avoir fait pipi une deuxième fois, et vers 14 heures on s’arrêtait de nouveau. Mais entre le déjeuner et le repas de midi, on faisait d’autres haltes car nos prostates faibles nous obligeaient à cela.
Au deuxième repas on étalait tout sur les valises et sacs de voyage et c’était le même scénario. Mais en mangeant on faisait le calcul et on se disait par exemple : « Il reste 180 km, on y sera environ à 18h30. » On finissait de se restaurer légèrement, pipi et en route. On arrivait à peu près à l’heure prévue chez la sœur de Joan, on s’embrassait, on buvait un Orangina frais, on parlait une demi-heure après avoir déchargé ses bagages, puis je finissais d’arriver chez ma sœur. Après y avoir embrassé tout le monde pendant un long moment, je partais chez ma belle-sœur. De nouvelles embrassades et nous restions huit jours dans nos familles. Pour le retour, je repassais prendre Joan où je l’avais laissé et on chargeait ses affaires. Avec au moins cinq arrêts pour manger et tout le reste et prendre un café quelques fois, au retour nous ne mangions pas que des œufs durs et du fromage. Le menu avait changé vu qu’il comprenait du pain, du vin, du boudin noir et du blanc fameux, de la saucisse, tous des produits de notre village alors forcément supérieurs. Le chauvinisme ça existe. L’odeur des fruits, pêches et pommes nous accompagnait. En arrivant à Bergerac, je les distribuais en commençant par en donner à la famille de Joan, puis à mes filles et à certains voisins. Ces fruits, c’était ma famille qui me les avait donnés. Et à l’année prochaine. Très content d’avoir vu une grande partie de ma famille : ma sœur, ses fils et belles-filles, ses petits-fils, ma belle-sœur et son fils, belle-fille et petits-fils, cousins et cousines, les personnes connues de mon village et les vieux murs de mon adolescence.
Les jours en famille se passent à aller à pied voir ceux qui habitent le village. Comme cela j’admire la partie ancienne et les immeubles nouveaux qui sont très nombreux, et je risque de trouver quelque vieille connaissance. Ainsi je mets une heure pour arriver chez ma sœur pour manger. Et comme il fait très chaud au mois d’août, je reste à parler avec elle l’après-midi après avoir fait la sieste. On parle un peu de tout ce qui se passe au village, et lorsque 21 heures arrivent, je pars chez ma belle-sœur chez qui je dîne et dors. À plus de 80 ans, à son retour du champ et de ramasser des pêches, elle fait cuire les légumes et le reste et on soupe avec Albert. Quand je suis à Alcarràs, il me fait la joie de descendre de l’étage du dessus dîner avec sa padrine (grand-mère) et moi. Puis, comme il fait encore chaud, Francisquette (ma belle-sœur ; moi je l’appelle la Camille parce qu’elle sort de chez lo Camillo) et nous, nous nous asseyons au balcon et nous parlons en voyant passer les gens. Lorsque nous sommes fatigués, nous partons au lit car il est déjà une heure du matin. Le lendemain, lorsque je me lève, elle est déjà partie avec son fils pour le ramassage des fruits. Je fais ma toilette, je m’habille puis je trouve mon déjeuner que ma belle-sœur a préparé sur la table, sauf si je lui dis la veille que je ne déjeunerai pas le lendemain. C’est ainsi que se passent les journées lors de mon séjour dans mon cher village d’Alcarràs. Pendant la foire, je vais quelques soirs voir un spectacle, par exemple écouter chanter des habaneras. Ce sont des chansons qui datent des années où l’Espagne était encore en possession de l’Amérique Latine. Elles font référence à La Havane, capitale de Cuba.
Une fois déjeuné - ou pas - je quitte la maison et la première visite est pour ma tante Miette qui est affectueuse comme une mère. Je lui apporte ce que j’ai prévu pour elle et je reste un bon moment. Elle est pleine de joie de me voir mais, comme elle est très sourde, le dialogue est difficile. Elle est tellement gentille que tout se passe bien et on finit par se comprendre. Le deuxième jour, je rends visite à mon copain de guerre qui s’appelle Agostín Salo Carrerre avec qui j’ai passé de mauvais jours pendant la guerre d’Espagne. Et presque tous les jours j’en vois d’autres. Par exemple ma cousine María del Gallo, les familles del Chep, del Mateu et del Treso, et un fils de la tía Matilde. Il faut souvent que j’y retourne manger et parler avec eux. Les jours se passent toujours ainsi puis s’amorce le retour que j’ai décrit plus haut, la voiture pleine de fruits et déjeuners sur la route. Tout un poème.
Marie Ginette
À ce niveau de ma vie, je m’étais proposé de ne pas parler de ma femme qui est disparue il y a quelques années, victime d’une grave maladie qu’elle nous a cachée tant qu’elle a pu. Quand le docteur l’a découverte, c’était beaucoup trop tard. Il n’y avait plus rien à faire, et le 3 février 1983, elle a cessé de vivre. Je garde mes souvenirs dans lesquels je plonge souvent. Et chaque fois que je rêve d’elle, ça me fait beaucoup souffrir et je me demande « pourquoi ? ». Je n’aurai jamais la réponse. Les docteurs de Bergerac ne savaient plus quoi lui faire ou lui dire et la firent entrer à Haut-Lévêque où elle resta quelques jours. Le premier soir lorsque je la quittai je la vis derrière la vitre de sa chambre et je me mis à pleurer en silence dans l’allée qui me ramenait à ma voiture. Puis ils l’envoyèrent à Bergougneux (hôpitaux bordelais). Là ils découvrirent le mal qu’elle avait et ils la soignèrent et elle revint après quelques jours à l’hôpital de Bergerac. Ils savaient que c’était une question de très peu de temps. Après trois semaines à l’hôpital, elle voulut revenir à la maison où elle était seule la plupart du temps. Elle avait toujours ses idées. Nos filles Marie-José et Marie-Thérèse - cette dernière était enceinte - passaient la voir tous les jours. Moi, je faisais tout ce que je pouvais. Je m’occupais d’elle, de mes chantiers et de l’entretien de l’immeuble. Je l’emmenais quand il le fallait en visite à l’hôpital. Ainsi se passèrent les trois semaines. Elle ne mangeait presque rien. Elle voulut aller à la clinique Bellegarde voir Mme Thérèse qui avait eu un garçon. Elle produisit un terrible effort car il fallait monter des marches. Ce fut la seule fois qu’elle le vit et il ne l’a jamais connue. Quelques jours après finissait son histoire.
Pour sa dernière nuit, comme elle était très faible, à bout de souffle, elle alla au lit vers huit heures. J’allais la voir très souvent. Je lui demandais si ça allait et elle me répondait oui et elle ajoutait : « Bien faire nonette. » De nouveaux mots qu’elle ne m’avait jamais dits. Lorsque j’eus fini la cuisine, j’allais me coucher à ses côtés. Parfois elle dormait car les médicaments quelle prenait l’assommaient. Je l’embrassai doucement et à mon tour, fatigué comme je l’étais, je m’endormis très vite. Vers une heure du matin, Philippe rentra de son travail et me demanda si ça allait. Je lui répondis oui. Il se coucha et je me rendormis. Je me réveillai à nouveau vers trois heures du matin et je pensai aussitôt « Et si elle était morte ? » J’allumai et je compris vite que sans rien me dire, sans une plainte ni aucun geste pour me réveiller, elle avait cessé de respirer. J’appelai Philippe et il l’embrassa ainsi que moi. Nous téléphonâmes à Marie-José, à Marie-Thérèse et à Jacqueline. Nous la lavâmes, la peignâmes. Elle était très belle encore. On lui mit sa plus belle robe. Tous ses enfants étaient présents à son dernier voyage.
Après sa disparition, je travaillai encore 30 mois très durs pour faire face à la situation. Quelques fois en travaillant sur les chantiers il m’arrivait de pleurer l’être cher disparu. On l’enterra au cimetière de La Beylive. Deux de mes filles habitent à Monbazillac et il m’était impossible de passer devant le cimetière sans aller sur sa tombe. À ce moment, je considérais comme une trahison de passer sans y entrer. Cela dura environ quatre mois. Puis un jour, mon cerveau ayant retrouvé la normalité, je vois ça comme ça, je me rappelai du cimetière alors que je l’avais déjà dépassé. Je compris que j’étais plus apaisé mais elle n’était pas oubliée pour autant. Toutes les semaines à peu près, je vais sur sa tombe avec des fleurs. Trente-deux ans de vie commune ne s’oublieront jamais. Je fis faire une plaque qui porte quelques vers qui me sont venus à l’esprit quelques secondes après avoir constaté son décès : « De toutes les fleurs du monde, je voudrais en faire une pour toi. Que tu voies sa beauté de ta tombe et que tu sentes son odorat. » Je la lis à chaque fois que j’y vais.
Mes enfants et mes gendres se comportèrent très bien avec moi pendant cette période difficile. Pendant quelque temps je mangeai chez eux à midi, surtout chez Marie-José, qui commençait sa carrière bancaire, et Marie-Thérèse. Les autres auraient fait pareil, mais Jacqueline habitait en Haute-Savoie. Et puis bientôt je pus régler ma nouvelle vie. Depuis, il y a eu un passage où Philippe qui travaillait comme serveur à « La Flambée » après avoir fait l’école hôtelière continua à vivre à la maison, puis Ramon en convalescence (parachutiste deux fois champion de France et deux fois vice-champion du monde de vol relatif), mais cela ne dura pas bien longtemps.
Je restai seul dans notre appartement et je règle ma vie à ma façon depuis lors, même si mes deux filles bergeracoises gardent un œil sur moi à mon grand plaisir. Du reste, un dimanche sur deux, je mange chez l’une ou chez l’autre à tour de rôle. Les relations avec mes enfants restent très affectueuses et je la leur rends en leur préparant de la confiture et du pâté !
Poèmes
À mon ami l’handicapé.
Mon ami l’handicapé
Était conscient de ce qu’il était
Donc il était triste
Se sentait malheureux.
Il regardait son entourage,
Tous les autres,
Les bien-portants s’amuser.
Il était à cette fête invité
Mais il était triste
Et ne cessait de penser
À son Aurore, ainsi elle s’appelait.
Il désirait faire comme les autres
Sauter, danser, quoi s’amuser
Mais son état le lui interdisait.
Timidement et furtivement
De temps à autre
Aurore il regardait
C’est lui qui était gêné.
Cette belle de ses pensées
Qui occupait ses nuits froides
Et ses nuits d’été
Le rendait triste
Ainsi que malheureux.
Avecelle, il aurait voulu
Fonder un foyer
Se marier, et le jour du mariage
Au besoin chanter pour elle
À cette occasion
Une très douce chanson.
Mais il ne lui avait jamais rien dit
Tout restait dans sa tête
Et dans son esprit.
Dans ses pensées des jours et des nuits
C’était la fiancée secrète de son cœur.
De l’avoir pas loin de lui le comblait de bonheur
Il refusait d’admettre qu’il était malheureux.
À la chanson qu’un copain chantait
Sans se rendre compte il l’accompagnait
Sa voix comblait celle de son ami.
Alors on lui demanda
Sur l’air des lampions
Floréal une chanson
Floréal une chanson.
Floréal chanta la chanson
Pleine de tendresse et d’émotion.
Tant qu’il chantait il pensait à sa Dulcinée
Tous les autres les avait oubliés.
Au refrain de la chanson d’amour inavoué
Tout le monde l’accompagnait
Il était très ému et très gai
Et aussi le plus malheureux.
La jeune fille encore il regarda
Elle ne s’en douta même pas.
Humblement il se leva
Fit un signe avec la main et le bras
Et il partit.
Il avait compris.
Et de comprendre
Que son regard
Sans son regard
Ce n’était pas la peine d’attendre.
Souriant et secrètement désespéré
Il eut encore une pensée
Douce, triste et mélancolique
Pour sa secrète fiancée
Celle qu’il n’oubliera jamais.
Ecrit sur un chantier, je ne sais plus lequel.
Le 30.01.1982
Pour tous ceux qui ont faim
Aujourd’hui, j’ai donné un pain
À une personne assise par terre
Tendant la main.
Il le prit avec joie
Différent de la première fois
Car il y a une première fois.
En croyant qu’il avait faim
Je lui ai offert un pain
Lequel il m’a refusé.
Il m’a dit :
« Je n’ai rien pour le manger »
Il aurait voulu aussi un pâté.
De m’avoir refusé le pain
J’ai été fortement surpris
Il a fallu que j’insiste
Finalement il l’a pris.
Je le quitte, content et contrarié
De ce petit geste de solidarité
Tout en me disant peut-être
Il n’en aurait pas fait autant.
Ils sont à genoux par terre
Visage sombre et désespéré
On dirait qu’ils sont en guerre
Ils le sont contre la société.
Souvent ils parlent entre eux
Avec à côté son litron
Ils n’ont aucune chance que je leur donne un rond.
Ces personnes, souvent, ont un chien
Témoin de leur détresse
Auquel ils font quelques caresses
Et mangent ensemble, c’est bien.
Si on m’avait donné un pain
Lorsque dans ma vie j’avais faim
À cette personne je lui aurais fait
Des chatouilles aux pieds
Afin de la faire rire
Et de la remercier.
Oh ! Détrompez-vous ! Je suis convaincu
Que ce que j’écris
C’est le néant.
Je vous le dis
Ça ne vaut rien
Mais en écrivant je m’entretiens
Je passe agréablement
Mon temps
Et au fond de moi
Je suis content.
Bergerac, le 11.11.2002.
[1] L’entreprise de M. Lasserre prit un jour de très gros travaux à Montpon : un très grand bâtiment pour le centre d’handicapés. Il fallut commencer le chantier en hiver et le sol était impraticable pour le transport des milliers de briques, du plâtre, du ciment et du carrelage. Ce bâtiment se trouvait en contrebas d’une route et mon patron eut l’idée de faire un pont reliant la route à l’appui d’une fenêtre de 1,60 m de large pour 2,30 m de haut. À l’embauche du lundi, il me mit au courant de son plan ainsi que le chauffeur du camion. Il nous dit : « Vous allez au chantier de Montpon faire un pont ! » Un pont ? me suis-je dit à moi-même tout en l’écoutant. Un pont ? Il continua à expliquer et nous chargeâmes le camion de madriers, de chevrons, de planches de toutes dimensions et de tous les outils nécessaires et nous voilà partis avec le patron. Arrivés sur place, nouvelles explications et déjeuner au restaurant où nous prendrions nos repas de midi. Nous étions à 40 km de Bergerac.
Il nous quitta après manger et nous laissa à pied d’œuvre. M. Lagarde, le chauffeur et moi commençâmes à échanger nos idées et à établir nos plans. Tout d’abord, la fenêtre n’était pas en face de la route mais un peu en biais, il fallait donc élargir le rayon d’accès. Si elle avait été face à la route, le pont aurait fait 8 mètres, mais là il en faisait 20, ce qui ne nous facilitait pas la tâche. Mais avec nos idées et nos plans, rien n’allait nous arrêter. Même pas de patauger dans la boue profonde et glissante.
Patron parti, camion déchargé, nous calculâmes combien il faudrait d’appuis pour une bonne solidité et durabilité. Nous optâmes pour des écarts de 2 mètres en suivant les irrégularités du sol. Avant de placer un madrier, nous l’éprouvions en le plaçant entre deux points et en sautant en son milieu. S’il ne cassait pas, il était bon pour le service. Ensuite on retirait la boue jusqu’au sol ferme avant de placer un bout de 60 cm en guise d’assise, et comme ça pour tous les madriers. D’aplomb et alignés deux par deux, la tête bien à niveau en haut, le tout bien entravé pour maintenir l’ensemble. Le plus difficile de l’ouvrage, et de loin, ce fut la boue. Enfin, nous avions une bonne assise et une bonne stabilité. Nous pûmes respirer. Je dois dire que le patron passait deux fois par semaine. Il regardait, faisait quelques suggestions, on lui commandait ce dont nous avions besoin et il repartait.
Ce fameux pont et ceux qui le construisirent furent victimes de moqueries. Par exemple, quelqu’un en passant nous lançait : « Est-ce que ça va tenir ? » D’autres : « Il est solide ? » Un troisième : « Ce n’est pas moi qui y passerai ! » Nous, on nous avait confié ce travail et nous avancions l’ouvrage en âme et conscience.
Plateforme de passage clouée avec des planches de 0,50 d’épaisseur, se présente un jour le conducteur de travaux. Le sol étant toujours abondamment boueux, il nous demanda avant de poser un pied : « C’est solide ? » Et le chauffeur et moi, sans rien répondre prîmes la tête et il suivit. Une fois de l’autre côté et à l’intérieur du bâtiment sans se salir les souliers, nous eûmes un petit commentaire de sa part. « Pas mal ! » La plateforme fut mise en service à la fin de la deuxième semaine et le patron commanda les rails et la wagonnette.
[2] Dans cette équipe, nous avions un garçon de couleur qui s’appelait Pinto, un déjà bon petit gardien, on s’entendait bien avec lui. Pour la Noël 1966, Pinto et moi fûmes sélectionnés par le district pour jouer contre l’équipe amateur des Girondins de Bordeaux. La deuxième équipe sélectionnée devait jouer contre l’équipe locale des Allemans-du-Dropt (une commune du Lot). Comme c’était le réveillon, je ne dormis pas de la nuit. Pinto joua avec la première et fut très déçu que l’on ne m’ait pas pris car j’étais son arrière gauche. Les sélectionneurs firent bien car je ne touchai pas un ballon, à ma grande honte même en deuxième. Ce gardien noir, Pinto, je le rencontrerai à Bergerac, lors d’un match amateur Bergerac/La Basidienne, à notre grande joie.
Je quittai l’équipe de Casteljaloux pour Captieux en Gironde dont les dirigeants me contactèrent. Ils venaient me chercher, ils me payaient le repas du midi et du soir, en plus de l’hôtel, et ils me ramenaient à Casteljaloux le lundi matin. Donc, la journée du dimanche ne me coûtait pas grand-chose à ce moment-là. Puis, comme je quittai cette ville incognito, tout fut arrêté en Lot-et-Garonne, en Gironde, et la forêt et les chéries. C’est là que commença ma nouvelle vie de plâtrier.
Arrivé à Bergerac, mes amis du foot d’avant avaient monté une nouvelle équipe. Elle s’appelait l’Équipe des Travailleurs. Je jouai dans cette équipe et nous fûmes champions du Bergeracois. Puis je partis par connaissance pour le football-club de Couze-Lalinde où il y avait de très bons éléments. Belle équipe. Je me fis une entorse au genou droit en début de saison. J’avais alors 31 ans et j’arrêtai le foot. Toutes les équipes où j’ai joué étaient fort sympathiques. À Couze-Lalinde, on venait nous chercher le dimanche matin les deux que nous étions, Carlos Buisau et moi. Nous mangions à midi chez M. Dumas, un gros charcutier. Le soir également et on nous ramenait à Bergerac. Je me trouvais très à l’aise dans cette équipe, mais la malencontreuse entorse fit jouer ma sagesse et j’arrêtai comme je l’ai dit.
[3] Marie-Thérèse, une de mes filles, sera même sélectionnée en équipe de France.