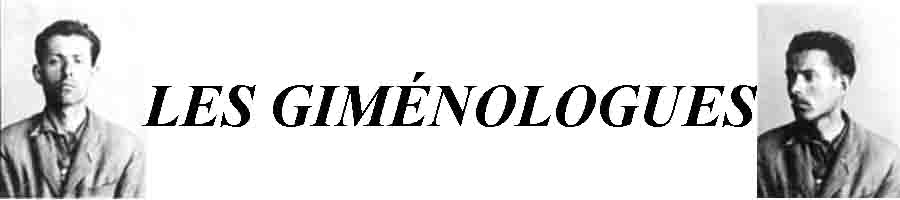De Saint Cyprien au Limousin.
Saint-Cyprien
Nous voilà de nouveau derrière des barbelés, et les gendarmes comme gardiens. Bien entendu, ça allait un peu mieux, mais avec cent cinquante francs en poche il ne fallait pas se faire de grosses illusions. À la cantine du camp, on allait pouvoir pendant quelque temps acheter le strict nécessaire. Mais ce vaste camp de bord de plage méditerranéenne, pour mon ami Charles et moi, c’était nouveau. Et il y avait déjà des camarades enfermés. Le lendemain de notre arrivée, avec Charles, nous nous mîmes à prospecter pour voir si on trouvait quelqu’un de notre village. Nous ne trouvâmes personne.
Dans ce camp de Saint-Cyprien et celui attenant de Barcarès, maintenant plages méditerranéennes bien renommées, il y a eu des Espagnols morts sur le sable : de misère, de dysenterie, de blessures anciennes et j’en passe. À la fin de 1939, il ne restait presque plus personne. Les uns partis à la Légion, d’autres aux Bataillons de Marche et d’autres aux Compagnies de Travailleurs, car on subissait une très grosse pression de la part de l’armée à travers les haut-parleurs du camp. Ils nous répétaient six ou sept fois par jour de nous engager dans les différentes armes de l’armée française où nous trouverions une vie libre, bien habillés et gagnant de l’argent. Tout cela qui sentait le front et la guerre ne me disait rien. Je pensais : « Avec de la chance, je suis sorti d’une ! » Moralement, je n’étais pas prêt à empoigner le fusil pour aller au front et en faire une autre.
Dès que l’autorité militaire a eu besoin de faire des fortifications au nord et à l’est, elle s’est dit : les Espagnols qui se trouvent dans les camps et qui mangent plus ou moins, en leur promettant meilleure vie, mieux à manger, mieux habillés bien entendu avec effets militaires et cinq francs par jour... Les militaires crurent que tout le monde allait courir se faire inscrire pour sortir aux Compagnies de Travailleurs Étrangers. Ce fut un fiasco. Presque personne n’alla se faire marquer. Mais l’armée avait besoin de cette main d’œuvre très capable, vu que le panorama politique international s’aggravait de jour en jour. Hitler et Mussolini devenaient très exigeants.
Devant la résistance des prisonniers - car on était traités comme des prisonniers -, un jour quelqu’un donna l’ordre à la Garde Mobile Montée d’entrer dans le camp n° 3 d’Agde dit des Catalans et de faire sortir tous les occupants de plusieurs baraquements. Ces gardes mobiles employèrent des moyens très durs et inhumains. Peut-être cela fut-il les premières CTE, car je ne savais pas ce qui se passait dans les autres camps qui étaient sources d’autres volontaires.
À Saint-Cyprien, comme le camp était vaste et que nous avions tout le temps, je m’occupais en me promenant. Et voilà que je retrouve ce voisin de village qui un jour, avec mon ami Gostinet del Pelletès, n’avait pas voulu nous reconnaître. Et l’on se retrouve encore, à Saint-Cyprien. Je m’en serais bien passé, car depuis le contact au front en Espagne, il avait fait dans nos bottes, comme on dit dans ce pays. Là, que son grade ne valait rien, il me reconnut. Nous parlâmes un peu et il m’annonça que dans une baraque se trouvait un autre garçon de notre village. Je le remerciai et nous partîmes, chacun suivant son chemin.
Ce dernier s’appelait lo Juanet del Camat et était très malade. Je me dis qu’il fallait que je le trouve et que je le voie, et le lendemain je me mis en marche pour le trouver. Je passai aux baraques qui étaient occupées et je demandai s’il n’y avait pas quelqu’un d’Alcarràs, mon village. Et à force d’aller d’une baraque à l’autre, je commençai à être fatigué lorsqu’on me répondit que oui, il y en avait un de très mal en point. On m’indiqua à peu près où il se trouvait et j’y allai. Nous nous reconnûmes tout de suite. Il fit de gros efforts et me dit qu’on ne le soignait pas. Comprenant sa peine et l’effort qu’il faisait pour parler, je lui dis de s’arrêter. J’essayai de l’encourager. Il n’avait jamais vu un médecin et je le crois, car on était abandonnés et oubliés de tout le monde. Je restai encore un moment avec lui, et comme ça faisait quand même un peu loin de ma propre baraque, je le quittai en lui promettant de revenir. Le lendemain, me voilà reparti pour le voir et je passe par la cantine du camp. Il me restait quelques sous. Et comme il ne pouvait pratiquement pas manger, je me suis dit qu’une boîte de lait concentré Mont-Blanc, il pourrait toujours la boire. Je lui achetai une boîte de lait et une plaque de chocolat, car je pensais que ce dernier fondrait dans sa bouche et qu’il pourrait l’avaler. Je lui dis que c’était le fameux commissaire de bataillon qui m’avait parlé de lui, mais il ne se rappelait pas l’avoir vu. Pourtant, à ce moment-là et depuis cinq ou six mois, les officiers et commissaires étaient payés par le JARE, pour les communistes, et le SERE, pour les socialistes (pour les autres : tintin !). Si on lui avait apporté quelque chose, il se le serait rappelé et me l’aurait dit. La mauvaise foi de ce commissaire se manifesta à nouveau, même devant un mourant du même village que nous. Cinquante-trois ans après, quelques détails m’échappent probablement.
Puis un jour, ses camarades et voisins m’annoncèrent à mon arrivée qu’une ambulance l’avait emporté à l’hôpital de Perpignan. Par hasard, il y avait un autre ami de mon village infirmier dans cet hôpital. Il le voyait souvent et il me dit qu’il décéda quelque temps après. Ce copain malade fut un sacré fumeur, rien ne lui faisait peur : la cigarette, la pipe et ce qu’on appelait les caliqueños. Ceux-là, c’étaient un vrai poison. Alors je suppose que cinquante-trois ans en arrière on ne parlait pas de cancer de la gorge mais de « mauvais mal », alors que maintenant c’est rentré dans les habitudes. Tout cela, je l’ai raconté à ses frères vingt-trois ans après, lorsque je suis revenu à mon village pour la première fois.
De toutes ces Compagnies forcées ou volontaires de Travailleurs Étrangers, beaucoup furent faits prisonniers par les Allemands qui ne voulurent jamais les considérer comme des soldats français. Ils ne profitèrent donc pas du statut de prisonniers de guerre et furent dirigés vers les camps de travail et d’extermination, spécialement Mauthausen où périrent huit mille réfugiés comme moi. Ils eurent la mauvaise chance de se trouver dans la zone d’opérations immédiates. Deux de mon village moururent là-bas : lo Fernando de San et lo Cassamiro de la Cañere. Je les ai vus dans cette liste qui paraissait toutes les semaines vers 1950 dans l’hebdomadaire de la CNT. Je fus certainement le premier à le faire savoir à leurs familles d’Alcarràs qui devaient les considérer décédés depuis longtemps. Je les ai regrettés car les connaissais tous les deux.
Nous qui avions passé la frontière française, une fois battus par les troupes fascistes de Franco, Hitler et Mussolini, nous étions des républicains de différentes philosophies et nous avions défendu indirectement la République française, vu que le guerre fut déclarée treize mois après. Bien entendu, on n’était pas trop contents d’être dans des camps en pays républicain. Il faut reconnaître qu’une masse de gens qui arrive comme une vague de l’océan déchaîné, il fallait la contrôler autant que possible. De là le parcage et toutes les misères que j’ai racontées. Nous étions foncièrement contre l’Allemagne, car elle avait envoyé de l’aide à Franco : cette fameuse Légion Condor, celle qui raya de la terre la jolie ville de Guernica. Les Allemands, de ce fait, savaient que ce n’était pas le grand amour avec nous. C’est à cause des privations et d’être enfermés dans les camps, mais aussi pour combattre ces pays fascistes, que beaucoup allèrent volontaires dans l’armée française et la Résistance. Donc, ce petit ressentiment que l’on avait à cause des camps fut oublié et les républicains français et espagnols firent bloc. D’après ce que j’ai pu lire, les camps où nous étions en France, c’était le paradis par rapport à ceux de l’Allemagne.
Les six derniers mois de 1939 furent très pénibles pour la France. Les Espagnols sortaient de ces barbelés, avec plus ou moins d’espoir, pour faire des fortifications et autres besognes. À mon camp de Saint-Cyprien, il restait encore quelques uns plus ou moins malades, des vieux, d’autres plus ou moins handicapés des séquelles de la Guerre d’Espagne, et nous les vendangeurs à qui peut-être la direction militaire du camp faisait une fleur pour avoir contribué à ramasser le raisin. Mais une rumeur prenait corps de façon persistante, selon laquelle il allait se former une Compagnie de Catalans pour aller travailler à Rennes dans une usine de chocolat. Et comme cela devenait de plus en plus évident qu’il fallait sortir dans une Compagnie, volontaire ou de force, nous nous mîmes d’accord avec mon ami Joan et nous allâmes nous inscrire. D’être entre Catalans nous encouragea car nous avions un peu plus d’affinités. On nous confirma que nous allions à Rennes, à la fameuse usine de chocolat. Pour Joan et moi, c’était inespéré. Une fois inscrits, ils nous dirent de nous tenir prêts. Je crois que le 27 décembre fut le jour de notre inscription. Nous revînmes à notre baraque et ramassâmes nos gueilles (nos effets pourris) et nous attendîmes deux jours jusqu’au 29 décembre. Une fois de plus, sac au dos avec 250 autres Catalans, on nous appela pour nous dire que notre Compagnie portait le numéro 248 des Compagnies de Travailleurs Étrangers. On nous ravitailla vers 15 heures : la moitié d’un pain militaire (à peu près un kilo), et une boîte de sardines à l’huile, et nous voilà en colonnes par trois sur l’esplanade du camp. Des camions de l’armée arrivent, on nous dit de monter et on nous transporte jusqu’à la gare de Rivesaltes. Nous descendons, et toujours en colonnes par trois on nous fait avancer sur le quai. Aucun civil ne prenait ce train-là, il était spécial pour la CTE. Un train de troisième classe, car il n’en existait pas de quatrième, mais on était quand même pleins d’illusions : on allait travailler dans une usine, et de chocolat en plus ! On nous ordonna de monter dans le train, toujours avec mon ami Joan-Carles, nous montâmes et prîmes possession de nos places : nous mettons nos affaires sur les étagères et commençons à reluquer du côté du pain et des sardines. Mais on a la volonté d’attendre, d’autres camarades les ont déjà bien entamés. Lorsque les responsables eurent réglé les formalités et l’itinéraire, trente minutes après, le train démarra et, comme nous avions l’espoir de retrouver une vie un peu plus normale, la joie nous détendait. Dans le train, comme dans tout groupe, certains ayant un naturel très humoristique donnèrent la note et il y eut des chansons jusqu’à en être fatigués. Nous entamâmes notre ravitaillement en en gardant pour plus tard, et nous eûmes là une très bonne idée car nous n’eûmes rien jusqu’au lendemain à 19 heures.
Ce convoi roula sur la ligne du sud allant de l’est à l’ouest de la France. Nous fûmes excités jusqu’à minuit : après la fatigue, l’émotion et le fait d’avoir mangé un peu, tout le monde ou presque s’endormit. En attendant, le train faisait son chemin. Je dormais tant bien que mal, c’est-à-dire comme l’on dort dans un train. Nous avions traversé certains départements, ville et villages sans les voir. En plus, depuis longtemps c’était la nuit. Je me réveillai dans le Gers, à la gare de L’Isle-Jourdain où le train s’arrêta longtemps. Pris de curiosité et dormant d’un œil, j’avais pu lire l’écriteau par la vitre. On ne pouvait pas descendre, c’était les ordres. L’autorité avait peur que certains se fassent la malle, comme l’on dit en argot. Dans un nombre pareil, il y en a de très décidés et avec de la suite dans les idées. Nous prîmes patience tout le temps qu’il fallut. Je pense que la direction que nous devions prendre était plutôt compliquée et qu’elle n’était peut-être pas libre. Nous n’étions pas encore au bout de notre destination. Nous ne la connaissions vraiment pas mais nous ne perdions rien pour attendre. Après une longue attente, le train se remit en marche. Nous empruntâmes certainement des voies secondaires et plus dégagées que ne l’étaient les grands axes comme la ligne de Bordeaux ou d’Agen, car aucun de mes collègues survivants ne se rappelle être passé par ces villes.
Le convoi faisait carrément route vers le nord sans rien savoir des voies empruntées. Je ne me rappelle plus le nom des villes traversées. Je peux seulement dire qu’à partir de L’Isle-Jourdain, en direction du nord, et après bien des arrêts qui ressemblaient à des hésitations, on nous fit descendre du train dans lequel il y avait déjà longtemps que nous avions marre de rester. Nous n’étions pas au bout de nos peines et de nos déceptions car la température était loin d’être celle de la côte méditerranéenne. Il faisait froid, très froid. Nous quittâmes le train pour l’air glacé qui arrivait du nord en passant sur la couche de neige, car tout était enneigé. Descendre du train et regretter le train, ça a été la même chose au même moment. Ce lieu, on aurait dit une vision du Pôle Nord ou de l’Antarctique : une toute petite gare en pleine campagne qui devait servir à l’occasion à certaines gens du pays. Je crois me rappeler qu’elle portait le nom de Le Vigeant, à environ 14 Km de Montmorillon et 8 Km d’Availles-Limouzine. Et comme un fait exprès, je crois qu’en France il y a deux L’Isle-Jourdain. Une dans le Gers et l’autre tout près du lieu où nous étions cantonnés, dans le département de la Vienne.
La Ferme de Fays
Rennes et l’usine de chocolat, c’était bien fini. La réalité de notre destin était un peu plus claire à nos yeux et à nos cerveaux. La différence de température était très grande et nous n’étions pas habillés ni chaussés en conséquence. Il y eut des petits drames, c’est-à-dire que nous eûmes chacun le nôtre. La rumeur courait que sur la côte il faisait plus dix et dans la Vienne moins dix. Le moral n’y était plus. Une fois sur le quai, je regardai de long en large et à perte de vue : il n’y avait que de la blancheur. Pas une maison, pas une ferme, rien. Vous pouvez imaginer que nous nous demandions où nous étions tombés. Triste souvenir. Enfin, des camions découverts de l’armée arrivèrent. Nous avions très froid mais ils essayaient de nous remonter le moral en nous disant qu’arrivés à destination nous aurions à manger. Nous avions aussi faim que froid. Nous montâmes. On était tous debout, pas moyen de s’asseoir, et ils démarrèrent. Sur ces camions, le froid était encore plus terrible. Cela dura environ 15 à 20 minutes. Enfin, les camions s’arrêtèrent et nous descendîmes au bout d’une allée. Il nous restait un kilomètre à faire avec nos sacs et nos musettes sur le dos. Là, nous étions complètement désemparés. Froid, faim, neige, entre 16 et 17 heures, ciel bas et sombre. C’est là, dans ce bout de chemin, que j’ai vu des hommes pleurer. J’imagine que c’étaient des larmes de colère et surtout de désespoir.
Nous avons rallié la ferme qui nous était destinée après avoir marché les quelques hectomètres qui nous séparaient de la descente de camions. Cette ferme se nommait Fays. Elle allait entrer dans notre histoire, vu que nous allions passer en ce lieu très froid de la France les plus mauvais mois allant de décembre 1939 à juin 1940. Je reviendrai sur ce sujet. Revenons à l’arrivée à la ferme de Fays. On ne voit plus de responsables. Rien n’était prêt pour nous installer. Chacun posa son paquetage où bon lui sembla. Dehors, il y avait une très grosse meule de paille, un gros pailler si vous préférez et on nous autorisa à en prendre. C’était de toute évidence une grande étendue de terres que l’armée avait réquisitionnées et où il y avait plusieurs fermes dont celle de Fays.
Chacun fit le ménage dans le petit coin choisi. Mon ami Jean et moi fîmes le tour de la ferme et nous choisîmes l’étable qui servait pour le cochon, chose très importante car nous avions les quatre murs. Cette étable faisait à peu près 1.80 mètre de large pour 2 mètres de long, et les murs si proches empêchaient les courants d’air. Comme c’était l’étable à cochon, il y avait de la merde sèche par terre, pas beaucoup, et nous nous mîmes en devoir de la nettoyer, de faire le ménage et de sortir les toiles d’araignées. Cela se voyait que la ferme était abandonnée depuis longtemps. Une fois propre, comme nous étions des paysans, cette situation nous a moins émotionnés que ceux résidant dans les grandes villes. La paille, ça on connaissait. Nous en mîmes une bonne épaisseur sur le sol, une couverture par-dessus et le restant de vieilles couvertures pour nous couvrir. Il y avait longtemps qu’il faisait nuit. Joan et moi, dans cette fin de journée du 30 décembre 1939, nous étions démoralisés comme les autres, mais pas abattus comme ceux qui avaient toujours habité les grandes villes. Nous qui sortions du village cent pour cent agricole d’Alcarràs étions revenus malgré tout un peu dans notre vie d’avant la guerre d’Espagne et de France. Alors les cochons, les étables, le fumier, les araignées et les toiles au plafond, on connaissait ça jusqu’au bout des doigts. J’en avais eus chez moi de ces cochons qu’on engraissait pour les tuer en hiver et qui nous servaient tout au long de l’année. Et j’avais nettoyé maintes et maintes fois leur étable. Nous n’eûmes aucune répugnance à remplacer le cochon, cela m’était plutôt familier. Et après tout, dans l’état où nous étions, physique, moral et d’hygiène, je me demande même si nous n’étions pas des cochons avec une autre forme que ceux qu’on avait élevés dans cette ferme autrefois.
En descendant du train, un bulo [une rumeur] avait dit qu’en arrivant à destination on nous donnerait quelque chose à manger. C’était très attendu par tout le monde et largement justifié. Le froid et la faim étaient en grande abondance. Fatigués par le train, les camions, le nettoyage, l’installation et le froid, quand on en a eu marre d’attendre qu’on nous dise « À la soupe ! », eh ! bien ! on se coucha. Joan-Carles, mon copain d’infortune et moi avions fait le lit ensemble afin de réunir ses guenilles et les miennes : couvertures, pantalons, vestes et tout ce que nous possédions était sur les couvertures, et nous tous les deux à poil enfouis dedans. Bien entendu, nous ne fîmes pas de prière. Le bon Dieu, il y avait des années qu’il nous avait abandonnés. Bien serrés l’un contre l’autre, nous fûmes vite chauds. Il restait encore quelques calories dans nos corps. Fatigués comme nous étions, nous nous endormîmes rapidement, Jean le dos contre mon ventre. Nous passâmes une très bonne nuit, comme il y avait bien longtemps que nous n’en avions pas eue. Attenant à notre logement que je viens de décrire, il y avait un emplacement qui servait à la truie et à ses petits. Une dizaine de nos camarades en avaient pris possession. Ils firent comme nous mais au ralenti. On voyait qu’ils peinaient pour nettoyer et pour arracher la paille du pailler. Ils finirent aussi par s’installer. Je crois franchement que nous avions fait le très bon choix.
En France, j’ai appris un proverbe que je ne connaissais pas en ce début d’année 1940 : « Qui dort dîne. » C’est ce qui nous arriva à tous. Le lendemain, car il y a toujours un lendemain, personne ne nous donna l’ordre de nous lever. On se disait : ils vont nous donner quelque chose à manger. Car si nous avions bien dormi, au réveil la réalité était tout autre. Comme il faisait jour depuis longtemps, nous prîmes ce qui nous servait de serviette et nous sortîmes, toujours tous les deux. Tout était d’une blancheur à nous impressionner vachement. Comme dans toutes les fermes de France et de Navarre, il y a un puits, nous arrosâmes le paysage avec nos yeux et nous n’eûmes aucun mal à découvrir le puits avec sa pompe. Comme il fallait se laver un minimum, avec la température qu’il faisait et le paysage qui nous entourait, on fit semblant de se laver la figure et on alla se raser à l’intérieur. Une fois cette tâche finie, on se dirigea vers le café et le bout de pain qui nous étaient réservés. On mangea le pain et but ce que l’on appelait le café, et à l’étable il faisait meilleur.
Mais comme la curiosité de connaître les environs me rongeait un peu, je décidai de sortir en attendant midi. On s’était aperçu que dans une autre ferme, à environ 200 mètres, il y avait une autre compagnie de pauvres malheureux comme nous. Ils étaient là depuis un mois déjà. Alors j’allai voir, histoire de savoir s’il n’y avait pas quelque connaissance. J’entrai dans cette ferme, et je m’aperçus qu’ils étaient un peu organisés car il y faisait meilleur que dans la nôtre. Je répondis aux questions courantes dans ces cas-là, par exemple : de quel camp nous venions, et d’où j’étais en Espagne. Je répondais, et tout en marchant je me retrouvai devant deux frères de mon village qui s’appelaient Tudo et dont l’un d’eux, Péré, fut président du comité qui sauva les prisonniers de l’église. À Alcarràs, ils étaient davantage connus sous le nom de « del Cabrer » parce que leur père avait une dizaine de chèvres et tous les matins parcourait les rues du village avec elles. Pour celui qui désirait du lait, il le tirait aux pieds de l’animal devant le client.
Nous fûmes contents de nous voir. Moi au moins, je fus très content et nous parlâmes un bon moment. Je leur fis savoir que Joan del Granot était avec moi. La famille de mon ami Jean était plus connue sous le nom de « del Granot », la grenouille, que sous son propre nom de Charles Artiges. Et c’était ainsi pour la plupart des familles qui composaient Alcarràs. Comme je le disais, j’étais très content de retrouver et de revoir ces amis de mon village, mais ils me laissèrent un petit goût de froideur. Je me rappelle qu’à Alcarràs, un surtout était passablement sérieux de son naturel. C’est vrai que dans les circonstances que nous vivions à ces moments-là, ce n’était pas souvent que nous avions le sourire aux lèvres. Après avoir parlé, je les quittai et continuai mon tour d’horizon de la ferme. Je m’aperçus que les cuisiniers étaient au travail, donc qu’il y avait de l’espoir pour midi et le soir, et le restant des jours passés à ce cantonnement. J’entrai dans la ferme où était logé le gros de la compagnie. J’eus l’impression que toutes les cloisons de séparation avaient été abattues. C’était une très grande salle, et les copains avaient pris place tout autour le long des murs. Paille au sol, musettes accrochées aux murs, les uns allaient d’un côté, les autres de l’autre. Chacun s’organisait à sa guise et le mieux possible.
Je revins à notre place, je retrouvai Jean et lui racontai ma retrouvaille des frères Tudo. Nous revînmes les voir tous les deux l’après-midi. Après avoir mangé et fait la sieste, ce dont nous avions encore bien besoin, nous parlâmes de choses et d’autres et nous retournâmes à notre ferme. J’en remportai encore ce sentiment de froideur et d’isolement. Pendant six mois, je les revis deux ou trois fois de plus, mais on ne se réunit plus jamais. Puis la débâcle de l’armée française arriva et je ne sus jamais ce qu’ils devinrent. Dommage que le père Tudo m’ait laissé cette impression d’isolement vis-à-vis des amis de son propre syndicat CNT. Il en avait été le premier président, puis président du comité qui remplaça la municipalité après le soulèvement fasciste des militaires, des riches et du clergé.
Le soir, nous eûmes la popote. De ce côté-là, ça se stabilisait. Naturellement, ceux qui étaient employés aux cuisines étaient enviés car, quoi qu’on en dise, c’est une garantie plus ou moins justifiée de pouvoir manger un peu plus et peut-être un peu mieux. Joan et moi, ainsi que les amis Tudo, ne faisions pas partie des cuisiniers.
Nous vîmes s’écouler ce dimanche paisiblement, les mains dans les poches. Il laissait présager la prise du travail pour le surlendemain, le mardi 2 janvier 1940 quand ils formèrent des sections de travailleurs. Comme à la sortie du camp ils nous avaient fait une sorte de fiche personnelle, ils savaient le métier que nous pratiquions en Espagne. Alors les sections furent formées suivant les fiches : maçons, charpentiers, chauffeurs, manœuvres. Joan et moi, nous fûmes affectés au groupe des manœuvres. La pelle et la pioche, on connaissait ça. Mais on ne travailla pratiquement jamais avec ces outils, car c’est dans cet immense chantier que la plupart d’entre nous vit travailler de gros tracteurs, des pelleteuses et des niveleuses et d’autres machines-outils qui faisaient notre admiration, au moins la mienne.
L’après-midi de ce 2 janvier, avec toujours une épaisseur de neige de 25 à 30 centimètres, ordre fut reçu de partir au chantier car cela pressait. Pour nous, c’était la panique, que dis-je : la terreur, car on ne nous avait rien fourni comme équipement, ni chaussures, ni habits. On était gelé avant de partir, mais tout le monde partit vu que c’était les ordres. L’aller-retour faisait plus ou moins 5 kilomètres à pied selon où l’on était affecté. Rendez-vous compte : de la neige, de l’eau et de la boue. Ceux qui étaient habitués aux rues de la ville souffraient le calvaire. Mon ami et moi, on connaissait toutes ces difficultés. On s’en sortait beaucoup mieux que certains autres dans ces chemins qui n’en étaient pas. C’est nous qui les avions créés dans les terres en les faisant le plus droit possible pour rejoindre chaque groupe son chantier.
Sur les lieux de travail, les pelleteuses sortaient la neige et la terre pour l’aplanissement, soit pour servir de route, soit pour y monter la voie de chemin de fer, ou pour servir d’accès à l’usine. Comme vous voyez, c’était la mise en route d’un grand chantier où l’on devait remonter les usines en provenance du nord et de l’est de la France devant la menace évidente de la guerre. Je doute beaucoup que ce plan de travail ait abouti, car nous abandonnâmes la ferme de Fays au moment de la débâcle. Et nous pouvons remercier le vieux capitaine dont les cheveux étaient déjà longs. Mais il se passa des jours très sombres à la ferme de Fays, surtout sur les chantiers, pendant les mois de janvier et février. Nos responsables militaires finirent par fournir aux plus nécessiteux des sabots et des souliers à semelles de bois. Le personnel ne s’y habituait pas, alors pour aller et revenir du travail, ils les portaient souvent à la main.
Le dimanche, pas de travail pour ceux qui allaient aux différents chantiers. Je dis cela car il y avait un groupe de cinq de nos compatriotes qui, devant les conditions dans lesquelles on nous faisait travailler, refusèrent. En Espagne, ils étaient carabiniers, et la menace que l’on brandissait d’y renvoyer ceux qui ne voulaient pas travailler ne leur faisait pas peur. Peut-être leurs responsabilités étaient-elles faibles en Espagne, et un beau jour de retour du travail ils ne furent plus là. Je n’eus jamais plus de leurs nouvelles.
Les aides-cuisiniers nous apportaient la popote avec une camionnette sur les chantiers. On mangeait à ciel ouvert. Pas question de cantine ou de couverts, encore moins de maison pour s’abriter. Si on avait du bois, on faisait du feu. Sinon, on mangeait à la température ambiante du jour. De toute évidence, ceux qui travaillaient aux cuisines étaient plus ou moins jalousés par tous les autres. Et il y en avait un qui, à chaque fois que l’aide-cuisinier nous apportait le repas, commençait à le critiquer. Et tous les jours pendant qu’il nous servait, il entendait la même litanie. Jusqu’au jour où le camarade critiqueur venant d’être servi commença à répéter les mêmes mots. Le serveur, fatigué de l’entendre, lui donna un coup de pied gauche dans l’assiette. Tout vola en l’air. Ce fut un moment de panique qui se transforma en rigolade. C’en fut fini de la critique.
Les mois de janvier et février passèrent plutôt mal que bien, mais la bonne humeur prit le dessus. On rigolait de nos malheurs le soir à la veillée. Dans le nombre, il y avait un pianiste qui accumulait le fromage qui sent fort. Nous n’étions pas habitués à ce fromage. Je crois que je n’en ai jamais mangé malgré la faim et beaucoup ne pouvaient pas non plus. Il en avait donc plus qu’il ne pouvait en manger.
Il y avait des chanteurs, des artistes de théâtre, des comiques et certains qui avaient de l’esprit. Alors à la veillée ils nous faisaient tous rire, sauf le pianiste. Longtemps, nous avons pu voir, écouter et rire car on nous avait délogés de l’étable à cochon et fait regagner le gros du personnel dans la grande salle. Si on y était moins bien, on y riait bien davantage.
On était payé 5 francs par jour. Ce qui veut dire que l’on ne se pressait pas ou qu’on ralentissait. Avec ces 150 francs par mois, on achetait ce que l’on pouvait.Nous avions de la chance : sur le trajet du travail, il y avait une ferme qui devait être hors du périmètre de la future usine. On nous y vendait des œufs que nous mettions dans notre café le matin pour déjeuner. Comme on n’avait pas d’assiette, on faisait ça dans des boîtes de conserve d’un litre. Et dans cette salle de ferme entre 7 heures et 8 heures moins le quart, il y avait un vacarme fou du bruit que nous faisions en battant les œufs dans ces boîtes. Puis on partait librement à chacun son rythme.
Selon les besoins du travail, on nous envoyait sur la voie où des wagons étaient arrivés pleins de traverses à décharger. On se rendit compte que ce dont étaient enduites les traverses nous brûlait la peau du visage avec le froid intense qu’il faisait. Pas de gants aux mains, sur la figure pas de pommade d’aucune sorte. Certains se mirent du beurre. Personnellement, le beurre me manquait à l’estomac et le choix fut vite fait. D’autres fois, ce n’était pas des traverses mais de grosses pièces en fer qui pesaient peut-être 5 tonnes. Là, il ne fallait pas aller vite car c’était dangereux. Et ne vous en faites pas, la vitesse on ne connaissait pas ça. Pas d’accident que je me rappelle.
Je voudrais dire que dans une situation comme celle que je viens de décrire, ceux qui avaient des origines paysannes comme nous s’en sortaient mieux. Car après tout, nous approchions de notre élément, sauf bien entendu pour ce qui était de la température.
On s’aperçut vers la fin mars que la nature bougeait, à notre grande joie. Il y avait encore de fortes gelées et du givre au point que nos mains restaient plus ou moins collées au fer, mais on allait vers le printemps et cela nous donnait de l’espoir. On voyait l’avenir moins noir. Les rayons du soleil du mois de mars, c’était comme le beurre et la confiture de myrtilles sur toute la largeur d’une tartine bien grillée d’une grosse fougasse de pain, tellement les recevoir nous faisait du bien. Avec les beaux jours, les naturistes se mirent à travailler torse nu.
À la section des maçons, il y avait un chef d’équipe alsacien, car tous les chefs d’équipe étaient français. Il semble que c’était un vrai négrier car sa façon de leur parler était toujours mauvaise. Il les insultait parfois car le travail n’avançait pas comme il voulait. La raison, vous la connaissez : n’étant pas payé, le travail se faisait bien entendu au rabais. Et à force d’être plus ou moins maltraités, d’entendre gueuler toute la journée, d’être traités souvent de fainéants... Mais lui, en plus de bien manger, d’être bien équipé et bien payé, et d’avoir une grosse bedaine, il exigeait des autres qu’ils fassent ce que lui n’aurait pas fait dans les conditions qu’on nous faisait vivre. Un jour, quand mes compatriotes en eurent marre de ce traitement, ils arrêtèrent de travailler. Alors cela lui fit perdre son self-contrôle d’homme responsable. L’adrénaline lui monta tellement qu’il gifla le premier venu. On frôla la catastrophe devant cette humiliation car aucun combattant de la guerre d’Espagne n’était homme à se laisser gifler par qui que ce soit, et encore moins par un négrier. Mais grâce au sang froid du responsable espagnol du groupe et la menace que l’autorité faisait peser sur nous de reconduire à la frontière celui qui provoquerait un désordre, cela s’arrêta là. Pour le groupe, il n’y eut pas de conséquences, mais le négrier fut envoyé ailleurs.
Je reviens sur cette ferme de Fays. Comme je l’ai dit plus tôt, et c’est ancré dans mon cerveau dans le coin des souvenirs pour la vie, il y régnait un esprit burlesque et moqueur envers nous-mêmes et la condition dans laquelle on nous maintenait. Alors, dès que nous eûmes digéré le froid et les intempéries et compris que c’était irréversible, que l’on se fut organisé chacun dans son coin, cet esprit se réveilla chez certains de nos amis et cela fit tilt à bien d’autres. Les soirées du triste hiver se transformèrent en mélange de théâtre et de vaudeville, de comique et de chansons. Ces soirées étaient tellement chaudes que l’on oubliait les températures très basses du dehors.
Nous avions parmi nous un ténor professionnel qui s’isolait un peu pour pratiquer sa voix quand ça lui prenait. Il s’appelait Mario, et il comprit qu’au lieu d’être dans cette ferme, il valait mieux qu’il retourne en Espagne. C’est ce qu’il fit, et nous n’eûmes plus de nouvelles. Un autre s’appelait Jean Claremun, la cinquantaine, la voix nasillarde. Il me plaisait moins. Un autre, non chanteur, mais qui par son verbe enrichissait nos soirées, et le célèbre Cli qui fit une petite chanson sur son nom et qui disait entre autres paroles ceci en catalan :
Tots som del Cli, Tots som del Cli, Amb molts collons, ya poc a poc, Tots som del Cli, Tots som del Cli, El deu qu’ens ba pari, etc.
Traduction : Nous sommes de chez le Cli, Nous sommes de chez le Cli, Avec de grosses parties, Et doucement au travail, Nous sommes de chez le Cli, Nous sommes de chez le Cli, Le dieu qui nous a mis au monde, etc.
Cette petite chanson, quoique plus longue, devint presque l’hymne de notre compagnie. Elle fut très populaire et bien adoptée. La compagnie de la ferme à côté n’en revenait pas de voir comme nous nous amusions le soir venu. Petit à petit, ce vacarme s’éteignait en se couchant pour dormir jusqu’au lendemain pour le brin de toilette et l’ordinaire maintenant régulier.