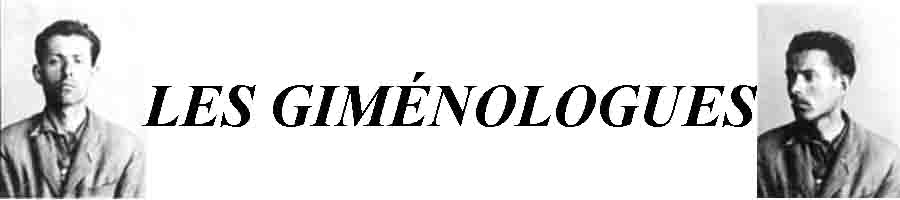Je restai à Santa María de Molla environ un mois. Un matin, on me convoqua au Q.G. du IIème corps d’armée...
Je restai à Santa María de Molla environ un mois. Un matin, on me convoqua au Q.G. du IIème corps d’armée où l’on me dit que je devais quitter le front : j’étais démobilisé comme tous les volontaires étrangers. Deux jours après, j’arrivai à Barcelone. La ville et sa banlieue regorgeaient de réfugiés. Le ravitaillement étant très difficile, la faim et la misère s’ajoutaient à l’horreur des bombardements. Malgré cela, dans cette situation catastrophique, dans les hautes sphères de la politique, on continuait à se chamailler pour la conquête d’un pouvoir illusoire et les polices communistes chassaient les militants du P.O.U.M.
Moi, je travaillais dans un dépôt où arrivaient les colis que les parents et amis de France envoyaient pour aider à survivre ceux des leurs qui poursuivaient la lutte. Chaque parti ou syndicat avait son organisation de secours qui recevait l’aide collective ou personnelle que l’on expédiait de France par camions une ou deux fois par semaine.
À Moncada, j’avais retrouvé ma compagne qui s’était réfugiée chez des parents, et, pendant quelque temps, je pris le train matin et soir pour aller à mon travail. Puis Antonia loua un appartement en ville et nous vécûmes l’existence de tous les habitants de la vieille cité : partagés entre soucis de ravitaillement et peur des bombes.
Dans cette période qui va d’octobre 38 à février 39, j’ai vu s’évanouir l’espoir que je nourrissais en secret de retrouver certains de mes compagnons de combat : Mario, Lorenzo, Ritter. De tous mes amis, je revis seulement Otto. Giua était tombé, Mario et Ritter disparurent à tout jamais sur les bords de l’Èbre. Madeleine fut tuée par une bombe à Barcelone même.

La mort avait fait le vide autour de moi et je me demande encore aujourd’hui pourquoi elle m’a épargné. J’ai revu aussi Soledad dans les derniers jours de janvier. Elle ne sortait pratiquement plus de l’hôpital, son travail ne lui laissant pas de répit. Ce matin-là, j’arrivai avant l’heure à mon travail. Soledad venait retirer des colis pour les blessés de son service. Après les premières effusions, elle me donna les nouvelles des copains du groupe qui étaient passés, plus ou moins amochés, entre ses mains : Pablo fut fait prisonnier et le Cubain, qui avait reçu une balle dans la cuisse, l’avait vu, traîné par des soldats italiens pendant une contre-attaque. D’autres, beaucoup d’autres avaient disparu dans la tourmente, pendant qu’à l’arrière les grosses têtes de la politique se disputaient les parcelles du pouvoir et que la police donnait la chasse aux militants du P.O.U.M. et de la F.A.I., irréductibles partisans de la lutte à outrance.
La première semaine de février, pour être plus exact, le premier février, nous quittâmes, Antonia, Pilar et moi notre domicile pour la gare de Barcelone où je retrouvai quelques Italiens : Rossi Ludovico, sa compagne Louise et leur fils, Lina Simonetti, Giuditta la compagne de Francisco Ferrer, petit-fils de celui qui avait été fusillé à Montjuich, abattu par la Checa à Barcelone en mai 37, Auguste Magnani, sa femme et leurs deux enfants.
La gare regorgeait d’hommes, de femmes et d’enfants de toutes nationalités, inquiets, nerveux et craintifs. Le grand exode des vaincus de la révolution espagnole commençait, pareil à toutes les migrations des peuples chassés par les invasions barbares.
La cinquième colonne multipliait les attentats et les sabotages. Les armées de Franco étaient aux portes de la ville. Nous quittions la terre d’Espagne avec l’espoir de rejoindre le Mexique, le Venezuela ou le Chili. J’avais dans mon portefeuille un papier du consulat du Mexique qui m’autorisait à me rendre dans ce pays avec ma famille. Le train nous conduisit jusqu’à un hameau à une vingtaine de kilomètres de la frontière où nous passâmes quelques jours. Puis, à pied, longeant la voie ferrée, nous nous approchâmes de France. Notre marche était lente pour plusieurs raisons : l’aviation italo-allemande, qui parfois nous mitraillait, nous obligeait à nous éparpiller dans la nature, les enfants qu’il fallait porter (à cause de la pénurie du ravitaillement à Barcelone, ils étaient tous sous-alimentés) car ils n’avaient pas la force de continuer la route.

Nous étions près de Culera, une petite gare, la dernière avant d’arriver à Port-Bou, lorsque la mort frappa une ultime fois pour moi en Espagne. Imaginez une foule : hommes, femmes, enfants traversant un tunnel. Une locomotive, haut le pied, sans personne pour la conduire ou pour freiner, s’engageant à toute vitesse dans ce long et obscur boyau grouillant de monde. Mon expérience de trimardeur m’avait fait conseiller à mes amis de marcher en file indienne, le plus près possible de la paroi et cela nous sauva. La machine passa comme un éclair devant nous dans un bruit infernal de ferraille où se mêlaient les cris d’épouvante et de douleur des blessés et des mourants.
La cinquième colonne avait voulu frapper encore une fois aveuglément ces êtres qui fuyaient les horreurs de la dictature réactionnaire qui s’abattaient sur l’Espagne.
Port-Bou : point terminal des chemins de fer ibériques. Toutes les voies étaient pleines de wagons de marchandises, chargés de munitions, armes, vivres. Depuis deux ou trois jours, aux dires des cheminots, la France livrait à l’Espagne républicaine les convois qu’elle avait bloqués depuis deux, quatre, six mois dans ses gares. Elle les livrait en fait à Franco, et à ses amis Hitler et Mussolini.
À Port-Bou, on fit monter les femmes, les enfants et les hommes âgés sur des wagons de marchandises qui rentraient en France. Les hommes valides devaient passer la frontière par leurs propres moyens.
Pour la dernière fois, je gravis cette colline que je connaissais si bien pour l’avoir franchie, à la barbe des douaniers, maintes et maintes fois avant 36. En marchant, je sortis mon 9 millimètres de son étui. Je le démontai en m’aidant de mon canif et je jetai les différentes pièces loin dans la colline. La Gendarmerie et l’Armée française nous attendaient.
Marseille 1974-1976