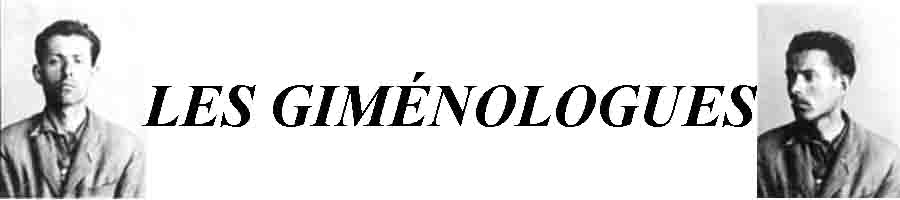Pina de Ebro fut investie sans difficultés majeures : à environ 12 kilomètres de la ville, on avait bien eu un échange de coups de feu avec une poignée de phalangistes qui gardaient le carrefour de Gelsa, mais aucun de nous n’avait été touché, tout allait pour le mieux.
Pina de Ebro
Pina de Ebro fut investie sans difficultés majeures : à environ 12 kilomètres de la ville, on avait bien eu un échange de coups de feu avec une poignée de phalangistes qui gardaient le carrefour de Gelsa, mais aucun de nous n’avait été touché, tout allait pour le mieux. La IIème fut chargée d’occuper tous les croisements et de perquisitionner les maisons. On ne trouva personne de suspect.
Les enfants furent les premiers à vraiment fraterniser avec nous, poussés par la curiosité. Il faut bien reconnaître qu’à part une minorité de jeunes initiés à la lutte sociale, tous les autres avaient peur. Presque tous les enfants étaient pieds nus ou chaussés d’“ abarcas ” (espèce de sandale confectionnée avec un pneu de voiture, fabrication familiale) ; aucun de ceux à qui nous posâmes la question n’avait chaussé de souliers. Il y avait un magasin de chaussures sur la place de l’église. Le commerçant commença à donner des souliers à un enfant, puis à un autre, et comme il fallait les leur faire essayer, il nous appela à l’aide. Nous fûmes 5 ou 6 à nous transformer en vendeurs de chaussures et je me souviens que l’on réclamait des plus petits une grosse bise et des grands une poignée de main. C’était assez cher pour les petits car nous avions des barbes de trois jours.

Durruti fit rassembler la population sur la grande place et prononça une brève allocution. Il dit que la terre appartenait aux gens et qu’ils n’avaient qu’à la travailler ensemble, en collectivité, mais que ceux qui préféraient continuer à l’exploiter en famille le pouvaient. Il ajouta aussi que l’argent n’avait plus de valeur, que seul le travail comptait. Pendant que l’on fouillait les maisons pour voir s’il n’y avait pas des gens qui se cachaient, on enlevait tous les objets de culte qui nous tombaient sous la main. Les Espagnols sont très croyants sans pour autant aimer l’église et les curés et j’ai souvent remarqué chez les paysans un étrange mélange de croyances chrétiennes et d’idées d’avant-garde : choses qui, en y regardant bien, ne sont pas incompatibles. De toutes façons, le fait est que personne ne peut le nier. Chaque fois qu’ils se sont révoltés contre l’ordre établi, ces catholiques croyants ont brûlé les églises et massacré les curés. Celle de Pina n’échappa pas à la règle.
Dans toutes les maisons, il y avait sur les murs et sur les meubles des christs en croix, des images de saints, des rosaires. Dans certaines familles, les femmes nous aidaient à décrocher et à brûler dans leur propre cheminée ces objets, symboles d’ignorance et d’esclavage ; dans d’autres maisons où de vieilles gens nous priaient ou essayaient de cacher ces choses, pour elles précieuses, notre mission devenait pénible... J’ai compris ce jour-là jusqu’où pouvait aller notre tolérance pour ces hommes incultes, prêts à tuer en riant tous les curés de la terre et à aider à cacher, pour faire plaisir à un vieil homme ou à une vieille femme, un crucifix ou une sainte vierge.
Je me souviens d’avoir vu un authentique tueur de curés (je l’avais vu à l’œuvre à Lérida) rentrer dans une chambre où une vieille femme couchée essayait de décrocher un christ suspendu au mur au-dessus de son lit, sans pouvoir y arriver. L’homme rentre, décroche le christ, regarde la vieille qui est recroquevillée sous les couvertures, les soulève légèrement et glisse rapidement l’objet dessous... puis rafle sur la table de nuit deux ou trois images de saintes et se retourne pour sortir. Il me voit sur le pas de la porte et comprend que j’ai été témoin de ses gestes ; il lève les épaules et me dit : “ Compañero, podría ser mi abuela, y tuya tambien... ” ( Camarade, elle pourrait être ma grand-mère, ou la tienne ...) Nous sortîmes ensemble en devisant sur la bêtise de tout ce monde qui se laisse embobiner par les marchands de vent qui promettent le Paradis après une vie d’Enfer.
Quelques jours passèrent dans le calme. Nous, nous essayions de briser les derniers obstacles que la crainte élevait entre les plus réfractaires et nous. Puis, une nuit, ce fut l’alerte : phalangistes et Requetés se regroupaient de l’autre côté du fleuve, entre Pina et Osera, et allaient attaquer. En silence, on alla se placer dans les tranchées individuelles que l’on avait creusées les nuits précédentes, à une quinzaine de mètres du bord de l’eau. Herrera et moi avions pris place dans un trou d’un mètre de long sur cinquante centimètres de large environ.

Mon compagnon était un homme d’une quarantaine d’années. Le 19 juillet, il était à la prison Modelo de Barcelona, avec un bail de 50 ou 60 ans, je ne me souviens plus très bien. Libéré, il avait, avec deux de ses complices habituels, emprunté une voiture pour venir à Lérida d’où ils étaient originaires. Depuis son adolescence, il avait toujours vécu de vols et de rapines, sauf pendant les périodes où le gouvernement le logeait et le nourrissait gratis.
Je vous dis tout cela parce que deux jours plus tard, pendant une patrouille sur nos arrières pour dépister de possibles infiltrations ennemies, on pénétra à l’intérieur d’un couvent ; les moines en étaient partis depuis longtemps. Nous visitâmes tous les étages, sans rien trouver d’intéressant, puis Herrera et un autre s’en furent visiter les caves ; l’autre copain et moi restâmes de garde à l’extérieur. Je commençais à être fatigué d’attendre mon camarade ; aussi, bien que les caves aient été grandes, le temps s’écoulait lentement. Enfin, ils arrivèrent en courant.
“ Antoine, me dit Herrera, viens voir.
– Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a à voir ?
– Je ne sais pas ce que c’est, mais c’est sûrement quelque chose de pas très catholique. ”
Le copain qui était de garde avec moi, Herrera et moi-même sommes descendus en passant par la cour. Herrera ramassa une pioche qui traînait par-là, et une fois arrivés dans la cave, il nous montra un pan de mur où les pierres avaient été scellées récemment : “ Eh bien ! C’est ce que tu voulais nous faire voir ?
– Écoute, le cimetière est au fond du jardin. Si les moines ont scellé ces pierres, ils avaient certainement des raisons. Ceci est une tombe ou une cachette, écoute avec attention... ”
Avec le col de la pioche, il frappa des coups sur le mur. Il était plein partout, sauf à l’endroit où il avait été refait.
“ C’est vrai, lui dis-je, ça sonne creux.
– Alors ? On regarde ce qu’il y a ?
– Allons-y. ”
Il attaqua le joint supérieur qui était le plus large. La première pierre céda enfin, et ce fut un jeu, ensuite, d’agrandir l’ouverture. Le faisceau de la lampe électrique éclaira la cavité qui ne contenait qu’un coffre de facture ancienne, tout bardé de ferrures ouvragées. Le sortir de son trou et faire sauter le cadenas qui le fermait fut l’affaire de deux ou trois minutes : il était plein de bijoux et de pièces de monnaie vieilles de quelques centaines d’années. La richesse était assurée pour nous quatre et pour le restant de nos jours. Herrera partit en courant appeler le copain qui était resté dehors. Dès qu’ils revinrent, notre décision fut prise : moi, je restais là avec deux autres, le quatrième allait chercher une voiture. Le soir même, le coffre et son contenu étaient au siège du syndicat... (si ma mémoire est bonne et mes renseignements exacts, ce fait a été relaté à l’époque par certains journaux français).
Vers deux heures du matin, Herrera me chuchota : “ Oyes ? (tu entends ?) ” En effet, au léger bruissement de l’eau courante s’en était ajouté un autre, très léger aussi au début, mais qui se rapprochait de plus en plus : celui des avirons dans l’eau. Mon cœur commença à battre si fort que j’avais l’impression qu’il voulait défoncer ma poitrine. Accroupi au fond du trou, mon compagnon alluma le briquet amadou et me le passa. J’avais dans mon sac deux boîtes de conserves bourrées de trinitrotoluène (tolite). J’en déposai une devant moi sur le sable et je gardai l’autre dans ma main gauche. Un coup de fusil éclata. Une masse noire se dessina devant moi, dans l’obscurité de la nuit. Je fléchis les genoux, j’approchai les mèches en soufflant sur l’amadou et je comptai. Un, deux, trois, quatre. Puis il y eut une lumière aveuglante, une explosion et toute la rive s’embrasa : ce fut l’enfer.
Je voyais derrière moi des ombres qui surgissaient du néant, sautaient, couraient vers moi et disparaissaient dans le bruit assourdissant des coups de fusil, de revolvers, d’explosions de bombes. Je lançai ma dernière boîte sur une ombre qui venait de sortir de la nuit. Les balles sifflaient dans l’air comme des guêpes enragées. Les plaintes et les sanglots des blessés se mêlaient à l’infernal orchestre des engins de mort. Puis le feu ralentit, et très vite ce fut le silence que rompaient seulement les gémissements et les cris des blessés.
Les deux barques qui avaient accosté devant la tranchée gisaient, disloquées, presque complètement submergées dans le lit du fleuve. Leurs occupants n’avaient pas tous eu le temps de débarquer et la majorité avait été projetée dans le courant à cause de l’explosion, et s’était noyée.