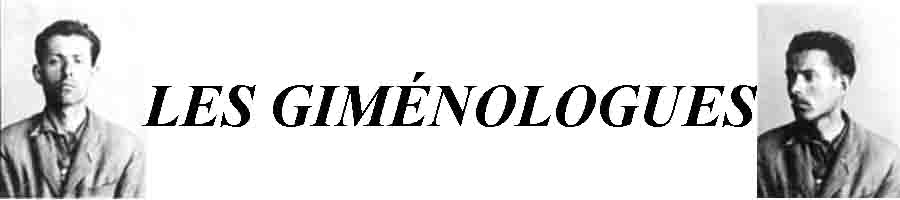Le lendemain après-midi, nous repartîmes. Nous avions fait circuler le bruit que trente parmi nous partaient en permission.
Le lendemain après-midi, nous repartîmes. Nous avions fait circuler le bruit que trente parmi nous partaient en permission. Les autres seraient relevés par les Brigades pour pouvoir aller se reposer au Cruce de Gelsa. À Bujaraloz, Pablo nous révéla nos objectifs. Il fallait pénétrer dans les lignes ennemies et retarder ou empêcher l’arrivée de renforts pendant l’offensive qui devait être déclenchée au cours de la nuit. Nous avions juste le temps de rejoindre notre zone d’opérations. Cinq groupes de six, échelonnés sur un front de vingt kilomètres environ : de Velilla de Ebro à Fuentes.
Notre guide nous quitta au dernier avant-poste de l’armée républicaine après nous avoir indiqué le chemin que nous devions emprunter. Après avoir traversé une étroite vallée et contourné une colline couverte de pins et de broussailles, nous vîmes, loin derrière nous, sur un sommet, briller des lumières : nous avions réussi à traverser les dispositifs de défense adverse. Nous marchâmes vers le sud en suivant la base des collines boisées. Un bruit lointain nous fit stopper net. Un véhicule, auto ou camion, se rapprochait. Le camion, car cela en était un, passa à une quarantaine de mètres de l’endroit où nous étions pour aller s’arrêter un peu plus loin. Les hommes qui en descendirent parlaient sans crainte d’être entendus : ils allaient relever leurs camarades. Nous coulant comme des couleuvres dans les buissons, nous réduisîmes la distance qui nous séparait. Jo et Fred mirent les F.M. en position et nous ouvrîmes le feu. Cris de douleur, hurlements d’épouvante. Tout signe de vie s’effaça. On arrêta le tir. La surprise avait été totale. L’adversaire n’avait pratiquement pas riposté. Le bruit des moteurs nous annonça que d’autres forces arrivaient, mais celles-là s’arrêtèrent avant d’arriver à notre portée. On ne voyait rien et, comme nous, ceux d’en face se dissimulaient parmi les touffes de genêts et de romarin. C’est Fred qui les entendit le premier.
Quelqu’un se glissait en rampant vers nous. Tirant presque au ras du sol, les F.M. balayèrent le terrain pendant que les filles et moi nous débarrassions des grenades. Et tout redevint calme lorsque se fut éteint le bruit de la course de ceux qui avaient échoué dans leur tentative d’approche.
Le temps passa. Laissant nos compagnes aux aguets, nous explorâmes l’espace autour de nous. Nous étions à la base d’une colline dont la pente était très raide et difficile à escalader au moins dans ses débuts. La retraite s’avérait difficile. Une détonation éclata, assourdie par la distance, suivie par un sifflement et une explosion sur le flanc de la colline. Des pierres tombèrent autour de nous. Une autre éclata devant notre position. Puis, un cri poussé par je ne sais combien de poitrines remplit la nuit : “ ¡ Arriba España ! ” Les dernières grenades et les F.M. nous permirent de les repousser, mais Fred et Asumpción gisaient sans vie, les mains crispées sur leur arme. On décida de battre en retraite. Trop tard : un déluge d’obus s’abattit sur nous.

Je repris conscience sur une couche de peaux de moutons, dans une “ paridera ”, une cabane aux murs en pierres sèches et au toit de chaume où les bergers s’abritent avec leur troupeau, la nuit ou par temps d’orage.
J’avais mal partout. La tête était de loin la plus douloureuse car elle me faisait souffrir même si je restais immobile. J’avais l’impression d’avoir roulé en bas d’un escalier de six étages. Un vieux bonhomme s’approcha de moi : “ Por fin te despiertas. ” Il porta sa gourde à mes lèvres et me fit boire en disant : “ No tengas miedo ” - N’aie pas peur, bois, ça te fera du bien. Avant que je ne lui pose des questions, il me dit comment il avait entendu le combat qui s’était déroulé la nuit. Tous les postes franquistes avaient été attaqués presque au même moment. Une fois le danger passé, il était parti avec son chien et son âne pour retourner chez lui. Il m’avait découvert gisant au milieu de mes camarades déjà froids. Un gémissement avait attiré son attention. Constatant que je n’avais pas de blessures apparentes, il m’avait chargé sur son âne et avait rebroussé chemin. Après m’avoir offert de partager son repas, pain, saucisson, figues sèches, le tout arrosé de quelques gorgées de vin du pays, il m’accompagna un bout de chemin pour m’indiquer un raccourci. La nuit tombait lorsque j’arrivai à Cruce de Gelsa à bord d’une ambulance qui m’avait pris sur la route. L’offensive d’Aragon se développait en direction de Belchite et, selon le chauffeur, bientôt cette ville serait libérée. Moi, j’avais un mal de crâne tel que je ne me rendais pas compte de ce qu’il me disait : j’enregistrais et c’était tout.
Le groupe campait au carrefour de la route de Bujaraloz en attendant l’ordre de monter en ligne. Un peu plus loin, un bataillon des Brigades se reposait des fatigues d’un long voyage en camion. Je revenais du P.C. lorsque je rencontrai Hans, le compagnon de Madeleine. Elle aussi était partie pour essayer de savoir ce que j’étais devenu. En attendant son retour, Hans me dit les raisons de son engagement dans les Brigades.
Depuis les journées de mai, les militants du P.O.U.M. étaient pourchassés, Andrés Nin avait disparu et était probablement mort dans une geôle du parti de Staline. Pour un trotskiste allemand, les Brigades étaient l’endroit le plus sûr à condition de se taire et d’accepter la discipline. Sur ces entrefaites, Madeleine arriva. Je me souviens qu’elle parla un moment en allemand avec Hans. Celui-ci prit ensuite congé de moi et s’éloigna en disant “ ¡ Hasta luego ! ”.
La nuit nous enveloppait dans ses ténèbres. Le contact des lèvres de mon amie sur ma bouche fit céder la tension nerveuse qui m’avait soutenu depuis mon réveil dans la “ paridera ”. Cette tension lâcha subitement et, cachant mon visage au creux de son épaule, je me mis à pleurer, à chialer comme un gosse. Oui, je sais, c’est ridicule. Comment est-il possible qu’un homme digne de ce nom, un combattant endurci par près d’un an de lutte puisse éclater en sanglots et cela devant une femme, fût-elle sa maîtresse ? Pourtant, c’est la vérité, j’ai craqué, je me suis effondré comme un pantin à qui on a coupé les ficelles. Madeleine m’allongea sur une couverture et se coucha presque sur moi tout en me demandant ce qui s’était passé de si terrible. Alors, je lui racontai tout : la mort de Jo et de Fred, celle de Conchita, Asumpción et Rosita qui avaient voulu partager notre sort par amour pour nous. En parlant, je m’étais calmé. À la fin de mon récit, j’avais recouvré mon sang-froid et je lui demandai pardon de ma faiblesse. Le lendemain matin, je la quittai. Je ne devais plus la revoir, elle non plus, car elle ne devait pas survivre : les bombardiers d’Hitler la tuèrent lors d’un des raids sur Barcelone.
Cette période de ma vie est physiquement la plus mouvementée : l’offensive républicaine en Aragon nous transforma en unité mobile, toujours en mouvement du front de Huesca à celui de Belchite et Teruel.
La première opération nous amena, après une marche épuisante sous un soleil de plomb, au sommet d’une colline où nous fîmes halte. Il faisait déjà nuit. Je m’endormis presque tout de suite au pied d’un arbre pour ne me réveiller que le lendemain matin, secoué par Pablo qui me criait qu’il fallait partir. Nous nous étions trop avancés et risquions d’être encerclés. Ce jour-là, j’appris ce qu’était un avion de combat. Nous marchions en ordre dispersé, dans un paysage désertique à la végétation rare et rachitique, lorsque les chasseurs allemands foncèrent sur nous, nous arrosant d’une grêle de balles. Le carrousel de la mort continua ainsi, semant la peur. Plaqué au sol, sur le dos comme à mon habitude, je les regardais tomber du ciel comme s’ils devaient s’écraser, puis se relever, remonter, décrire un demi-cercle et recommencer. Au bout d’un moment assez long en vérité, j’entendis la voix de Pablo qui nous criait de tirer sur les appareils : “ Apuntar delante el aparato. ” - À mon commandement, feu. Je n’avais qu’un revolver. Je m’abstins de gaspiller les munitions, ce qui me permit d’observer ce qui se passait autour et au-dessus de moi. Les premières salves n’eurent aucun résultat appréciable. Entre le passage du dernier avion de l’escadrille et le retour du premier, quelques minutes se passèrent pendant lesquelles notre mitrailleur en profita pour bondir avec sa machine derrière le tronc d’un arbre mort qui, au milieu de ce paysage dénudé, levait les moignons de ses branches maîtresses vers le ciel. Je vis les petits nuages de poussières, levés par la grêle de plomb, s’avancer presque dans l’axe de l’arbre puis, dans un vrombissement rageur, l’appareil se redressa, remonta en chandelle, laissant derrière lui une traînée de fumée noire, et disparut vers l’est, suivi des autres après un dernier passage.

L’après-midi de ce même jour, j’eus l’occasion de voir les Stukas en action. Ces bombardiers piquaient presque verticalement sur l’objectif, lâchaient leur bombe d’une hauteur d’environ quatre ou cinq mètres, peut-être moins. C’est ainsi que je les vis démolir et incendier les camions qui venaient nous chercher et rendre inutilisable la route. Les bombes creusaient des trous de deux mètres de diamètre sur un de profondeur.
D’autres que moi ont décrit l’horreur des bombardements. Camions et voitures qui brûlent et explosent, gens qui courent et tombent fauchés par la mitraille. Si j’en parle, c’est que ce jour-là je m’aperçus que, n’étant moi-même pas en danger car je me trouvais à quelques centaines de mètres du théâtre des opérations, je pouvais regarder indifférent, sans trembler de rage impuissante ou de pitié pour ceux qui tombaient, le spectacle apocalyptique qui se déroulait devant moi. J’avais perdu dans cette guerre tous mes amis et dans l’espace d’une nuit Jo, Fred, Mario, Otto, Ritter avaient été engloutis dans les ténèbres et je me retrouvais seul. Juanita, Conchita, les femmes que j’avais aimées étaient évanouies à tout jamais.
Je restais indifférent devant ce massacre. La guerre m’avait-elle endurci au point de trouver logique et naturelle la perte d’hommes qui luttaient dans le même camp que moi ? “ C’est la guerre, m’avait dit Pablo, aujourd’hui c’est eux qui sont tombés, demain ce sera peut-être moi, toi ou quelqu’un d’autre parmi ceux que tu estimes. ”