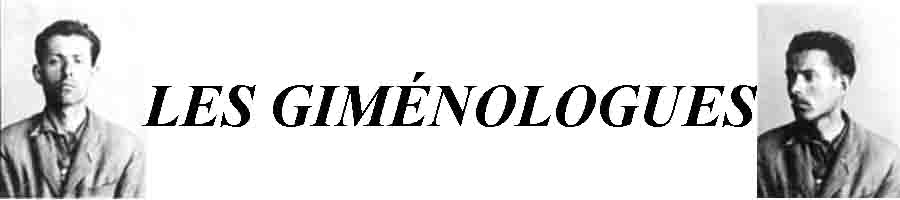Avec une logique toute militaire, après nous avoir fait remonter à 10 kilomètres au nord de Siétamo, on me donna l’ordre de convoyer un camion d’armes et de munitions vers le sud.

Avec une logique toute militaire, après nous avoir fait remonter à 10 kilomètres au nord de Siétamo, on me donna l’ordre de convoyer un camion d’armes et de munitions vers le sud. On devait rejoindre Farlete par des chemins qui longeaient la Sierra d’Alcubierre, évitant le plus possible les villes et les villages occupés par les formations du P.O.U.M. ou du P.S.U.C. qui auraient pu nous réquisitionner le camion.
Aznar, notre nouvelle recrue, tenait le volant tout en me parlant de la vie des assiégés et en me disant pour la dixième fois comment, pendant dix jours, ils avaient écouté le moindre bruit nocturne. Comment, persuadés que nous voulions les prendre par la faim, ils avaient relâché la surveillance et qu’après le passage des patrouilles, ils jouaient aux cartes, me permettant à moi de passer. Après avoir tiré sur Affinenghi, ils étaient sûrs que, comme les nuits précédentes, nous irions nous coucher en emportant notre blessé.
A quelques kilomètres au sud de Siétamo, nous fûmes interceptés par un groupe de francs-tireurs qui nous obligèrent à quitter les chemins carrossables et à filer à travers champs. Les deux copains qui se trouvaient à l’arrière furent blessés pendant la fusillade. Grâce à leur courage et au sang-froid d’Aznar, on parvint à les semer, mais, dans notre fuite, on se perdit. Ne connaissant pas la région, nous fûmes obligés de rouler un peu à l’aveuglette, cap au sud-est.

Un clocher se pointait à l’horizon lorsque le moteur commença à crachoter et Aznar à jurer comme un charretier : “ ¡ Me cago en dios y en su puta madre, hijos de putas de todos los santos ! ” Et le camion s’arrêta. Nous étions en panne d’essence. Les deux copains blessés - ils ne l’étaient que légèrement - et Aznar me demandèrent d’aller chercher du secours. J’étais, selon eux, le meilleur marcheur. Aznar devait rester pour piéger le camion et le faire sauter en cas de danger. Une heure après, j’arrivai à Sariñena. Cette petite ville était un fief du P.O.U.M. ; ses milices étaient organisées selon le modèle classique de toutes les armées du monde : la hiérarchie y régnait sans discussion. Arrivé au Q.G. , je m’adressai au planton qui me renvoya au caporal, celui-ci au sergent et ainsi de suite jusqu’au capitaine qui me fit rentrer dans une grande pièce en me disant d’attendre. L’officier qui commandait la place était en conférence et le capitaine n’était pas habilité pour détacher des hommes avec une voiture pour transporter l’essence nécessaire. Mon mal aux dents avait repris de plus belle : j’avais l’impression que l’on m’enfonçait des aiguilles à coups de marteau dans le crâne. Combien de temps avais-je marché en long et en large dans cette pièce ? Je ne l’ai jamais su. Je me souviens d’avoir enfoncé d’un coup de tête une porte et de m’être retrouvé dans la salle de conférence. Une douzaine de personnes, assises autour d’une longue table, se dressèrent, surprises par mon intrusion. Je leur criai qu’il me fallait de l’essence pour dépanner le camion et que je voulais parler au commandant de la place. On m’entoura, me demanda qui j’étais, d’où je venais. La douleur s’était calmée comme par enchantement. Des ordres fusèrent. J’enfourchai une moto et le motard qui conduisait fonça à travers champs, suivi par une petite voiture chargée de bidons.
Le soir même, nous couchâmes à Sariñena et je perdais ma première molaire. Notre succès à Siétamo était bien peu de chose dans la poursuite de la guerre. Les nouvelles étaient mauvaises : Durruti était parti pour Madrid investie par les divisions de Franco. Celui-ci avait pris la tête à la mort du général Mola et à celle de Sanjurjo. A Séville, Queipo de Llano dirigeait l’offensive contre Málaga. Dans le Nord (Asturies et Pays Basque), les combats continuaient.
À Pina, je devais apprendre que “ Gori ” avait été assassiné par les communistes à Madrid devant la cité universitaire. On m’avait déjà dit qu’il était mort, mais je n’avais pas voulu le croire, car tant de fois depuis que je le connaissais je l’avais cru disparu à jamais. Cette fois, c’était pour de bon. Les communistes ne l’avaient pas raté. Manzana l’avait remplacé à la tête de la colonne que l’on commençait à appeler “ division ” tout comme les centuries qui s’étaient transformées en compagnies.
Pendant les premières semaines, nous sillonnâmes le front d’Aragon, de la Sierra d’Alcubierre à Velilla de Ebro. Patrouilles de reconnaissance, coups de main alternèrent avec des séjours à Pina où j’avais repris mes quartiers chez la tía Pascuala, toujours heureuse de me recevoir comme un enfant prodigue à chacun de mes retours.
Madeleine était revenue à Barcelone. Son compagnon, toujours hospitalisé, se remettait lentement de ses blessures. Elle se languissait de moi. Selon elle, ses compatriotes n’arrivaient pas à la satisfaire.
Malheureusement pour elle, à Pina je couchais chez la Madre, et elle dans une autre famille et il nous était presque impossible de nous rencontrer seuls assez longtemps pour assouvir sa faim. Alors, elle se vengeait en ne me quittant pas d’une semelle pendant toute la durée de mes séjours dans le secteur. Partout où j’allais, elle me suivait. J’étais souvent avec Tarzan, et nous donnions, Madeleine et moi, l’impression d’un ménage en train de promener l’animal familier.


Les nouvelles qu’elle apportait de la capitale catalane étaient décevantes. La lutte pour la conquête du pouvoir entre les différentes factions du camp républicain continuait. La C.N.T. faisait partie du gouvernement avec García Oliver et Federica Montseny. Cette participation à un gouvernement, fût-il de coalition, était pour moi une trahison, la preuve que nous n’étions pas encore assez clairvoyants pour comprendre que nous ne devions pas accepter les méthodes de direction des partis politiques et nous asseoir à leur table. Mais nous devions, tout en apportant notre collaboration à l’effort de guerre, rester indépendants sur le plan social pour pouvoir refuser toute loi ou toute réforme du système qui aurait été contre les libertés essentielles des masses productrices.
La réorganisation de la colonne en bataillons, compagnies, etc. marchait bon train. En grinçant des dents, les copains acceptaient d’être encadrés par des officiers qui étaient, presque toujours, choisis par la troupe ou par le syndicat. C’est dans le Groupe International que cette transformation fut le plus mal reçue, au point que de Barcelone on nous dépêcha une commission de militants pour nous convaincre d’accepter, au moins en apparence et sur le papier, ce nouvel état des choses. María Ascaso faisait partie de la commission. Elle vint me voir à Velilla de Ebro pour me remettre une cartouche de cigarettes françaises et me reprocher de ne pas avoir été à la réunion qui avait eu lieu au P.C. de la division, laquelle visait à nous persuader de nous plier, au moins en apparence, aux exigences de la nouvelle structuration des forces armées républicaines.
Je me souviens que nous passâmes tout une après-midi à discuter. Elle, pour me prouver la nécessité que nous avions de rassurer les nations démocratiques comme la France et l’Angleterre, en leur faisant croire que nous défendions la république et que nous avions une armée forte et disciplinée prête à défendre la forme de société en vigueur sur leur territoire. Moi, pour essayer de lui faire comprendre que nous étions un groupe de francs-tireurs avec nos propres règlements, et que nous avions plus d’efficacité en restant en dehors de l’armée. J’arrivai à la persuader que j’avais raison, mais ma victoire fut de courte durée. La majorité des composants du groupe se rallièrent aux suggestions de la commission de propagande qui rentra à Barcelone fière de la mission accomplie.
Le seul résultat tangible de la militarisation fut que presque tous les Allemands, une bonne partie des Français et des Italiens nous quittèrent pour aller grossir les rangs des Brigades à Albacete.

L’assassinat de Durruti avait sérieusement ébranlé mon ardeur à la combativité. Avec mes amis Scolari, Giua, Otto, Mario et Ritter, nous formions un petit noyau réfractaire à la militarisation et à la discipline en découlant. Pablo savait qu’il pouvait compter sur nous en cas de coup dur, à condition de ne pas nous demander d’accomplir des choses que nous avions toujours refusé de faire même au prix de notre liberté ou de notre bien-être matériel. Nous étions presque tous des insoumis ou des déserteurs. L’exode des copains vers les Brigades Internationales avait réduit les effectifs de près de la moitié.
Pablo décida de m’envoyer à Barcelone pour recruter : Italiens, Français et autres qui se trouvaient dans la capitale catalane, des volontaires pour grossir nos rangs ; Giua, Ritter et Otto m’accompagnaient.