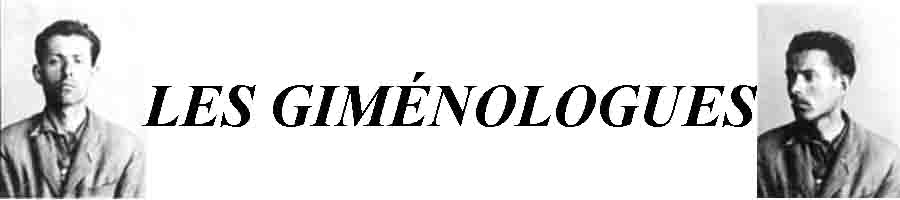Témoignage inédit en français d’un milicien du Groupe International sur la collectivité de Fábara (Aragon), publié en 1938

Nils Lätt n’est pas un inconnu pour nous*. Grâce à l’amabilité d’Anita Ljungqvist qui a traduit du suédois la brochure de ce milicien anarcho-syndicaliste (et espérantiste), nous pouvons enfin prendre connaissance du récit de son séjour (printemps-été 1937) dans une collectivité agricole aragonaise située au Sud-ouest de Caspe, en arrière du front tenu dans ce secteur par la colonne Ortíz, devenue la 25ème Division.
Les Giménologues, 9 mai 2011
* Voir notre article précédent : article435

Lors du soulèvement de Franco en Espagne en 1936, Nisse Lätt, marin et anarcho-syndicaliste (1907-1988), part comme volontaire et combat dans la fameuse colonne Durruti jusqu’à ce qu’un éclat de grenade lui fasse perdre un œil.
Il quitte alors le front pour travailler dans une collectivité agraire. De retour en Suède, il écrit sur les événements vécus et sur ses expériences. Ce texte, Milicien et ouvrier agricole dans une collectivité espagnole, fut publié en 1938 par Federativ, la maison d’édition des syndicalistes. Cette brochure était et demeure un document d’époque important.
Après la mort de Nisse Lätt, on a trouvé le manuscrit d’une autobiographie qui fut publié en 1993 avec pour titre : Un anarchiste suédois raconte. Pour le compte rendu critique de ce texte, voir : Recension : « Nils Lätt : En svensk anarkist berättar. »
Cette brochure ne prétend en aucune manière être une description exhaustive des événements d’Espagne. Il s’agit seulement du récit d’un international qui fut milicien dans la colonne Durruti et ouvrier agricole dans une collectivité aragonaise.
Le drame espagnol
Ici, dans le Nord au climat plus froid, j’ai souvent entendu des ouvriers syndiqués, qui avaient une forte conscience de classe, reprocher particulièrement aux anarcho-syndicalistes espagnols d’avoir voulu pousser cette lutte jusqu’au bout sans une garantie de réussite à 100%. Ces reproches sont sans fondement après les événements de juillet 1936. Les anarcho-syndicalistes, justement, par leurs luttes revendicatives incessantes, ont réussi à insuffler à leurs organisations une force d’initiative et une espérance profonde quant à la victoire du peuple. Sans cela, les fascistes n’auraient pas rencontré une telle résistance.
Que les ouvriers de Barcelone, de Valence et d’autres endroits aient su rapidement vaincre la révolte fasciste du 19 juillet 1936 n’est pas fortuit ; c’est la suite logique de leurs convictions politiques et économiques. On savait qu’une liquidation du système capitaliste ne pouvait se faire sans une confrontation colossale, et on s’y était préparé au mieux.
Les conditions de vie en Espagne avant la révolution étaient épouvantables : les masses y vivaient dans la plus grande pauvreté.
La majeure partie de la terre appartenait à un groupe très restreint de propriétaires pour qui les travailleurs n’étaient que des bêtes de somme.
L’industrie était principalement entre les mains de sociétés étrangères qui essayaient, en Espagne, d’utiliser les mêmes méthodes que dans les colonies avec les indigènes.
C’est cet ensemble qui avait le pouvoir et qui tenait le pays. Tant que cette situation durait, les gouvernements étaient assurés de leur maintien, et la moindre révolte de la part des travailleurs était réprimée avec sauvagerie. Pauvreté et non-droit avaient naturellement pour conséquence d’aggraver peu à peu les relations entre exploiteurs et travailleurs, ces derniers ne voyaient que la révolution comme solution pour acquérir de meilleures conditions de vie.
En dépit des persécutions, des emprisonnements, des déportations, de l’assassinat des camarades les plus actifs, on continuait quand même, dans l’illégalité, à se préparer à prendre en main les moyens de production. On ne se préoccupait pas de la réussite à 100 % ; on laissait ça à ceux qui cherchaient des excuses pour ne pas se lancer dans l’action. Lutter et apprendre, apprendre et lutter, c’était le mot d’ordre des anarcho-syndicalistes espagnols. Le 19 juillet, quand, dans une grande partie du pays, ils prirent le dessus sur les hordes fascistes, les anarcho-syndicalistes furent également les réorganisateurs d’une société que le capitalisme avait ruinée. Là était la preuve de la justesse de leur choix.
Hors d’Espagne, la plupart des travailleurs étaient prêts à soutenir moralement et économiquement les Espagnols ; cependant, ils ne réussirent pas à atteindre le même niveau de conscience de classe et de militantisme. Instinctivement, ces ouvriers sentaient que la guerre d’Espagne ne concernait pas seulement l’avenir de ce pays, mais aussi leurs propres perspectives d’avenir. Idéologiquement et dans leurs organisations, ils restaient prisonniers des liens qui unissent oppresseurs et opprimés, prisonniers qu’ils étaient des grossiers intérêts gouvernementaux, liés malgré eux aux ennemis du socialisme. Le jeu de dupes à propos de la non-intervention des États démocratiques et fascistes fut bien plus fort que la solidarité réelle exprimée au grand jour.
Il est certain que les travailleurs d’Espagne comptaient sur un soutien plus ferme des camarades des autres pays. La déception fut grande pour eux, d’autant plus que, de leur côté, les franquistes espagnols ont très largement profité de la solidarité fasciste internationale. Pour autant, on n’avait quand même pas complètement perdu tout espoir quant à une libération sociale des travailleurs européens par eux-mêmes, qui se seraient unis dans un même front de lutte contre les partis politiques et le poids des traditions.
Pourquoi je suis parti en Espagne
Marin et espérantiste, j’ai rencontré, en divers endroits, pas mal de camarades anarchistes et anarcho-syndicalistes espagnols. Leur enthousiasme pour la cause m’avait fortement impressionné. Partout, il y avait des volontaires prêts à s’engager : pour diffuser un journal illégal, pour organiser, après l’expulsion de leurs locaux, une réunion syndicale dans une rue pleine de policiers, ou lorsqu’il s’agissait de choisir les moyens adéquats pour appuyer une revendication lors d’un conflit avec les patrons.
La CNT, centrale anarcho-syndicaliste, a généralement été obligée de travailler dans l’illégalité. On pourrait presque dire que l’objectif principal des différents gouvernements espagnols a toujours été d’essayer d’étouffer cet important mouvement populaire anarchiste qui, au fil des ans, grandissait en nombre et en force. Si, pour nous, gens du Nord, la CNT en tant qu’organisation n’était pas très impressionnante, par la suite, les masses travailleuses espagnoles ont montré qu’elles adhéraient pleinement aux mots d’ordre de la CNT, et que les politiciens et gouvernements étaient toujours perdants.
Cependant, nombre de militants cénétistes ont enduré de grandes souffrances dans les geôles d’Espagne et du Maroc, ou sont morts dans la lutte. Quelquefois, la police a été jusqu’à copier les méthodes du Ku Klux Klan en organisant des équipes spéciales pour assassiner les militants les plus connus de la CNT ou de la FAI. C’est particulièrement à Barcelone que la CNT a fait l’objet d’acharnement de la part de ses bandes de pistoleros à qui la police fournissait insignes et ordres d’arrestation en blanc.
Bien sûr, la police niait ces agissements, déplorait ces actes et promettait des enquêtes, mais tout le monde savait à quoi s’en tenir. Les balles des mercenaires trouvaient l’homme à abattre même parmi la foule des travailleurs qui sortait des usines. Mais tout ceci fut vain : les capitalistes ont gaspillé leur plomb sans créer autre chose qu’une montée de haine contre cet « ordre » établi.
L’organisation des syndicalistes n’était pas bâtie sur le culte d’un leader unique : dès que quelqu’un de premier plan tombait, un autre le remplaçait sur-le-champ, et tout continuait comme avant. Si les autorités fermaient un local syndical, la nature environnante était prise pour salle de réunion. Rien n’arrêtait le travail de l’organisation. Journaux, affiches, manifestes, proclamations, décisions, tout était rendu public malgré les difficultés.
En 1934, peu après les « troubles » en Asturies, j’ai visité quelques villes dans le golfe de Biscaye. À Bilbao, je connaissais plusieurs camarades qui adhéraient aux Jeunesses libertaires, un mouvement de la jeunesse anarcho-syndicaliste. Je rencontrais ces camarades dans la rue, en haut de la ville, dans les quartiers ouvriers. Je les reconnaissais de loin, ils formaient un groupe en discussion sur quelque importante question. Ce qui était vrai. Leurs locaux venaient d’être fermés et ils se demandaient comment ils pourraient dans ces conditions continuer la propagande. Je ne pus m’empêcher alors de jeter un coup d’œil derrière moi et vis deux policiers à cheval, bien armés, qui nous escortaient. Un des camarades m’expliqua en riant que les autorités désormais assuraient le bon déroulement de la réunion. Après la fermeture des locaux, ces jeunes se sont divisés en petits groupes, chacun envoyant un représentant à des réunions dont les plus importantes ne pouvaient avoir lieu que dans des endroits cachés dans la montagne.
Dans la soirée, nous avons parlé des événements des Asturies. En 1934, il y avait eu des grèves en plusieurs endroits du pays à cause de l’orientation de plus en plus réactionnaire du gouvernement. Dans les Asturies, la grève a tourné à l’insurrection, et les travailleurs de la CNT ainsi que ceux de l’UGT, la confédération réformiste, se sont unis et ont occupé villes et villages.
Ce mouvement fut réprimé par les troupes gouvernementales avec des moyens incroyablement cruels. Entre autres, ordre avait été donné de ne pas faire de prisonniers et, ici, en Asturies, on a pour la première fois utilisé des Maures contre les travailleurs espagnols.
Dans la ville d’Oviedo, les travailleurs ont réussi à tenir leurs positions pendant environ une semaine et ce malgré un bombardement intensif comparable à ceux que subissent aujourd’hui beaucoup de villes. Les troupes gouvernementales ont bombardé du ciel, de la mer et de la terre, de telle sorte qu’une grande partie de la ville ne fut plus que ruines. Après les combats, il a manqué à l’appel des dizaines de milliers de travailleurs : ils avaient succombé ou étaient internés dans des prisons flottantes.
Quand, devant les camarades de Bilbao, j’ai déploré cette déroute du mouvement, les camarades m’ont expliqué qu’il ne s’agissait nullement d’une défaite. Car, ici, en Asturies, les travailleurs ont compris que la lutte devait être commune et passer par-dessus l’adhésion à tel ou tel parti et par-dessus tout ce qui les différenciait quant aux détails. Le travail de la CNT pour un front commun de tous les travailleurs révolutionnaires n’a pas été vain. La défaite en Asturies venait du fait qu’on n’avait pas fait la même chose ailleurs. Lors de la lutte finale contre le capitalisme, lutte qui ne manquerait pas de venir, cette répétition générale en Asturies aurait une valeur inestimable.
Que, le 19 juillet 1936, les travailleurs d’Espagne aient réussi à déjouer les plans des instigateurs des révoltes fascistes ne m’étonnait donc pas. J’étais, à ce moment-là, en mer, et ce n’est pas sans émotion que nous avons écouté le peu d’informations qui nous parvenaient par la radio. Dans les ports, nous lisions des journaux en langues étrangères qu’aucun de nous n’aurait osé auparavant déchiffrer, mais nous réussissions toujours à en comprendre une partie et, quand les travailleurs triomphaient, notre joie était sans bornes.
En octobre, nous étions sur la route du retour, dans le nord de l’Atlantique, lorsque la radio a commencé à verser du fiel dans la coupe de notre joie. Les informations du jour racontaient comment les fascistes avaient battu l’armée prolétarienne sur le front de Madrid et comment ils s’approchaient peu à peu de la ville. On avait l’impression que cette dernière allait capituler, mais c’est à ce moment-là que des démentis sont arrivés : la distance entre les fascistes et Madrid grandissait au fur et à mesure des nouvelles informations. Nous avons repris espoir et pensé avoir été trompés par ceux qui cherchaient à désespérer nos attentes et à ruiner le courage des amis de l’Espagne antifasciste.
De retour au pays, j’ai quitté la marine et me suis posé la question d’aller en Espagne ou d’essayer de faire quelque chose en Suède. J’avais compris qu’en Espagne on avait surtout besoin d’armes et de techniciens militaires. Les volontaires ne devaient pas manquer. Mais, par la presse, j’appris que les travailleurs, parallèlement à la guerre, avaient aussi commencé une collectivisation des terres, de l’industrie et des autres secteurs. Le désir de me battre à côté d’eux et la possibilité de participer à l’effort de reconstruction est devenu trop fort. J’ai aussi appris qu’un de mes camarades s’était enrôlé dans une colonne anarchiste et j’ai pensé qu’on trouverait bien un fusil pour moi aussi. Les papiers et les billets nécessaires acquis, j’ai quitté la Suède en décembre 1936.
L’arrivée en Espagne
Par une belle journée de janvier, avec un soleil brillant au-dessus de la Méditerranée bleue, je suis arrivé à Barcelone avec quelques camarades rencontrés à Paris. Pour un socialiste, c’était une arrivée merveilleuse. Toute la ville était ornée de drapeaux noir et rouge et de drapeaux rouges. Sur les bus, les voitures, les trams et autres moyens de locomotion, on pouvait voir briller les initiales de l’organisation qui avait collectivisé tout cela. Les lettres CNT montraient que les travailleurs étaient fiers de leur organisation ; les lettres AIT témoignaient que les travailleurs n’avaient pas oublié l’internationalisme ni le syndicalisme international.
Ces dernières initiales rappelaient aux travailleurs des autres pays que la section espagnole luttait ici pour une cause commune à tous.
Partout, il y avait des syndicats. On voyait de vrais palais remplis de gens heureux de travailler et dont les « propriétaires » s’étaient empressés de se mettre en sûreté avec leur fortune. Dans les salles et dans les halls où vivaient auparavant des bourgeois dégénérés, il y avait maintenant une activité fébrile. Les machines à écrire crépitaient envoyant de véritables fanfares vers les plafonds décorés, et les documents de l’organisation s’éparpillaient sur les tables et les canapés. Des pancartes au-dessus des portes indiquaient les différentes sections de métier ou annonçaient qu’il y avait là un « ateneo libertario ». Un athénée libertaire est à la fois un endroit pour se réunir et pour apprendre. C’est une école pour les jeunes et un facteur très important dans l’éradication de l’analphabétisme. On peut le comparer avec notre ABF suédois (Arbetarnas bildningsförbund, l’association pour l’éducation des travailleurs), sauf que ces athénées sont plus particulièrement liés aux organisations de jeunesse révolutionnaire.
Dans une grande rue, qui porte le nom de Buenaventura Durruti, l’anarchiste combattant pour la liberté et aimé de tous les antifascistes, se trouvait le quartier général des anarcho-syndicalistes catalans. La maison de la CNT-FAI était un monumental palace exproprié qui avait appartenu, avant, au syndicat patronal. Les comités régionaux de la CNT et de la FAI y étaient installés.
Cette dernière, la Fédération anarchiste ibérique, était auréolée d’un mystère à cause de sa lutte fantastique contre la soumission et l’exploitation. Le gouvernement et la police ont combattu désespérément pour l’anéantir, mais n’ont jamais réussi à prendre les « responsables ».
Un petit appel de la FAI était toujours suffisant pour mobiliser les masses et les informer alors que, à l’étranger, beaucoup doutaient de l’existence de cette organisation : personne n’ayant jamais pu entrer en contact avec un quelconque leader.
Au centre CNT-FAI, il y avait aussi les comités régionaux des Jeunesses libertaires et ceux des Mujeres libres – femmes libres – ; cette dernière organisation eut pendant la guerre un grand succès. S’y trouvaient également les rédactions de nombreux journaux.
Les organisations anarcho-syndicalistes en Espagne ont connu alors un développement incroyable, et c’est avec des sentiments mêlés que je compare avec la situation antérieure. Je me rappelais que pendant toute son existence jusqu’au 19 juillet 1936, la Jeunesse libertaire avait été obligée de travailler illégalement, et comment les camarades, il y a quelques mois encore, avaient des difficultés pour louer un petit local misérable pour leurs réunions. Maintenant, cette organisation de jeunesse comptait des membres par milliers et une activité gigantesque dans tous les domaines.
Sur le front d’Aragon
Je n’étais pas venu en Espagne pour faire du tourisme mais pour combattre les fascistes, je devais donc laisser à d’autres le soin de mieux connaître le travail des organisations catalanes et des collectifs industriels. Avec d’autres internationaux, je me suis inscrit dans une formation anarchiste dite la colonne Durruti et je suis parti pour le front.
Après un voyage agréable à travers la Catalogne, belle et bien cultivée, nous sommes arrivés dans l’Aragon, plus aride et montagneux. Puis, peu après, dans le village de Pina de Ebro, où se trouvait le quartier général de la colonne Durruti à cette époque.
Pina, un petit village paysan avec environ mille âmes, est situé sur la rive nord d’un fleuve, l’Èbre, qui, à ce moment-là, formait une frontière naturelle entre nous et les fascistes. Pina et les autres villages aragonais ne ressemblent pas à ce que nous [en Suède] appelons un village. Souvent, ces villages sont assez grands avec plusieurs milliers d’habitants. Les maisons sont collées les unes contre les autres le long d’étroites ruelles qui serpentent. Il y a rarement des écuries ou des étables pour les animaux domestiques, ceux-ci sont habituellement logés au rez-de-chaussée. Partout, il y a aussi des cheminées à foyer ouvert et des sols en terre battue.
Vu de loin, un tel village donne plutôt une impression de tristesse. Toutes les maisons sont d’un même ton gris, et l’œil ne rencontre pas la moindre petite tache de couleur à laquelle s’accrocher. En plus, d’une façon générale, il y a un ou plusieurs clochers qui couvrent ces villages de leur ombre et quelquefois un cloître avec une tour. Mais, arrivés dans le village, on est agréablement surpris par une vie fourmillante et populaire et par la joie de vivre de ses habitants. Les femmes, habillées de couleurs vives, portent des cruches d’eau et d’autres fardeaux sur la tête ; elles ont presque l’air drôle et, pour un peu, on se sentirait déplacé comme dans un contexte biblique.
Lorsque nous n’étions pas sur les premières lignes du front, nous étions hébergés dans de tels villages, et c’étaient les habitants qui nous nourrissaient. Les produits de base étaient bien sûr fournis par l’armée, mais c’étaient les paysannes qui cuisinaient. J’ai ainsi de nombreuses preuves de la façon gaie et généreuse dont chacune s’acquittait de sa tâche. Dans beaucoup de maisons, il y avait un membre de la famille au front. Dans ces conditions, la moindre des choses qu’on pouvait faire, c’était de prendre soin des miliciens qui passaient par là.
Dans la colonne Durruti, j’ai appartenu à un groupe international. La majeure partie des membres était des camarades d’Allemagne et de France, mais la plupart des autres pays européens étaient également représentés. À cause de la langue, nous étions divisés en deux groupes principaux : francophones et germanophones. J’ai atterri dans le groupe allemand où il m’était plus facile de comprendre et de me faire comprendre et où il y avait déjà un camarade suédois qui appartenait à la jeunesse syndicaliste.
Dans le groupe parlant allemand, on rencontrait des camarades révolutionnaires qui, avant et après la prise de pouvoir de Hitler en Allemagne, avaient lutté pour le socialisme. Quelques-uns avaient déjà passé plusieurs années en camp de concentration ; d’autres, comme des animaux pourchassés, fuyaient d’un pays « démocratique » à un autre ne pouvant abandonner la lutte pour la cause. On comprenait très bien la flamme révolutionnaire qui les animait ; ils allaient avoir l’occasion non seulement de rendre les coups mais aussi de surmonter leurs propres doutes dans la lutte contre tous ceux qui cherchaient à mettre en échec leurs tentatives révolutionnaires.
Parmi nous, il y avait plusieurs personnes âgées qui avaient participé à la Première Guerre mondiale et qui avaient une formation militaire. Ils devenaient naturellement nos officiers. Tous continuaient néanmoins à être des camarades sans vouloir porter des signes extérieurs distinctifs prouvant leur rang. Ils savaient que nous leur faisions confiance lors d’un danger et que quelques étoiles ou galons ne pouvaient en aucune façon augmenter notre respect pour eux.
Nous avions déjà reçu nos vêtements à Barcelone et, maintenant, on complétait notre équipement militaire avec fusil ou carabine, ceinture de cartouches, etc. Beaucoup d’entre nous avaient une instruction militaire qui laissait à désirer, mais ici nous avions un commandement professionnel. Les manœuvres étaient intensives et nous avons vite été considérés comme capables de faire face à n’importe quelle mission.
Il se passait cependant des temps assez longs pendant lesquels nous ne faisions rien d’autre que des patrouilles de reconnaissance et des petites opérations. Sans arrêt, nous nous demandions pourquoi on ne nous envoyait pas vers Saragosse et, rapidement, nous nous sommes aperçu que les troupes sur cette partie de la ligne de front n’étaient par suffisamment armées pour une telle offensive. Saragosse était un des points stratégiques du combat en Espagne et, pour des attaques décisives contre la ville, nous aurions eu besoin d’une grande quantité d’artillerie et d’avions qui manquaient. Nous comprenions bien sûr les difficultés qu’avait le gouvernement central à fournir suffisamment d’armes sur tous les fronts, qu’il fallait les concentrer autour de Madrid, la ville qui pour nous tous représentait la priorité. Mais, d’un autre côté, nous ne pouvions pas ne pas penser qu’on commettait une erreur tactique grave en ne prêtant pas attention aux différentes lignes du front aragonais. Une offensive ici dans l’Aragon aurait naturellement amené un très grand soulagement non seulement pour Madrid mais également sur les fronts asturiens et basques.
Nous maintenions cependant notre bonne humeur, et chacun faisait son devoir même si les résultats n’étaient pas convaincants ou n’apparaissaient pas dans la presse mondiale. Les fascistes étaient repoussés et, de temps en temps, nous leur prenions une position ou un petit village. Des rumeurs circulaient sans arrêt : une grande offensive allait avoir lieu ici dans le haut Aragon, et bientôt nous aurions des avions et de l’artillerie. Ces rumeurs entretenaient bien sûr l’espoir et maintenaient l’envie de se battre.
Nous étions encore loin de penser que le gouvernement, à cause des intérêts propres aux partis, nous refuserait délibérément des armes. Nous savions cependant que les troupes anarchistes en Aragon n’étaient pas vues d’un bon œil en haut lieu ; ces troupes anarchistes qui étaient la garantie de la continuation des collectivités des travailleurs catalans et aragonais ; ce qui, évidemment, était une épine dans le pied de ces partis qui, par les actions directes dans le domaine économique, sentaient leur propre existence menacée.
Les travailleurs syndicalistes, et aussi les réformistes, réclamaient une révolution sociale en échange du sang versé dans la lutte contre le fascisme. Rappelons que les chefs des partis n’avaient pas réussi eux-mêmes à organiser la résistance le 19 juillet. Ce sont les travailleurs qui l’avaient fait et, en plus, ils avaient occupé et organisé les plus importants centres de production. Ils n’allaient pas maintenant se laisser déposséder par ces chefs qui, peu à peu, refaisaient surface. Il allait de soi que les travailleurs ne pouvaient pas non plus écouter les conseillers étrangers qui avaient déjà trahi et ouvert le chemin du fascisme. Après la fuite des patrons, qui avaient tout laissé à la dérive, on savait que la collectivisation devait durer pour maintenir la production et, si possible, l’augmenter. On savait aussi que seule la collectivisation pouvait donner de l’enthousiasme aux jeunes travailleurs des fronts, enthousiasme nécessaire pour compenser le manque d’armement face à un ennemi incroyablement supérieur.
Jamais nous n’avons pensé que notre projet de lier guerre et révolution allait être boycotté. Nous n’avons pas non plus pensé un seul instant que la position pas très active qu’on nous faisait tenir en Aragon allait devenir objet de dénigrement de la part de ceux qui connaissaient parfaitement la situation. Ces troupes avaient quand même nettoyé Barcelone d’une armée fasciste et, ensuite, sous la direction de Durruti, avaient chassé ces mêmes fascistes de Catalogne et conquis la moitié de l’Aragon. L’offensive ne s’arrêta qu’aux portes de Huesca et de Saragosse, après le rappel de Durruti et de milliers de Catalans pour aller défendre Madrid et après qu’il fut évident qu’il nous aurait fallu des armes lourdes. Contrairement à tout ce qui se racontait, l’offensive des anarchistes catalans de l’été 1936 est peut-être la plus grande victoire enregistrée par des troupes antifascistes pendant cette guerre.
Je raconte plus loin quelques épisodes de ce que j’ai vécu et les circonstances qui expliquent pourquoi, pendant un certain temps, on parlait de « trêve » sur le front d’Aragon. Ceci peut sans doute clarifier des incompréhensions quant à la situation sur des lignes de front restées sans gloire ; gloire que seul le témoignage des « écrivains mercenaires » au service des chefs de parti pouvait apporter.
Avion ! Avion !
Puisque le mauvais équipement ne permettait pas d’effectuer souvent des manœuvres importantes, il y avait à la place des petites offensives à l’improviste. Se faufiler, à la faveur de la nuit, vers les positions ennemies et y créer la surprise en jetant des grenades, était une tactique souvent utilisée.
Une nuit, une compagnie qui avait comme d’habitude avancé à l’aide de grenades à main put conquérir une position en haut d’une montagne : une compagnie fasciste qui tenait les lieux et ses officiers furent faits prisonniers. Nous, le groupe international, avons reçu l’ordre de remplacer les camarades espagnols qui avaient eu des pertes et nous nous préparions à une contre-attaque éventuelle des fascistes. Nous arrivâmes vers midi, et les camarades nous recommandèrent chaudement de tenir la position qui avait déjà coûté beaucoup de sang. Nous promettions de faire de notre mieux, mais nous nous trouvions assez mal équipés pour ce faire car la compagnie ne possédait pas une seule mitrailleuse.
La tranchée montait en lacets au-dessus de la crête de la colline devant un bâtiment en pierre, un ancien ermitage. Les fascistes tinrent la position toute la journée avec un feu d’artillerie et, pendant que nous étions à l’abri derrière la colline, quinze à vingt camarades se sont détachés pour avancer et consolider les tranchées.
Quelquefois, l’artillerie fasciste réussissait un coup de plein fouet dans l’ermitage qui faisait voler gravier et pierres, mais après disparition de la poussière et de la fumée, nous voyions nos camarades continuer leur travail inlassablement.
Vers la fin de la journée, nous reçûmes l’ordre d’avancer. Cela posait beaucoup de difficultés sous le feu nourri de l’artillerie, et chaque groupe devait choisir son chemin et la meilleure manière de monter.
Le groupe auquel j’appartenais avait disposé quelques hommes dans un poste d’observation, et nous devions faire un détour pour les récupérer. Nous étions à peine arrivés dans un chemin encaissé qu’une série de grenades éclataient entre nous et l’ermitage. Dans le chemin creux, nous étions à peu près protégés mais, après une minute, pendant un arrêt du feu, nous avons essayé, en courant, d’atteindre la tranchée.
Il ne nous restait qu’environ cinquante mètres pour être en sûreté. C’est alors que nous entendîmes les cris : « Avion ! Avion ! » Et voilà qu’ils étaient déjà au-dessus de nous. Nous avions tant fixé notre attention sur le feu d’artillerie que nous n’avions pas aperçu les avions. Cinq gros bombardiers à trois moteurs et une nuée d’avions de chasse et, déjà, les premières bombes sifflaient au-dessus de nos têtes. J’étais avec deux garçons de Stockholm, Andersson et Norrblom, et tout de suite après les cris d’avertissement nous avons pris position là où nous étions. Norrblom, un gaillard avec de grandes jambes, était une dizaine de mètres devant nous.
Essayer de raconter ce qui s’ensuivit est presque au-dessus de mes possibilités. Chaque avion lâchait une rangée de bombes ; et, comme il y avait d’abord trois avions en première ligne et deux autres derrière pour remplir l’espace libre, les explosions étaient très rapprochées. La plupart des impacts se trouvaient entre l’endroit où nous nous trouvions et la tranchée, mais nous entendions également des explosions derrière nous. Même les avions plus petits jetaient des bombes. Pendant un temps, les tirs se sont concentrés entre nous et Norrblom. Un des garçons de Stockholm exprima exactement alors ce que nos pensions tous : « Norrblom est sûrement parti en enfer ! »
L’air rempli de fumée et de poussière rendait la vue impossible et, quelques instants plus tard, tout recommença. Terre, gravier, pierres, buissons et petits arbres nous tombaient dessus, et je ne pouvais plus distinguer quoi que ce soit. Cela se répéta quatre à cinq fois, et nous étions tout étonnés d’être encore en vie alors que les avions faisaient une manœuvre que je n’avais encore jamais vue. Ils jetaient des bombes incendiaires sur les pentes et comme celles-ci étaient couvertes d’herbe sèche et de petits buissons il y eut rapidement un océan de feu. Le feu se propagea très rapidement et arriva bientôt à la tranchée où buissons et végétation employés comme camouflage s’enflammèrent.
Les hommes furent rapidement obligés de partir. Battre en retraite devenait nécessaire et nous avons réussi à traverser les flammes et à descendre la colline sans être repérés.
Là où nous étions, nous avons vu comment les avions de chasse, qui descendaient très bas, poursuivaient les hommes en les mitraillant sur les pentes en feu. Impuissants, nous avons ensuite vu comment les fascistes de l’autre côté de la colline traînaient des mitrailleuses jusqu’en haut au fur et à mesure que l’incendie diminuait. Nous ne pouvions qu’essayer d’entrer en contact avec les autres camarades. Nous sommes alors tombés sans crier gare sur Norrblom qui était bien vivant.
Nous étions tous très étonnés puisque lui aussi avait cru que nous étions tous « passés de l’autre côté ».
Quand nous nous sommes retrouvés sur les anciennes positions, il y avait beaucoup de vides dans nos rangs et beaucoup de visages manquaient. C’est grâce à la forêt qui poussait ici et qui nous cachait suffisamment que les fascistes n’ont pu nous atteindre tous. Nous n’avons pu faire que la constatation amère qu’il est impossible de se battre contre des avions et des bombes incendiaires avec seulement quelques vieux fusils. Si seulement on nous avait accordé suffisamment de temps pour préparer des abris, ils auraient pu nous jeter encore des tonnes de bombes. Nous aurions alors été fin prêts pour recevoir l’infanterie fasciste si elle nous avait attaqués.
Cet événement n’est pas isolé, c’est ainsi que cela s’est passé presque partout en Aragon. Il n’était guère possible d’avancer, car ce que nous réussissions à conquérir par nos incursions inattendues de nuit était détruit le lendemain par l’aviation fasciste. Ceci a causé énormément de pertes en vies humaines, mais là où nous avons vraiment pu nous incruster, personne ne reprenait nos lignes, ni Maures ni Aryens.
Nous savions pourtant que nous n’étions pas complètement sans aviation car nous avons été les témoins de raids nocturnes sur les positions militaires autour de Saragosse. Il a cependant fallu attendre longtemps avant que ces avions reçoivent enfin l’ordre de soutenir nos offensives. Cela nous a remplis peu à peu d’indignation, d’autant plus que nous étions parfois, de nos postes d’observation, les témoins obligés de la façon dont les escadrilles fascistes pouvaient, impunément, bombarder les villages aux alentours.
Attaque
Un jour, on nous a commandé de nous préparer pour une marche. Sur la route, en dehors du village, il y avait des bus ; et nous voilà partis, personne ne savait où. Cela ne nous a pas particulièrement étonnés puisque, en tant que troupe d’appoint légère, nous étions habitués à nous retrouver en différents endroits. Dans les villages que nous traversions, les habitants qui travaillaient dans les champs nous faisaient le salut antifasciste. Dans les ruelles des villages, on entendait « ¡ Salud Compañeros ! ¡ Viva la FAI ! ¡ Muerte a los fascistas ! » ; et nous répondions de notre mieux : « ¡ Viva la Confederación ! ¡ Viva la revolución social ! »
Au crépuscule, nous nous sommes arrêtés dans un village où nous avons appris que nous n’étions pas loin de Huesca, la capitale de la province du même nom. Après un repas, nous avons quitté le village à pied pour occuper une tranchée pendant la nuit. Au loin, on entendait un feu nourri. La bataille concernait la route entre Saragosse et Huesca, et une attaque était attendue. Sous une pluie battante, nous avons donc monté la garde toute la nuit sans voir l’ombre d’un seul fasciste.
Le jour suivant, nous devions relever une compagnie se trouvant sur un des sommets dans la montagne. Après une montée fatigante, nous sommes enfin arrivés au sommet et nous avons pu nous reposer un peu en attendant que les camarades que nous remplacions se préparent au départ.
Le repos n’a pas duré. Un couple d’avions de reconnaissance est apparu suivi peu après de quelques chasseurs qui ont tiré sur nos lignes, ici et là. La compagnie que nous remplacions ne pouvait plus quitter la position et a décidé de rester jusqu’à la nuit. Il y avait donc beaucoup de monde dans les tranchées.
Puis il y eut d’autres avions, l’artillerie se fit entendre, et pas mal de « morteros » ont sifflé au-dessus de nous. Une fusillade nourrie venait aussi des tranchées fascistes. Plutôt que d’attendre une attaque, il valait mieux que nous attaquions nous-mêmes et, soudain, on a entendu : « ¡ Arriba ! ¡ Arriba ! », et nous nous sommes précipités hors de la tranchée. Et comme nous étions, à ce moment-là, une garnison double, il y eut quelques bousculades, mais nous avancions.
Il y avait dans notre groupe une Espagnole qui se trouva parmi les premiers à sortir. Elle était habillée d’un pantalon et d’une veste en cuir, mais elle avait perdu sa casquette, et sa grande chevelure noire flottait dans le vent. Avec des yeux de feu, elle est sortie de la tranchée en criant : « ¡ Compañeros, arriba, al ataque ! ». Pour elle, ainsi que pour beaucoup d’autres camarades, ce fut la dernière attaque.
Entre nous et les fascistes, il y avait une petite colline étirée qui représentait pour nous une sorte d’étape. Avec le camarade de Stockholm dont j’ai déjà parlé, Norrblom, avec notre délégué politique, Michel, et avec quelques Allemands et Espagnols, je me suis trouvé attaquant du centre. Les deux autres Suédois, qui appartenaient à notre groupe, avaient, dans la cohue, été obligés de se diriger vers les côtés.
Arrivés en haut, nous avons ouvert un tir nourri sur les positions des fascistes ; leur feu s’est arrêté, et nous n’avons pas tardé à les voir quitter leur tranchée et disparaître de l’autre côté de la colline. Nous avons encore avancé pour occuper bientôt leur tranchée. Nous y avons trouvé quelques morts, quelques fusils, des appareils de signalisation et, ce qui nous arrangeait bien, du tabac qui nous manquait.
Cependant, les fascistes ont commencé alors, à l’artillerie, à pilonner leur ancienne position. En même temps, il y avait les avions. Ils ont d’abord fait taire notre propre artillerie et, bientôt, ont été au-dessus de nos lignes. Nous avons compté jusqu’à dix-sept gros avions qui ont commencé leur carrousel – comme nous disions – au-dessus de nous. C’est-à-dire qu’ils volaient en rond et pouvaient ainsi bombarder nos positions sans arrêt et partout. Cela a causé pas mal de morts dans nos rangs, et nous avons attendu avec impatience nos propres avions. En effet, plusieurs camarades attestaient les avoir vus au début de l’attaque [1] . Notre attente fut cependant vaine et, pendant ce temps-là, les fascistes ont progressé, et les impacts étaient de plus en plus précis.
Aux endroits les plus exposés, nos garçons ont commencé à se replier et ont cherché à rejoindre nos anciennes positions qui, d’ailleurs, étaient plus faciles à défendre. Notre délégué politique, Michel [2] , qui donnait les ordres chez nous, a fini par nous dire de lâcher prise. De rage, il avait les yeux pleins de larmes.
Sur la pente de la montagne, nous sommes arrivés jusqu’à un mur de pierre où quelques camarades s’étaient arrêtés en attendant la fin du bombardement. Mais ce dernier augmentait en intensité et, comme les fascistes connaissaient chaque pouce du terrain, c’était comme s’ils pouvaient évaluer leurs coups au millimètre près. Nous avons recommencé à battre en retraite, mais beaucoup de camarades ne pouvaient plus suivre. Chaque impact touchait quelques Espagnols ou des internationaux. À un moment, j’ai essayé avec d’autres camarades d’emmener un blessé sur un morceau de bâche. Il est mort cependant, de même que celui qui tenait la bâche de l’autre côté.
Nous avons continué vers nos retranchements jusqu’à ce que les explosions nous en empêchent. Couché, je comptais les impacts qui s’approchaient de plus en plus, j’avais prévu que le prochain tomberait tout près de moi ; soudain, j’ai senti un coup sur la tête.
Je croyais bien être parti pour l’autre monde, mais je repris connaissance au bout d’un certain temps. Bien qu’étourdi, j’ai réussi à atteindre nos tranchées où j’ai reçu les premiers soins. J’avais perdu un œil et reçu un éclat au front.
Les hommes racontèrent plus tard que le bombardement avait continué tout l’après-midi et que nous avions de grandes pertes en morts et en blessés. Les fascistes n’ont cependant pas réussi à occuper nos positions. On sait maintenant, une fois pour toutes, que leur spécialité n’est pas d’attaquer les armes à la main, mais de pilonner d’en haut des positions et des villages sans défense aérienne.
À l’hôpital
Moi-même et les autres blessés avons reçu les soins nécessaires à l’hôpital d’un village proche et puis nous avons été évacués, par étapes, de la proximité du front. Cela parce qu’on avait besoin de places pour les blessés proches du front mais aussi parce qu’on savait que l’aviation de Franco adorait particulièrement tirer sur les hôpitaux. Un épisode : à environ un kilomètre derrière le front, alors qu’un soignant était en train de panser notre sergent à côté d’une ambulance marquée d’une croix rouge, un chasseur fasciste a surgi au-dessus d’eux en laissant les mitrailleuses cracher leur feu. Le soignant a été atteint à la poitrine par une balle dum-dum qui lui a déchiré le dos en entier.
Après avoir été trimballé d’un hôpital à un autre d’où je n’ai que des souvenirs confus de mains secourables et de grandes salles remplies de lits, j’ai atterri dans la petite ville méditerranéenne de Tarragone.
C’était un hôpital de guerre installé dans un ancien séminaire catholique. Un grand et magnifique bâtiment occupé depuis la révolution. Ses grandes salles et ses longs couloirs étaient particulièrement bien adaptés pour fonctionner comme hôpital.
Les médecins se conduisaient en camarades et faisaient sans doute de leur mieux. Leur charge de travail était considérable lorsque arrivaient de grands groupes de blessés gravement atteints. Les infirmières étaient, pour la plupart, des filles des organisations des jeunes travailleurs qui, lorsque leur père, leur frère ou leur fiancé avait rejoint le front, se sont enrôlées dans les services de santé. C’était des filles épatantes qui, d’une façon prévenante, accédaient à nos désirs, souvent même avant qu’ils ne soient exprimés.
Partout dans ce grand hôpital régnait la propreté, et la literie était impeccable avec des dessus de lit blancs. La nourriture était abondante, même si parfois il y avait des plats qui paraissaient curieux pour un homme du Nord.
Tout fonctionnait très bien sans le moindre commandement militaire. Tout ceux dont les blessures ne les clouaient pas au lit avaient le droit de sortir en ville dans la journée. Sur les ramblas ou tout au long de la promenade de la plage, on voyait de longues rangées de miliciens avec des cannes ou des béquilles qui, après être restés au lit et avoir subi des opérations, prenaient des bains de soleil et respiraient l’air de la mer. Beaucoup, beaucoup trop de camarades ont payé tribut sous forme d’un bras ou d’une jambe, mais on n’entendait jamais personne se plaindre.
Je me souviens particulièrement d’un camarade espagnol qui avait perdu son avant-bras droit. Il était toujours gai et ne parlait que du moment où il irait dans son village en Aragon pour voir où en était la collectivisation pour laquelle lui et les autres avaient tant donné.
« Si les travailleurs des autres pays avaient compris que la révolution sociale était nécessaire pour combattre le fascisme mondial, nous n’aurions pas eu à lutter seuls. Maintenant, au moins, nous donnons un exemple au prolétariat du monde entier. »
Ainsi parlait ce camarade, et c’était l’opinion de tous ceux que j’ai rencontrés au front.
Provocation !
Un matin, il y eut une certaine agitation dans ma salle. De la ville arrivaient des bruits de fusils et de mitrailleuses. Des camarades qui s’étaient précipités dans la cour remontaient et racontaient que la porte avait été fermée et qu’on ne laissait sortir personne. Nous n’avions pas la moindre idée de ce qui se passait au dehors, et les suppositions allaient bon train. Tarragone n’est pas une ville à dominante ouvrière car il y a peu d’industrie. Les organisations des travailleurs n’étaient donc pas aussi fortes qu’ailleurs, et nous nous demandions s’il pouvait s’agir d’une attaque d’une faction fasciste demeurée sur place.
Plusieurs camarades parlementèrent alors avec le médecin principal pour sortir car ils se croyaient suffisamment guéris pour tenir un fusil, mais le médecin refusa net. Le lendemain, la porte était de nouveau ouverte et nous sommes allés en ville.
Devant la maison de la jeunesse libertaire bien connue, il y avait des policiers en armes et le grand drapeau noir et rouge avait été arraché. Devant les fenêtres et sur les balcons, il y avait des sacs de sable comme protection et, sur les murs, on voyait les dégradations causées par des balles. Plus loin, dans la rue, où se trouvaient la poste et le central téléphonique jusqu’alors contrôlés par la CNT, c’était le même scénario. Il n’y avait plus de fenêtres, et le crépi des murs ressemblait à une passoire. Nous ne comprenions toujours rien. Il a dû se passer des choses graves pour qu’on puisse ainsi s’attaquer à cette organisation catalane qui avait le plus donné dans la lutte anti-fasciste. Nous n’avions toujours pas compris que nous étions les témoins d’une des provocations les plus odieuses, mise en scène par un « parti ouvrier » qui, même en pleine guerre contre le fascisme, ne laissait pas tomber ses intérêts particuliers peu avouables. Ce n’est que plus tard, en apprenant les abus de pouvoir commis contre les travailleurs de Barcelone et d’ailleurs, que nous avons compris cette abominable vérité.
Depuis quelque temps, en Espagne, une certaine méfiance s’était installée entre les organisations de lutte économique des travailleurs et des éléments de la bourgeoisie, soutenus et quelquefois dirigés par les instances du parti communiste. Les travailleurs qui, au début de la guerre, s’étaient empressés de collectiviser les plus importants moyens de production, faisaient maintenant l’objet de contestation de ce côté-là. Les communistes et les bourgeois, tout en parlant sans cesse d’unité et de la lutte contre le fascisme, n’arrêtaient pas d’entraver l’activité des collectivités et, même dans certains cas, comme dans la région de Madrid, des collectivités avaient été violemment détruites. Des escarmouches avaient eu lieu et, habituellement, les travailleurs cédaient, sachant qu’une lutte derrière le front ne pouvait qu’apporter de l’eau aux moulins des fascistes. Mais les pontes brevetés qui se sont mis à la tête des travailleurs n’avaient que faire de tels arguments. Ils n’allaient pas tarder à prendre l’offensive, même en Catalogne, le centre des conquêtes sociales.
Des forces de police renforcées et des formations communistes se montrèrent en Catalogne vers la fin avril. De partout arrivaient des rapports concernant leurs incursions dans les collectivités : des comités de travailleurs avaient été dissous, et des travailleurs avaient été empêchés d’exercer leur influence sur beaucoup de questions importantes.
Le 3 mai, des troupes de police étaient envoyées sur le central téléphonique de Barcelone. Rodríguez Salas, commandant de police et communiste, a alors, sans doute à l’insu du gouvernement central, essayé d’enlever aux travailleurs le contrôle de ce bâtiment important. Cette maison, située Plaza de Cataluña, était sous double contrôle de la CNT et de l’UGT, l’organisation réformiste. Salas, le stalinien, exigeait le pouvoir sur cette maison : c’était le gouvernement qui avait la responsabilité de ce central, et des preuves attestaient la présence d’espions fascistes qui surveillaient les messages. Les travailleurs et les spécialistes qui s’étaient occupés du central depuis le début de la guerre ne voyaient pas pourquoi ils le donneraient à un officier de police arrogant. Il y eut échange de coups de feu. La police réussit à pénétrer au rez-de-chaussée mais les étages furent vaillamment défendus par les travailleurs.
Quand les ouvriers des usines et des ateliers ont entendu les coups de feu, ils ont réagi spontanément. Ils ont cru, comme nous avant à Tarragone, qu’il s’agissait d’un coup des fascistes, et ils se rendirent à leurs syndicats pour organiser la défense. Exactement comme le 19 juillet 1936, on a dépavé les rues pour faire des barricades. J’ai, plus tard, parlé avec beaucoup d’Espagnols et d’internationaux qui étaient sur ces barricades du 3 au 6 mai, et ils ont tous raconté comment les travailleurs ont spontanément pris les armes pour défendre leurs conquêtes. Sur certaines barricades, il y avait des membres de la CNT et de l’UGT, sur d’autres la CNT et le POUM ou bien l’UGT et le POUM. En quelques endroits, même la police se montrait solidaire.
Ces troubles ont duré quelques jours, mais le but des communistes avec cette provocation n’a pas été complètement atteint. Ils avaient espéré pousser ainsi les anarchistes à la faute et trouver une raison pour dissoudre leurs organisations. Mais la CNT fut la première à rechercher la négociation, et c’est grâce à son sang-froid qu’une catastrophe a pu être évitée. Les staliniens, qui partout dans le monde trouvaient des voix pour dire que la CNT avait mis à mal et saboté l’unité antifasciste, n’ont même pas réussi à convaincre le gouvernement de Caballero de prendre des mesures contre les travailleurs qui, spontanément, se sont montrés prêts à défendre leurs acquis. La CNT-FAI de son côté - dont plusieurs camarades, même des invalides, ont été assassinés, comme par exemple Berneri qui était détesté pour ses opinions en faveur de la révolution sociale - a montré sa magnanimité en laissant cette provocation sans suite. La lutte contre le fascisme n’est pas qu’un vain mot pour les anarcho-syndicalistes ; en ce mois de mai, répondre aux provocateurs staliniens comme ils le méritaient aurait donné raison à Franco.
Le gouvernement Caballero est tombé quelque temps après les événements de mai, sans doute parce qu’il ne s’était pas plié aux exigences de Staline durant cette période. Un nouveau gouvernement se forme alors sous la direction de Negrin. Pour payer les armes livrées par l’Union soviétique, l’or n’est pas suffisant ; il faut, de plus, trouver des boucs émissaires aux événements de mai. Le POUM, un parti en concurrence avec les communistes, se trouve alors projeté sur le devant de la scène. Le POUM est dissous et ses dirigeants emprisonnés, accusés d’être de connivence avec Franco. Pourtant, un an après ces événements, on n’a toujours pas osé faire leur procès. On n’entend plus parler de l’arrestation des espions du central téléphonique de Barcelone. Tout cela n’était que provocation ignoble de la part d’un parti qui, un pays après l’autre, essayait d’instaurer sa dictature sur la classe ouvrière. Les destructions et le vandalisme insensés commis par les bourgeois, à Tarragone et ailleurs, contre les locaux ouvriers montrent assez clairement quelles classes et quels intérêts sont gagnants lorsqu’on monte les travailleurs les uns contre les autres. Que les bourgeois, les sociaux-démocrates et les staliniens se soient retrouvés ensemble à chasser des anarchistes après les événements de mai montre à l’évidence, en Espagne, qui était contre la révolution sociale et son représentant le plus conséquent, la CNT. Cette dernière, la seule force qui, pendant presque deux ans, a réussi à résister envers et contre tous.
Dans la collectivité
Dès ma sortie de l’hôpital, j’ai de nouveau essayé de servir au front ; les médecins me l’avaient déconseillé. J’y retournai cependant mais j’avais promis de revenir à l’arrière si mon état s’aggravait. Après un nouveau séjour d’un mois, j’ai compris que les médecins avaient raison. Vu mon état, cette vie était trop dure. Je suis retourné à Barcelone.
Au fur et à mesure de ma guérison, je me suis langui d’une occupation et j’ai commencé à me renseigner sur la possibilité de faire partie d’une collectivité. J’étais particulièrement intéressé par les collectivités rurales que j’avais vues pendant mon séjour au front. Kropotkine dit quelque part que si les travailleurs des industries ne réussissent pas à convaincre les travailleurs des champs de faire la révolution, celle-ci ne réussira pas. En Aragon, j’avais fait connaissance avec des paysans qui avaient la même conscience de classe que les travailleurs industriels et qui avaient, avec énergie, commencé à révolutionner la production agricole.
Le secrétariat du comité régional des collectivités de Catalogne m’a envoyé en Aragon où on avait grand besoin de main-d’œuvre. Je suis ainsi encore une fois parti dans cette région pour retrouver son peuple magnifique si épris de liberté, population que j’avais jadis appréciée et, j’ose le dire, aimée. Une nouvelle fois, le paysage catalan avec ses champs bien labourés et ses vignes bien alignées défilait devant mes yeux. Mes pensées allaient aux travailleurs d’Espagne qui, enfin, après des centaines d’années d’esclavage, commençaient à se libérer, à jouir des fruits de leur labeur. Si seulement la guerre était gagnée, pensais-je, le monde entier pourrait voir cette force créatrice, cette capacité constructive du peuple espagnol.
Parmi les voyageurs du train, il y avait des miliciens, des officiers en route pour le front après un jour de permission, des paysans revenant de la ville et puis d’autres. C’était une population variée, mais c’était comme une grande famille, et la conversation tournait inlassablement autour de la guerre et des collectivisations. À l’occasion, j’ai retrouvé un camarade espagnol que j’avais connu à San Criteria [3], où nous avions tant perdu des nôtres. Nous avons commencé à discuter de cette bataille, et des autres combats, et, finalement, nous sommes tombés d’accord sur le fait que nous avions fait pour le mieux en l’absence de notre aviation.
Nous sommes montés vers l’Aragon en traversant des tunnels longs de plusieurs kilomètres. Puis, nous nous sommes arrêtés dans une petite ville où une grande usine chimique, maintenant collectivisée, avait appartenu à une société allemande. Des avions allemands avaient essayé à plusieurs reprises de la détruire, sans y parvenir. Aux alentours, nombre de maisons en ruine témoignaient du carnage. Dans le train, hommes et femmes dressaient leurs poings : ils avaient appris ce qu’était le fascisme.
Plus les fascistes se conduisent en barbares, plus la population ressent intensément la nécessité de vaincre cette racaille qui se nomme nacionales. Les ouvriers et les paysans sont prêts à tout sacrifier pour la victoire qui apportera justice et sécurité et pour continuer jusqu’à la révolution sociale. Leur participation totale n’est pas négociable, en dépit des arguments dilatoires des partis politiques.
J’arrivai enfin à Caspe, capitale provisoire d’Aragon. Au comité régional des collectivités, j’ai rencontré un camarade d’un village proche et, bientôt, il fut décidé que je le suivrais. Le bus est entré dans le village de Fábara dans la soirée du jour suivant. Il s’est arrêté devant la boutique coopérative. Un employé de bureau catalan, qui avait perdu un bras lors de cette guerre, et moi avons été logés dans une maison dont le propriétaire fasciste avait fui avec sa famille. Après un copieux repas, l’heure était venue d’aller au bistrot de la collectivité. C’est là, autour d’une tasse de café, le soir, que se réunissaient les membres de la collectivité pour discuter des questions du jour. Je fus tout de suite accepté et baptisé « Rubio », puisque j’étais le seul du village à avoir des cheveux roux.
J’ai appris que le bâtiment où ce café était installé avait été construit par la collectivité. Les jeunes évitaient ainsi la fréquentation des autres bistrots et des bars privés ; de plus, ils avaient ainsi un endroit pour se réunir, discuter ou étudier. La grande salle servait aussi pour les réunions des membres du collectif et, de temps à autre, pour des séances de cinéma. Les murs étaient décorés d’affiches de propagande de la CNT-FAI qui montraient clairement les problèmes auxquels les travailleurs étaient confrontés.
Je devins vite copain avec le secrétaire de la Jeunesse libertaire, un partisan de ces idées, âgé de 16 ans, à qui les camarades plus âgés avaient confié la responsabilité du mouvement lorsqu’ils partirent au front. En sa compagnie, j’ai visité l’athénée libertaire, l’école de l’organisation et les locaux où l’on se réunissait. Un enseignement était en cours. Le point le plus important était la liquidation de l’analphabétisme qui était très répandu dans les campagnes, ce qui empêchait toute information. Tout cela était très sérieux, et les camarades plus expérimentés aidaient les autres. Quand ils ont su que je venais du Grand Nord, ils ont tout de suite montré leur intérêt, et il s’est avéré qu’ils avaient une assez bonne connaissance de la Scandinavie. Ils savaient presque tout des actions d’entraide par l’intermédiaire de la Soli (Solidaridad Obrera, le journal de la CNT) et par là qu’ils étaient au centre de nos intérêts. Les questions pleuvaient. Y a-t-il une jeunesse libertaire en Suède ? Quelle force a-t-elle ? Quelle est sa position par rapport aux organisations de lutte économiques ? Combien de journaux édite-t-elle ? Est-ce que les membres sont très actifs ? Etc. Mes réponses n’impressionnaient guère les jeunes, surtout pas les chiffres concernant les journaux et le nombre de membres. Par contre, les camarades plus âgés, qui savaient ce que la CNT avait subi, estimaient ces conditions assez bonnes. Surtout les contributions de la SAC en faveur de l’Espagne et celles de la Jeunesse syndicaliste qui étaient bien la preuve que la Suède avait fait ce qu’elle pouvait. J’ai expliqué de mon mieux que l’intérêt pour le syndicalisme dans la Scandinavie allait en grandissant mais que cela ne se traduisait pas encore au niveau des organisations ; cela à cause du comportement antisocial des organisations réformistes et des persécutions contre ceux qui avaient des opinions différentes. On m’expliquait que, avant, cela se passait comme ça aussi en Espagne. Les organisations réformistes et les partis politiques avaient maintes fois collaboré avec l’État pour combattre les anarcho-syndicalistes. Mais la CNT a toujours continué le combat et, ces dernières années, les relations entre les deux confédérations ouvrières du pays se sont améliorées. Pendant la guerre, cela a conduit à une fraternisation et à un travail en commun. Beaucoup de camarades portaient ainsi les insignes qui symbolisaient cet état de fait.
Avec une fierté particulière, on m’a montré la bibliothèque. Il y avait là une grande collection des œuvres anarchistes classiques, mais ne manquait pas la littérature moderne. Leur trésor était « El hombre y la tierra » d’Élisée Reclus – une géographie illustrée du monde en six grands volumes. Je sentais que j’allais me plaire ici à l’athénée libertaire.
Le matin suivant, un camarade nous a fait faire un tour pour connaître la collectivité. Elle était constituée d’activités très diverses. Les artisans du village étaient devenus membres de la collectivité qui possédait donc son atelier de menuiserie ainsi qu’une sellerie et une forge. Quelques ateliers d’extraction d’huile d’olive et un moulin électrique en faisaient partie. Après la révolution, on avait effectué des modernisations et des améliorations partout ; en plusieurs endroits, de nouvelles machines avaient été acquises pour mieux utiliser la force électrique.
Lors de notre inspection, nous sommes arrivés à l’église. Le clocher était presque à terre, des camarades étaient justement en train de terminer sa démolition. On m’a dit que ce serait le lieu de mon travail pour commencer. Ne fréquentant pas assidûment les églises, j’ai tout de même senti que ce travail me plairait.
Avec un milicien en permission, nous sommes alors montés sur le toit de l’église d’où on avait une vue merveilleuse sur les environs. Tout autour, on pouvait apercevoir les petites rues escarpées, serpentant comme dans un labyrinthe, avec des porches voûtés, donnant parfois une impression de style mauresque. Plus loin ondulait le paysage aragonais avec ses montagnes nues qui s’effritent et qui, à l’horizon bleuâtre, forment une chaîne imposante.
Ce qui animait ce paysage était le lit de rivière qui coulait vers les dernières maisons du village et qui, ensuite, après quelques creux, disparaissait derrière une énorme montagne de couleur rouge-marron aux formes étranges. Sur un des côtés du lit de la rivière grondait un ruisseau qui irriguait les environs. Il gonflait lors de la période pluvieuse et remplissait alors le lit tout entier pour devenir un fleuve majestueux. Pendant la période sèche, le ruisseau était alimenté par un immense réservoir que les paysans avaient construit dans les montagnes.
De la rivière ou du ruisseau, un système de canaux compliqué avait été construit. Dans cette région peu pluvieuse, les plantations de fruits et de légumes n’auraient pas survécu sans cela. Des deux côtés du fleuve s’étendaient, parfois sur des centaines de mètres de profondeur, des plantations immenses d’oliviers, source de revenus pour le village. Tout le monde sait que l’huile d’olive est un produit très important utilisé dans les ménages espagnols.
Sur une colline près du village, il y avait un vieux château, ou couvent, tombé en ruine lors d’anciennes batailles. Dans la verdure, au fond de la vallée, de l’autre côté du fleuve, on pouvait voir un petit édifice religieux en pierre avec des voûtes et des colonnades. Il était là depuis le temps des Maures, témoignant qu’on se trouve bien dans un lieu historique. Le destin de l’Espagne a été changeant et varié et, encore une fois maintenant, son peuple écrit une page nouvelle de son histoire.
En quittant le toit de l’église, le milicien m’a informé que nous devions désormais nous considérer comme membres de sa famille. Ce n’était pas une formule de politesse comme en Espagne auparavant. Nous n’avions qu’à amener nos affaires chez lui. Le maître de maison était le cordonnier de la collectivité et, en plus du fils en permission, un autre fils était sur le front. Sa maison venait d’être ravalée et décorée d’un ruban rouge et noir tout le long du toit. Le cordonnier était entré en révolte contre ce qui était vieux, gris et ennuyeux ; et voulait s’offrir quelque chose qui tranchait. On rencontrait d’ailleurs un peu partout dans le village de telles décorations, signe d’un renouveau après la révolution. Nous avons tout de suite été adoptés par la famille ; et la bru, María, s’est emparée sans tarder de nos vêtements pour vérifier s’il y avait quelque chose à laver ou à raccommoder. Elle savait que nous venions du front et supposait que nos affaires n’avaient pas été, depuis longtemps, entre les mains compétentes d’une femme.
Le travail commença le jour suivant après qu’on nous eut fait des recommandations sévères de ne pas nous surmener. J’ai d’abord déblayé des pierres à côté de l’église, c’était l’escalier menant à la sacristie déjà détruite que je faisais voler en éclats. C’était un travail réjouissant que d’enfoncer son levier sous des pierres qui pendant des siècles avaient été bien usées par des prêtres pâles et bouffis en soutane noire et par des femmes plus ou moins bourgeoises.
Les pierres de la sacristie et du clocher furent utilisées pour construire une usine d’extraction d’huile d’olive, usine plus grande en remplacement de trois anciennes trop petites et vétustes qui ne suffisaient plus aux nouvelles exigences de la productivité. On se sentait en train de faire quelque chose de tout à fait symbolique puisque, au fur et à mesure que le clocher baissait vers la terre, on voyait l’usine s’élever dans le ciel libre.
Peu après le 19 juillet, les villageois avaient d’abord pensé mettre le feu à l’église pour célébrer la révolution, mais la raison a gagné. On y a fait le ménage en enlevant les images pieuses et on a ainsi fait de la place pour ranger des choses, entre autres des barriques d’huile d’olive. Ils ont trouvé que la meilleure façon d’honorer la révolution était de rendre le travail plus efficace pour en tirer plus de produits. Malgré quelques difficultés avec la langue, tout se passait très bien et, quelques jours après, j’ai pu aider un « carretero ». Avec un étalon blanc et un mulet noir qui tiraient une charrue à deux roues énormes, nous avons enlevé les pierres de l’église et avons été chercher du gravier dans le lit du fleuve. C’était très intéressant de voir comment les animaux étaient dirigés seulement par des cris à la place des rênes.
Avec étonnement et joie, je n’ai vu nulle part se confirmer la réputation des gens du sud en ce qui concerne les mauvais traitements infligés aux animaux. Le travail s’effectuait dans la joie et, peu à peu, je comprenais mieux ce mélange de catalan et de castillan qui se parlait dans le village. Je me suis habitué aussi aux us et aux coutumes et j’ai pu commencer à m’intéresser de plus près à l’organisation de la collectivité. On m’a appris aussi l’histoire révolutionnaire du village qui, en gros, était la suivante :
Le 19 ou le 20 juillet 1936 arriva à Fábara un officier qui a appelé tous les éléments armés réactionnaires à anéantir les organisations des travailleurs. Ces derniers avaient pressenti que quelque chose se préparait et ne furent donc pas pris au dépourvu. Les éléments de droite et la police étaient rassemblés dans la rue mais, assez vite, les travailleurs et les paysans, malgré le manque d’armes, se sont rendus maîtres du village dont la majeure partie était constituée de petits paysans pauvres.
Quelques fascistes tombèrent pendant ces combats, d’autres se mirent en lieu sûr. Puis les habitants se sont réunis pour créer un comité révolutionnaire de maintien de l’ordre. Lors de la réunion, il fut décidé d’exproprier la terre des fascistes tombés ou en fuite qui, les armes à la main, avaient attaqué les travailleurs. Cette terre devenait une exploitation collective. Un comité était élu pour préparer ce projet.
À cette réunion, il fut aussi décidé qu’à partir de ce moment l’exploitation de l’homme par l’homme était abolie, plus personne ne serait maître ou esclave. Chaque homme avait le droit de travailler librement autant de terre qu’il le pouvait. Après quoi chaque homme et chaque femme acceptant les règles et les principes de la collectivité était libre d’y adhérer.
Un peu plus de la moitié du village adhéra sur-le-champ. On ne voulait surtout pas forcer les gens, on comptait plutôt sur les résultats qui, à l’avenir, allaient convaincre ceux qui hésitaient. Ceux qui n’appartenaient pas à la collectivité eurent cependant le droit d’acheter ce dont ils avaient besoin dans le magasin collectif. Un comité comprenant un porte-parole, un secrétaire et un trésorier fut élu. Les statuts stipulaient que ceux qui adhéraient devaient transférer à la collectivité tout ce qui était en leur possession : terre, outils, animaux, etc. On pouvait garder ses effets personnels ainsi qu’autant de terre que la famille pouvait cultiver en potager pendant son temps libre.
Il a été décidé également que l’argent émis par la République espagnole serait mis en commun pour des achats et des améliorations. À la place de cet argent, la collectivité a créé une monnaie valable seulement dans le village, utilisable dans le nouveau magasin coopératif où on pouvait acheter le nécessaire. Le temps de travail était, en principe, fixé à huit heures par jour, mais lors de la moisson, compte tenu du fait que beaucoup de jeunes hommes étaient au front, ce temps était rallongé selon les besoins. Dans la collectivité, on adoptait le salaire familial, ce qui veut dire que tous les membres de la famille étaient payés selon l’âge. Tous les garçons au-dessus de quatorze ans participaient au travail.
Quant à l’organisation des tâches, les travailleurs se regroupaient d’après leurs sympathies ou par métiers. Chaque groupe choisissait un délégué qui supervisait le partage du travail et qui intervenait sur des problèmes divers. On avait ainsi des groupes de menuisiers, de maçons, de charretiers, etc.
Les délégués de groupe se réunissaient tous les soirs après le travail pour discuter et planifier celui du lendemain. Ces délégués participaient aussi, évidemment, à la production. Ces postes ne comportaient aucun avantage, et les groupes pouvaient à tout moment changer de délégués. Tous ces événements apportèrent une bouffée d’air nouveau à Fábara. Pendant des siècles, la vie s’était écoulée dans les mêmes vieilles ornières. Jamais il n’y eut de temps et d’argent pour moderniser ou améliorer les choses. De toute façon, jadis, le bénéfice d’une amélioration n’aurait été qu’une occasion supplémentaire pour la classe des seigneurs d’augmenter ses bénéfices. Mais maintenant la classe des seigneurs était écrasée, et un sang nouveau commençait à couler dans les anciennes artères.
On voyait partout dans le village les signes d’une nouvelle ère. Pour la première fois, on organisait la société pour soi-même. Les cadences au travail augmentaient maintenant qu’on savait que la part du lion n’allait plus dans les poches d’une classe supérieure dégénérée et qui n’avait jamais levé le moindre petit doigt pour le bien commun.
Les habitants de ces villages n’oubliaient jamais la solidarité due aux antifascistes des autres parties du pays. C’est pourquoi une grande partie de la jeunesse s’était engagée sur les différents fronts. Cette solidarité se manifesta aussi par les énormes quantités de nourriture que les collectivités ont fournies à Madrid et aux combattants.
Après avoir nettoyé l’Aragon d’une grande partie de la racaille fasciste, les colonnes anarchistes ont décidé de créer un comité de coordination pour l’Aragon antifasciste. C’est Durruti qui en prit l’initiative. Les anarchistes étaient si puissants alors qu’ils auraient tout à fait pu instaurer une dictature ; mais dans ce cas, ils n’auraient plus été des anarchistes. Au lieu de ça, on fit appel aux représentants de toutes les organisations antifascistes de l’Aragon. Au quartier général, depuis la tente de Durruti, fut créé le Conseil représentatif de toutes les organisations avec l’anarchiste Joaquín Ascaso comme président.
Bien sûr, la création du Conseil indisposa fortement le gouvernement central de Madrid. On y espérait que tous ces paysans et travailleurs incultes allaient échouer dans les tâches d’organisation de la guerre, de la production et de la reconstruction sociale. On les laissa faire, mais on n’apporta pas la moindre petite aide, espérant qu’ils seraient bientôt obligés de se tourner vers le gouvernement central pour demander assistance. Le Conseil se montra cependant à la hauteur de sa tâche et, au lieu de quémander de l’aide, il fut en mesure de soutenir considérablement d’autres contrées en fournissant de la nourriture. Un grand nombre d’aristocrates avait fui lors de l’éclatement de la révolution en laissant derrière eux une partie de leur fortune, entre autres, des bijoux d’une grande valeur. Tout ceci fut bien sûr confisqué par le Conseil et utilisé pour la guerre et la reconstruction. Ces confiscations allaient, à la fin, donner une raison formelle au gouvernement central pour intervenir contre le Conseil qui, concrètement, avait essayé de défendre les intérêts de la population mais qui, par là même, avait fait germer l’idée de la création de comités du peuple dans d’autres parties du pays.
Le président de la région d’Aragon, Joaquín Ascaso, fut appelé, un jour, en août [1937], à Valence pour de prétendues négociations. À Valence, on l’arrêta en faisant courir le bruit qu’il était coupable de contrebande.
Cependant, Ascaso, dont la famille était connue de tous les travailleurs espagnols et dont tous les frères [4]] étaient morts dans la lutte contre le fascisme, fut relâché après une semaine. L’arrestation d’Ascaso était un stratagème pour permettre, pendant son absence et plus facilement, l’exécution des plans du gouvernement central contre l’Aragon.
Un gouverneur, représentant du gouvernement central, fut envoyé à Caspe ; et, soudain, il y eut un grand intérêt pour l’Aragon, cet Aragon que, pendant des mois, on avait négligé en le privant d’armes à cause de son Conseil et de sa population révolutionnaire. Pendant des mois, on avait systématiquement refusé les moyens nécessaires pour une offensive sur ce front aragonais et, consciencieusement, on avait essayé de monter l’opinion intérieure et extérieure contre le Conseil. La population qui, de son côté, avait d’autres soucis que de s’occuper des intrigues politiques, accepta silencieusement cette nouvelle façon de faire du gouvernement central. Non qu’elle sympathisât avec cette lubie, mais comme toutes les armes avaient été envoyées sur le front, l’arrière était désarmé. On n’avait pas pu, comme le gouvernement central le faisait habituellement, pendant la guerre contre le fascisme, conserver des troupes spéciales de police bien armées derrière les fronts. La volonté farouche de la population aragonaise de privilégier la lutte contre le fascisme s’est retournée contre elle quand les hommes de main du gouvernement central ont utilisé cet argument de manque de police à l’arrière pour justifier une intervention. Les politiciens ont beaucoup de mal à comprendre la cohérence entre paroles et actes qui caractérise des gens simples et honnêtes.
La dissolution du Conseil d’Aragon eut des répercussions importantes avec l’arrivée d’un grand nombre de troupes ; le front aragonais recevait enfin des armes. Le chemin de fer était encombré par les transports de munitions et de canons, et l’activité était tout aussi croissante dans les airs : de grandes escadrilles d’avions passaient tous les jours en route vers le front.
L’offensive pouvait maintenant commencer, et beaucoup de postes importants tombèrent entre les mains des troupes gouvernementales. Il n’était pas difficile de comprendre ce que le gouvernement central et certaines tendances politiques voulaient ainsi démontrer. On voulait ainsi faire croire que l’avancée du front avait été rendue possible par la dissolution du Conseil des ouvriers et paysans. Une vieille méthode, très vieille méthode.
On claironnait partout que les progrès en Aragon avaient commencé avec l’arrivée du nouveau gouverneur et des nouvelles troupes. On oubliait volontairement les contributions des colonnes anarchistes, ces colonnes qui étaient depuis longtemps intégrées dans l’armée du peuple espagnol. C’est pourquoi je me suis réjoui de l’arrivée, pour quelques jours de permission, de l’autre fils de la maison qui venait avec un camarade. Ils devaient sûrement être au courant des nouveaux événements.
Ces camarades avaient été sur des fronts divers depuis le début de la guerre ; dernièrement, ils avaient participé à la conquête de Belchite et d’autres endroits encore. Ils appartenaient tous les deux à une colonne anarchiste, actuellement une division avec un numéro, mais avec la même équipe et, grosso modo, le même commandement qu’avant [5] . Leur division avait procédé à l’assaut contre Belchite, l’avait conquise et nettoyée des fascistes. Il ne restait que quelques poches à vaincre quand ils reçurent l’ordre de quitter la ville pour attaquer ailleurs. Une partie de la division Líster, sous la direction du communiste du même nom, entra, à leur place, en ville. Ainsi, on parlait surtout de cette division dans les rapports victorieux.
Les hommes de la division anarchiste ne se préoccupaient guère de cela. Beaucoup étaient là depuis le premier jour de la guerre et considéraient qu’il était normal qu’on utilise leur expérience là où c’était nécessaire, là où il y avait des coups à prendre. Les hommes de Fábara connaissaient les divisions qui avaient eu les plus grosses pertes à Belchite : ce n’étaient pas celles qui étaient déclarées victorieuses.
En même temps que ces événements, il se passait aussi pas mal de choses à l’arrière. De nombreuses troupes de police apparaissaient dans les villages, et on craignait maintenant que le nouveau gouverneur ne modifie l’ordre que les travailleurs et les paysans avaient si bien réussi à maintenir pendant cette année.
Dans notre village, il y eut des rumeurs venant d’autres collectivités qui avaient eu la visite de la police, et où des membres des conseils révolutionnaires locaux avaient été arrêtés. On ne connaissait pas encore les raisons de ces arrestations mais on savait parfaitement qu’à Barcelone il y avait beaucoup d’antifascistes en prison. Beaucoup d’antifascistes étrangers avaient aussi été arrêtés au seul motif qu’ils n’avaient pas de passeport émis par leurs pays respectifs. À leur arrivée en Espagne, pour tous ces camarades, dont certains s’étaient enfuis d’Italie ou d’Allemagne, il avait été suffisant d’être muni d’une recommandation de la part des organisations antifascistes à l’étranger. Dans la collectivité, on commençait à s’inquiéter, on ne savait pas trop quoi penser en l’absence des plus jeunes et des membres révolutionnaires les plus avisés qui étaient tous sur le front. Un jour, on vit arriver dans le village un groupe d’« asaltos [6] ». Le comité de la collectivité, qui comportait aussi des camarades du comité révolutionnaire, s’est enfui du village car la police le cherchait. La plupart d’entre eux avaient déjà fait l’expérience du séjour dans une prison espagnole, à attendre pendant des mois un jugement.
La police leur a tiré dessus mais ils ont réussi à s’échapper. Elle se mit alors à la recherche d’armes pour les confisquer. Les armes disponibles avaient déjà été amenées sur le front, mais la police n’hésitait pas à ramasser les vieux fusils à plomb dont les paysans se servaient pour tirer un lièvre ou un lapin pour améliorer l’ordinaire. Les hommes à qui on volait leur vieux fusil à plomb inoffensif étaient ceux qui, avec leur poitrine, avaient barré la route aux fascistes le 19 juillet. La colère était immense mais résister semblait inutile.
La collectivité se vit privée de son comité, et l’incertitude sur ce qui allait se passer a mené à sa dissolution. Quelques paysans sont retournés travailler leurs champs comme avant mais d’autres ont essayé de continuer le travail en groupe.
Voilà comment l’arrivée de la police a ramené les conditions de vie d’antan dans un village où les habitants, librement et par un travail collectif, avaient abandonné une forme de production obsolète et qui, par la modernisation et une autre organisation du travail, avaient réussi à atteindre de meilleurs résultats. À l’intérieur de la collectivité, on avait détruit les vieilles clôtures entre les différents petits bouts de champs. Au lieu d’ensemencer chaque petite parcelle d’espèces différentes, on avait utilisé des surfaces plus grandes pour chaque espèce. Rien que cela représentait un pas en avant gigantesque et, en plus, dans un proche avenir, par la collectivité, on allait avoir la possibilité d’acheter de meilleurs outils et machines. La dissolution de la collectivité ne pouvait que nuire à la production.
Ce qui se passait à Fábara se passait également dans des centaines d’autres villages. Celui qui se rend compte de ce que signifie le maintien et l’intensification de la production d’un pays en guerre a toutes les raisons de se méfier de ceux qui, sous divers prétextes, essaient d’empêcher le peuple travailleur de se mouvoir librement et de s’autodéterminer. Dans Fábara, on commençait à entendre les voix de ceux qui, avec ferveur, voulaient redémarrer la collectivité, et les hommes au front le réclamaient aussi. « Pendant que nous, ici, écrivaient-ils, sacrifions nos vies pour la révolution, nous demandons que vous, à l’arrière, surmontiez les difficultés en rendant la collectivité et les organisations plus fortes. Nous aimerions constater, le jour de notre retour, que les choses ont avancé dans la bonne direction. »
Un comité fut ainsi recréé pour préparer la réorganisation de la collectivité et, pour se faire une opinion claire des projets du gouvernement, une lettre fut envoyée pour dénoncer les agissements de la police et demander réparation. La réponse n’était pas encore arrivée lorsque, pour des raisons diverses, j’ai quitté Fábara. Avant mon départ, j’eus cependant l’occasion de voir de près les méthodes qu’utilisaient les opposants à la collectivisation. Ils n’avaient pas un grand succès dans les villages, mais là était l’essentiel des sales mensonges de ce qui se racontait à l’étranger à propos des anarcho-syndicalistes espagnols.
Une partie de la division Líster arriva un jour à Fábara pour se reposer quelques jours. Il y avait environ deux mille hommes qui furent bien reçus par la population. Les discussions, le soir, se déroulaient comme avant et tournaient autour des problèmes du front et de la révolution, sans que pour autant ces hommes de troupe n’essaient en aucune façon d’endoctriner la population. Mais, un jour, sur la place du marché, nous fûmes témoins d’une scène assez typique du comportement des staliniens.
Un officier fit un discours devant les soldats et déclara, entre autres : « Camarades, c’est bientôt le jour anniversaire de l’assassinat de Durruti par un anarchiste. » Il fut interrompu par plusieurs soldats qui, indignés, exigèrent qu’il donne le nom de cet anarchiste. L’officier fut forcé de s’éloigner rapidement. Les soldats et la population du village n’étaient pas assez idiots, comme l’avait pensé l’officier, pour croire à un tel mensonge à propos du grand anarchiste Durruti. Un vieux paysan fit en riant la remarque que cela lui rappelait le voleur qui, alors qu’il avait été démasqué, se sauvait en criait fort : « Attrapez le voleur ! »
À une autre occasion, moi et un paysan, nous discutions avec un sergent qui reprenait l’affirmation de l’officier. Mais lorsqu’on lui posa directement la question de savoir s’il existait d’autres hommes que les fascistes et les pontes des partis politiques à avoir intérêt à se débarrasser de Durruti, il ne répondit pas. Les soldats de sa compagnie souriaient en douce.
Le sergent chercha un autre sujet de conversation et commença alors a pérorer sur la façon dont les anarchistes dans les environs de Madrid – « où j’étais avant » – avaient tracassé la population civile, avaient confisqué la terre et les animaux à des personnes qui ne voulaient pas faire partie de la collectivité. Je lui demandais s’il avait vu la même chose ici en Aragon, mais ce n’était pas le cas. « Ici, disait le sergent, les anarchistes sont tout à fait différents de ceux dans la région de Madrid. » C’était exactement la même propagande qu’on pouvait entendre jusqu’en Suède. Les anarchistes, les plus dévoués combattants sur les fronts, ceux qui avaient pris le plus d’initiatives et avaient été les plus prompts aux sacrifices dans la production, ont, selon ces « témoins de vérité », principalement passé leur temps à terroriser la population. Dans la presse suédoise, cela concernait surtout l’Aragon. Le pauvre sergent était en Aragon, c’est pourquoi il fallait qu’il trouve une autre province pour ses dires et ses mensonges.
Quand j’ai fait mes adieux aux camarades de Fábara, ils m’ont affirmé que la collectivité serait bientôt réorganisée et que, cette fois, elle serait construite plus solidement qu’avant, en s’appuyant sur leur expérience passée. À la fin de la guerre, l’avenir serait heureux, un avenir construit et garanti par les propres organisations d’un peuple libre, un avenir sans maîtres ni esclaves.
Au moment de partir, on me demanda de saluer tous les travailleurs révolutionnaires de Suède et de raconter ce que les travailleurs espagnols avaient réussi dans le changement social, la production et la culture, ce au milieu de cette guerre enragée entre deux puissances, sans pour autant gaspiller leurs forces dans un fanatisme partisan.
L’idéal des travailleurs espagnols est symbolisé par un insigne que j’ai vu porté par une grande partie d’entre eux. Il s’agit des initiales des deux grandes confédérations nationales : la CNT des anarcho-syndicalistes et l’UGT des réformistes ; les deux centrales unies dans un même combat économique et culturel. L’insigne, les symboles, l’esprit qui règne parmi les larges couches de travailleurs espagnols, là est la garantie que les travailleurs de là-bas sont prêts à s’associer chaque fois que ce sera nécessaire pour contrer ceux qui veulent faire de nouveau basculer le contrôle de la société entre les mains des politiciens plus ou moins bourgeois.
Laissons les grands quotidiens nationaux aux ordres des partis politiques hurler comme des loups ! Toi, qui travailles en usine, dans la forêt ou dans les champs, tu as quelque chose à apprendre des camarades espagnols !
Traduction : Anita Ljungqvist, mai 2011