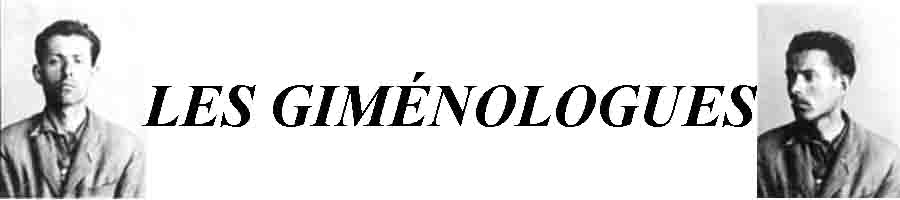De Paris au camp de Bassens et au Gave de Pau : l’ultime parcours de Carl Einstein pendant la "drôle de guerre". Alain RUIZ
Les derniers mots écrits de Carl Einstein que l’on connaît sont les mots d’adieu à sa femme Lyda que du village de Sabres, dans les Landes, il envoya sur une carte postale, le 26 juin 1940. Le même jour, il se tailladait les veines des deux poignets dans un bois de pins des environs. Miraculeusement sauvé, il échouait quelques jours plus tard à Lestelle-Bétharram où, recueilli au monastère des prêtres du Sacré-Cœur, il sembla sur le moment se remettre, du point de vue moral aussi. En fait, il devait se jeter peu après dans le gave de Pau qui charria son corps jusqu’au village de Boeil-Bezing, où il fut découvert, le 7 juillet, et enterré dans le cimetière communal. Mais, pour en arriver là, qu’avait-il donc vécu dans les semaines et les mois précédents, après être revenu de la guerre civile d’Espagne à Paris, au milieu du mois de février 1939 ?[1]
Impossible d’apporter une réponse précise à cette question à partir des deux seules sources émanant d’Einstein lui-même, qui sont connues jusqu’à ce jour. La première est la lettre qu’il adressa le 24 juillet 1939 à Pablo Picasso pour lui demander d’aider financièrement un officier républicain espagnol réfugié en Seine-et-Oise - qu’il avait rencontré sur le front de Madrid et en Catalogne - à émigrer au Mexique avec sa femme et ses enfants.
[2] L’autre source est la demande de secours qu’il fit pour lui-même, sans que l’on puisse dire exactement quand - encore avant ou pendant la "drôle de guerre" ? - à l’
American Guild for German Cultural Freedom.
[3] En sorte que les onze mois, presque jour pour jour, qui séparent sa lettre à Picasso du message d’adieu expédié des Landes à son épouse, constituent dans sa biographie une zone d’ombre sur un arrière-plan historique général bien connu, correspondant au prologue immédiat du second conflit mondial, qui fut marqué par la conclusion du pacte germano-soviétique, le 23 août, et à la guerre qui commença pour la France le 3 septembre suivant pour prendre fin avec l’armistice signé avec l’Allemagne, le 22 juin 1940. Comment Einstein vécut-il ces événements ? En l’absence de toute trace autobiographique, il n’a guère été possible, jusqu’ici, de répondre précisément à cette question, qui est au centre de la présente étude, où l’ultime parcours de l’ex-combattant de la guerre d’Espagne, de Paris au gave de Pau, est retracé pour la première fois, avec le maximum de précision possible, à partir de documents en grande partie nouveaux qui sont venus compléter - et rectifier aussi sur certains points importants - ce qui, jusqu’ici, a pu être écrit à ce sujet.
Connaissant la position d’Einstein, ex-
compañero de la colonne des anarcho-syndicalistes de Durruti, quant à la ligne de Moscou, on imagine sans peine sa réaction au pacte Ribbentrop-Molotov, alors que le gouvernement français faisait arrêter les dirigeants ou ex-dirigeants communistes et que certains membres du Parti, ayant rompu avec leur organisation, se pressaient, début septembre 1939, devant les bureaux d’engagement dans l’armée française. De même, bien des émigrés antifascistes, de gauche surtout, mais de droite aussi, brûlaient de faire la guerre à l’Allemagne de Hitler. Ainsi le porteur d’un des noms les plus prestigieux de l’empire des Habsbourg, le très monarchiste prince Stahremberg, lança alors une campagne active en vue de mettre sur pied une Légion autrichienne, tandis qu’un de ses compatriotes, le grand leader social-démocrate Julius Deutsch, tentait lui aussi, de son côté, d’en constituer une autre et déclarait vouloir, en cas d’échec, faire son "devoir", coûte que coûte, en entrant dans celle de Stahremberg, si celle-ci venait à voir le jour.
[4] Au même moment, Sante Garibaldi, entrepreneur à Bordeaux, cherchait à suivre l’exemple de son grand-père Giuseppe Garibaldi qui, à la tête de ses légendaires Chemises rouges, avait combattu en 1870 aux côtés des Français. En 1914-1915, son fils avait fait de même, sur le front de l’Argonne, à la tête d’une Légion garibaldienne,
[5] et voilà que le petit-fils du glorieux champion de la liberté italienne lançait maintenant l’appel suivant :
En ce moment grave, personne n’a le droit de se dérober, cela est un devoir sacré. L’immortel Giuseppe Garibaldi disait en 1870 : "La France est une grande nation toujours à l’avant-garde du progrès humain, ennemie du despotisme, refuge sûr pour les exilés, amie des opprimés. Si jamais la France se trouve dans une situation où elle aura besoin d’un allié, lâche serait cet Italien qui ne marcherait pas avec moi pour sa défense." Cet idéal immortel est poursuivi aujourd’hui par son petit-fils, le général Sante Garibaldi, comme il l’a poursuivi en 1914-18 avec son père et ses trois frères. Personne n’a le droit de s’abstenir. Comme un seul, les Italiens amis de la France doivent s’élever en masse. Le devoir de chacun est de s’engager [...].
Sante Garibaldi envoya aussi aux présidents des Associations garibaldiennes en France le télégramme suivant :
Les organisations garibaldiennes sont en voie d’organisation - La France est en danger - Vive la France - Vous devez travailler au recrutement et à l’organisation des Garibaldiens - Aucun Italien n’a le droit de rester chez lui. De 18 à 50 ans, tous doivent prendre les armes - Pour lieu de rassemblement attendez instructions ultérieures - Général Sante Garibaldi.
[6]L’appel fut entendu. À Paris, le bureau de recrutement ouvert place de l’Opéra connut immédiatement une grosse affluence : 4000 demandes entre le 1
er et le 8 septembre. Et le 9, Sante Garibaldi d’aviser les autorités françaises - non sans beaucoup d’exagération - qu’un "premier noyau de 100 000 hommes" pouvait déjà être rassemblé !
[7] Pas que des Transalpins, puisqu’il y eut au moins un Allemand parmi ces volontaires : Carl Einstein.
En effet, Einstein a raconté lui-même au Père Buzy, le supérieur général des prêtres du Sacré-Cœur de Lestelle-Bétharram, auquel il se confia peu avant son suicide, comment il avait contracté un engagement dans la Légion garibaldienne en formation.
[8] Cela ne saurait vraiment surprendre : ne s’était-il pas déjà directement engagé dans l’action en juillet 1936, dès le début de la guerre d’Espagne, quand il avait rejoint à Barcelone la colonne Durruti pour se battre contre les phalanges nationalistes du général Franco, aidé par Hitler et Mussolini ? Environ 5000 émigrés antifascistes italiens - "maximalistes", républicains et surtout anarchistes - qui, comme lui, avaient vécu jusque-là en France, avaient fait de même en allant constituer, outre-Pyrénées, diverses unités antifranquistes, en particulier le bataillon devenu brigade Garibaldi, formation en principe autonome, mais rattachée en fait aux Brigades internationales. Einstein retrouva-t-il à Paris, parmi d’autres anciens de la guerre d’Espagne, certains de ces Italiens qui l’auraient entraîné à s’enrôler comme eux sous la bannière de l’Association des garibaldiens de l’Argonne, dont Sante Garibaldi fit son signe de ralliement en septembre 1939 ? Cela est possible, puisque l’idéal antifasciste de ces Italiens restait conforme à l’esprit internationaliste de ceux qui, comme Einstein, étaient allés défendre la cause antifranquiste en Espagne.
Cependant, pas plus que la Légion autrichienne de Stahremberg et celle de Julius Deutsch, qui avait servi comme général de l’armée républicaine espagnole,
[9] la puissante légion annoncée par Sante Garibaldi ne vit le jour parce que le gouvernement français n’en voulut pas ou, plus précisément, parce qu’il ne voulut pas accéder au vœu de son organisateur qui était de voir cette unité combattre aux côtés des Français, certes, mais sous le drapeau vert-blanc-rouge, à l’instar des régiments polonais et tchécoslovaques qui opérèrent en France à la suite d’accords conclus avec les gouvernements intéressés. Engager ainsi dans la guerre ces Italiens aurait forcément d’autant plus froissé le Duce - pour l’instant, neutre - qu’il s’agissait d’antifascistes. Et puis n’y avait-il pas aussi à craindre, pour le bon ordre dans l’armée française, la turbulence avérée de ces éléments étrangers ? Aussi le gouvernement Daladier leur donna-t-il, à défaut de l’honneur de faire revivre ainsi la glorieuse tradition des Chemises rouges, l’autorisation de s’engager à titre individuel dans la Légion étrangère,
[10] tout comme il la donna aussi aux autres étrangers émigrés en France, que ce fussent ceux du Reich hitlérien, de l’Espagne franquiste ou d’ailleurs. Ou plutôt comme il les incita plus que fortement à le faire pour ne pas tomber sous le coup des mesures prises, dès le début de la guerre, à l’encontre des étrangers dans l’Hexagone, à commencer par les ressortissants du Reich déclarés "sujets ennemis" aux termes du décret du 1
er septembre 1939, en attendant que le décret-loi du 18 novembre suivant fasse d’eux des "indésirables", considérés comme "dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique".
[11]Déjà dans les derniers jours du mois d’août la police avait procédé à de nombreuses arrestations sous prétexte de mettre hors d’état de nuire les agents de la Cinquième colonne et aussi les communistes, français comme étrangers, réputés partisans de Moscou - et donc aussi de Berlin - depuis la conclusion du pacte Staline-Hitler. Le 6 septembre, les ressortissants masculins du Reich en France, âgés de 17 à 50 ans, furent appelés par voie de presse, d’affiches et sur les ondes, à se présenter dans des centres de rassemblement gardés par l’armée aux fins de passer devant des "commissions de criblage" chargées de juger du degré de danger qu’ils pouvaient représenter pour la sécurité du pays et de les classer en conséquence. Les autres devaient se présenter sans délai au contrôle des autorités de police du lieu où ils résidaient.
[12] L’Allemand non naturalisé français Carl Einstein entrait dans cette seconde catégorie puisque, né le 26 avril 1885, il venait d’avoir 54 ans, et il dut alors se rendre au commissariat du 5
e arrondissement (Panthéon), dont dépend la rue Censier, au n° 16 de laquelle - si l’on se réfère à un document non daté, mais datant manifestement de ce moment-là
[13] - il était alors domicilié.
[14] Simple formalité de contrôle de ses papiers d’identité qui n’eut pas de suite ? Sans doute, car en quoi Einstein pouvait-il, à la différence d’autres émigrés notoirement militants, être suspecté d’agissements dangereux pour la sécurité du pays, lui qui, depuis son installation à Paris, ne s’était pas fait remarquer par des activités politiques particulières ?
Mais voilà que, le 14 septembre, les hommes de 50 à 65 ans furent appelés, eux aussi, à se présenter dans les camps de rassemblement pour y être à leur tour "criblés" et classés en deux catégories : les "indésirables ou suspects" et ceux qui ne l’étaient pas, les premiers devant être envoyés dans le camp dit "disciplinaire" du Vernet, dans l’Ariège, les seconds dans divers autres camps en province, beaucoup moins sévères, mais le plus souvent improvisés et où, donc, les conditions de vie furent souvent déplorables pour les internés. Avant d’être ainsi dispersés, les étrangers vivant dans la région parisienne se trouvèrent parqués principalement dans deux lieux bien connus de la capitale, transformés du jour au lendemain en centres d’internement : le stade Yves-du-Manoir, à Colombes, pour les non-suspects, et, pour les éléments jugés dangereux, le stade Roland-Garros.
[15] Carl Einstein, cette fois, était concerné, et c’est à Colombes que l’on retrouve alors sa trace.
En effet, une liste dressée à l’époque s’est conservée, sur laquelle figurent les noms d’Allemands et d’Autrichiens connus internés da le fameux stade olympique, et parmi ces noms se trouve celui d’Einstein,
[16] dont on peut fort bien imaginer ce qu’il vécut au milieu de la foule, estimée de 20 à 25 000 individus - que des hommes -, qui se trouva momentanément rassemblée en ce lieu. En effet, de nombreux témoignages - tous parfaitement concordants - existent sur les conditions dans lesquelles, avant d’être transférés dans différents camps situés dans d’autres départements, ces étrangers passèrent là plus ou moins de temps, gardés par des militaires et coupés de leurs proches qui n’avaient ni le droit de leur rendre visite, ni celui de leur écrire.
[17]Le stade de Colombes n’était évidemment pas conçu pour accueillir tant de personnes à la fois, et, dans l’urgence, rien n’avait été fait pour l’aménager dans ce sens. Parqués sur la pelouse, la piste cyclable et les gradins des tribunes, les internés dormaient à la belle étoile, sur les banquettes ou à même le sol ; la nourriture laissait beaucoup à désirer et les installations sanitaires étaient totalement insuffisantes. Dans un coin du stade entouré de grillage étaient isolés, sous surveillance spéciale, les détenus considérés comme particulièrement suspects qui devaient être bientôt transférés au stade Roland-Garros, le "camp des indésirables" à Paris et, de là, au camp disciplinaire du Vernet. Einstein ne connut pas le même sort - pour quelle raison aurait-il été traité ainsi ? -, mais il n’ignora certainement rien de la présence en ce lieu de certains émigrés du III
e Reich bien connus, des dirigeants notoires du KPD, le Parti communiste allemand, comme Franz Dahlem, Paul Merker ou Georg Stibi,
[18] ou encore l’écrivain juif hongrois, aussi parfaitement germanophone qu’anglophone, Arthur Koestler, qu’il connaissait personnellement.
Sioniste converti à un communisme militant qui fit de lui, pour un temps, un agent du Komintern, Koestler avait été mêlé de près à la guerre civile en Espagne où il avait accompli plusieurs missions comme agent secret et correspondant de presse et failli être fusillé par les franquistes qui l’avaient arrêté à Malaga. Mais ses sympathies pour le POUM devaient l’amener à une rupture spectaculaire avec le Parti communiste qu’il consomma par une lettre écrite à Paris, au cours de l’été 1938, sous le coup des procès de Moscou.
[19] Ce parcours n’était pas très éloigné de celui d’Einstein qui s’était lui aussi - mais bien avant - détaché de l’orthodoxie marxiste pour se rapprocher, lui, de l’anarchisme. Einstein et Koestler étaient, en tout cas, deux hommes qui ne pouvaient que se comprendre après ce que l’un et l’autre avaient vécu outre-Pyrénées. Aussi est-ce avec émotion que Koestler devait apprendre, en juillet 1940, la fin tragique d’Einstein. Dans son récit autobiographique "La lie de la terre" qu’il dédia à sa mémoire et celle de ses autres "confrères, les écrivains exilés d’Allemagne qui se suicidèrent lorsque la France capitula",
[20] Koestler raconte à propos d’Einstein : "La dernière fois que je l’ai rencontré, c’était au café des Deux-Magots à Paris, en 1939 ; il était officier pendant la guerre d’Espagne. La défaite l’avait anéanti."
[21] Les deux hommes ne se revirent donc pas au stade de Colombes, où l’on se plait, par ailleurs, à imaginer Einstein devisant avec d’autres émigrés notoires du III
e Reich ou, au moins, les apercevant de loin dans l’enceinte du stade, Walter Benjamin, par exemple, qu’il pourrait avoir connu depuis l’émigration de celui-ci à Paris, en 1933.
[22]À la différence de Benjamin, qui, du stade de Colombes, fut transféré au camp de Vernuches, près de Nevers,
[23] ou de Koestler qui passa, lui, au "camp des indésirables" de Roland-Garros et, de là, au camp du Vernet, dont il ne devait être relâché qu’à la mi-janvier 1940,
[24] Einstein fut apparemment libéré assez rapidement du stade de Colombes. De tels cas ne furent pas rares. En effet - et, comme encore après, dans les autres camps -, c’est d’abord pour des raisons de santé qu’un certain nombre de détenus furent autorisés à s’en aller. On en relâcha aussi certains après qu’ils eussent été déclarés "non-suspects" par les commissions de criblage, ou aussi en raison de leur âge et, également, à la suite d’interventions ciblées d’organisations ou de personnes influentes. Tel fut vraisemblablement le cas pour Einstein, et il n’y aurait rien d’aventureux à penser qu’il dut sa libération à un homme tel que le très germanophile ministre de l’Information du moment, Jean Giraudoux, qui, comme d’autres personnalités françaises du monde des lettres, intervint alors dans ce sens pour des "collègues" intellectuels allemands internés, en particulier pour Walter Benjamin.
[25] Plusieurs faits parlent en faveur de cette hypothèse.
Et d’abord, Giraudoux admirait Einstein qu’il connaissait depuis l’avant-guerre de 1914 et dont il a brillamment évoqué la figure dans le roman
Siegfried et le Limousin et la pièce de théâtre "Siegfried" en la personne du comte von Zelten.
[26] Ensuite, il se trouve conservé aux Archives nationales à Paris, dans un dossier confidentiel du ministère de l’Information concernant l’utilisation possible d’émigrés allemands, autrichiens et tchèques pour la propagande de guerre contre le Reich hitlérien, une liste dactylographiée d’internés à Colombes qui, à la date du 16 septembre 1940, étaient considérés comme susceptibles d’être employés à ce service. Parmi les cinquante-sept noms figurant sur cette liste avec les adresses des intéressés, on relève celui de "Karl [sic] Einstein, 16 rue Censier".
[27] Mais Einstein fut-il effectivement recruté après sa libération du stade de Colombes ? Il ne le semble pas. En tout cas, il n’apparaît pas nommément parmi les collaborateurs du germaniste Pierre Bertaux qui, sous l’égide du Commissariat général à l’information, animait alors à la Radiodiffusion nationale les émissions vers l’Allemagne. "Mes collaborateurs à la radio", se borne à écrire Bertaux dans ses mémoires, "étaient des juifs allemands réfugiés : Hans Jacob, Alexander Mass-Werth et autres."
[28]Quoi qu’il en soit, Einstein fut donc relâché du stade de Colombes. Quand ? Impossible de le dire avec précision. Mais, à en juger d’après d’autres cas plus ou moins semblables,
[29] il est à peu près sûr qu’il dut recouvrer sa liberté assez rapidement. Pour autant, toute crainte quant à l’avenir n’était pas dissipée, car de graves menaces continuaient à peser sur tous les émigrés germaniques, internés ou non, dont le sort dépendait directement de l’évolution de la guerre. Sans doute les libérés se trouvaient-ils momentanément à l’abri des mesures de défense nationale mal comprises par le gouvernement français, qui, dès le début septembre 1939, avaient mené tant d’étrangers dans les camps d’internement, mais n’était-ce pas qu’un simple sursis ? Et qu’adviendrait-il d’eux si les armées de Hitler envahissaient la France ? Deux points d’interrogation qui inquiétaient terriblement Einstein, à l’évidence très pessimiste depuis sa libération. Daniel-Henry Kahnweiler a raconté plus tard à Nina, la fille de son ami :
[...] comme vous le dites si justement, il était profondément désespéré dans les premiers mois de 1940. Je le voyais très souvent à cette époque-là. Il avait la hantise d’être interné et il disait : "Je sais bien comment ça se passera. D’abord ce seront les gardes mobiles qui nous garderont et puis après ce seront les SS. Mais je ne veux pas, je me fouterai [sic] à l’eau" et il a fait ce qu’il avait dit.
[30] Ici se pose la question de savoir si, en proie à de telles pensées, Einstein envisagea alors de quitter la France. Mais y avait-il songé seulement un instant depuis son retour d’Espagne ? Sans doute, car ses amis le peintre Heinz Heckroth et sa femme Ada, réfugiés outre-Manche, ne seraient certainement pas intervenus, comme ils le firent, auprès des plus hautes instances gouvernementales britanniques pour obtenir en sa faveur un visa d’entrée en Angleterre, s’il n’avait pas été au courant et d’accord avec cette démarche qui n’aboutit finalement à rien : le visa ne fut pas accordé à Einstein au motif qu’il avait été un combattant actif de la guerre d’Espagne et qu’il ne disposait que d’un passeport périmé, délivré par la défunte République espagnole.
[31] En tout cas, c’est manifestement pour obtenir une aide à l’émigration qu’il s’adressa aussi - mais quand exactement ? - à l’
American Guild for German Cultural Freedom : "N’y a-t-il pas moyen que je puisse continuer mes travaux quelque part ? ", écrivait-il à cette organisation.
[32]C’est en 1938 que l’
American Guild for German Cultural Freedom était née, à New York, de l’initiative du prince Hubertus von Löwenstein, qui avait été correspondant de presse en Espagne républicaine. L’objectif de cette organisation était d’assurer hors du Reich de Hitler "la liberté et la pérennité d’une culture artistique et scientifique allemande sans aucun lien avec les partis" et, pour ce faire, d’aider par l’octroi de bourses les intellectuels et les artistes menacés en Europe. Depuis le début de la guerre, l’AGGCF, qui avait pour présidents Thomas Mann et Sigmund Freud, s’efforçait d’intervenir plus particulièrement en faveur de ceux qui étaient internés pour obtenir leur libération et assurer au moins leur survie.
[33] C’est dire qu’avec son profil d’exilé antifasciste et la notoriété qui était la sienne, Einstein pouvait espérer un secours de cette organisation. D’autant qu’il connaissait personnellement le prince von Löwenstein pour l’avoir rencontré à Barcelone à l’époque de la guerre civile.
[34] Mais sa demande n’eut pas de suite. Expédiée du 19, rue Censier, sa lettre mit apparemment beaucoup de temps pour parvenir à destination puisque, à la date du 5 décembre 1940, une note manuscrite du secrétaire de l’AGGCF, Volkmar von Zühlsdorff, indique que l’adresse d’Einstein est inconnue : "present address unknown".
[35] Et pour cause : Einstein avait dû quitter Paris au printemps précédent dans les dramatiques circonstances créées par l’invasion allemande de la Hollande et de la Belgique qui préluda à l’invasion de la France et à sa débâcle militaire.
Le 12 mai 1940 furent placardées à Paris, sur ordre du gouvernement, des affiches signées du général Héring, commandant de la place, enjoignant aux "ressortissants allemands, sarrois, dantzickois et étrangers de nationalité indéterminée d’origine allemande résidant dans le département de la Seine, âgés de 17 à 55 ans", sous peine d’arrestation, de rejoindre sans délai le centre de rassemblement du stade Buffalo. Suivirent, le 23 mai, d’autres affiches s’adressant cette fois aux hommes de 56 à 65 ans, qui devaient se présenter audit stade le 25, munis de vivres pour deux jours et du matériel nécessaire pour leur alimentation (fourchette, cuillère, quart, etc.) et de bagages n’excédant pas le poids de 30 kg, "y compris les vivres".
[36] Einstein avait eu 55 ans le 26 avril précédent, c’est dire qu’il ne put échapper à cette nouvelle vague d’internements qui, à Paris comme en province, toucha tous les émigrés laissés en liberté en septembre 1939 ou qui, alors internés, avaient été ensuite libérés plus ou moins rapidement comme Einstein. N’étant ni ressortissante du Reich, ni étrangère de "nationalité indéterminée d’origine allemande", son épouse Lyda, Arménienne de nationalité iranienne, n’était pas concernée par l’ordre donné en même temps aux femmes mariées sans enfants ou célibataires, âgées de 17 à 65 ans, de se présenter au Vél d’Hiv, d’où la plupart d’entre elles devaient être transférées au camp de Gurs, dans les Basses-Pyrénées.
[37] Et c’est ainsi que les époux Einstein furent séparés par les événements, comme déjà une fois, à leur retour d’Espagne en France, quand - fin janvier-début février 1939 - ils avaient échoué dans deux camps d’internement différents, lui à Argelès-sur-Mer pour deux à trois semaines, elle à Juillac, en Corrèze, pour plus longtemps, jusqu’à l’été suivant.
[38] Mais, cette fois, ils ne devaient plus jamais se revoir.
Les détails manquent sur les conditions précises dans lesquelles Einstein se retrouva au centre de rassemblement du stade Buffalo. Répondit-il, sans contrainte physique, à l’injonction de s’y rendre dans les formes prescrites ou y fut-il conduit après arrestation, comme ce fut le cas pour beaucoup ? On est tenté de le penser lorsqu’on lit les mots suivants de Daniel-Henry Kahnweiler : "Quand les armées de Hitler envahirent la France, la police française interna l’antifasciste Carl Einstein avec sa délicatesse habituelle. Il craignait cela depuis longtemps."
[39] Et l’hypothèse devient quasi certitude lorsqu’on lit sous la plume d’Arthur Koestler, qui avait été relâché du camp du Vernet en janvier 1940 et qui fut à nouveau arrêté à Paris, en mai :
Une fois de plus, nous sommes assis sur le banc de bois du commissariat. [...] Une trentaine d’hommes attendaient sur les bancs, tous Autrichiens ou Allemands de cinquante-cinq à quatre-vingt ans. C’était la dernière rafle. Tous ceux qui avaient été relâchés des camps de concentration pour Allemands l’hiver dernier avaient été de nouveau arrêtés la semaine précédente, y compris les femmes. Les hommes au-dessus de cinquante-cinq ans et les invalides avaient été épargnés ; et maintenant, c’est leur tour. Cette fois, le pogrome de l’administration fut total. Les malades furent tirés de leur lit ; plusieurs moururent dans les jours qui suivirent. Les chefs du mouvement antinazi, des hommes de réputation mondiale : Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger, Willy Münzenberg, Walter Hasenclever, Ernst Weiss, Carl Einstein, Walter Benjamin, aucun ne fut épargné. Des sept personnes citées, les deux premières réussirent à s’évader, les cinq autres se suicidèrent.
[40] Il est sûr que Koestler ne revit pas Einstein à ce moment puisqu’il a raconté par ailleurs qu’il l’avait rencontré pour la dernière fois en 1939 à Paris, au café des Deux-Magots.
[41] Il n’en reste pas moins que son témoignage permet d’imaginer parfaitement l’état psychologique dans lequel Einstein devait se trouver en ce printemps de 1940 : à l’heure où les nouvelles de l’invasion éclair du nord de la France par la Wehrmacht se succédaient dans un Paris tétanisé par la psychose de la Cinquième colonne et les bobards les plus affolants, il ne pouvait qu’éprouver la même incertitude et les mêmes craintes que tous les autres émigrés allemands qui, comme Koestler et lui, se retrouvèrent alors au stade Buffalo. Koestler raconte :
Pendant cinq heures d’attente sur les bancs de la salle de police, j’avais discuté avec mon voisin, le docteur Pollak, sur la question qui obsédait tous nos esprits : est-ce que les Français se dépêcheraient de nous éloigner de Paris avant que les Allemands n’y entrent ? J’essayai de le convaincre que les Allemands persisteraient dans leur méthode : une chose à la fois et d’abord anéantir l’armée des Flandres isolée, ce qui donnerait aux Français une semaine ou dix jours pour nous évacuer. Mais le vieux Pollak ne croyait pas à mon raisonnement. Les Français avaient besoin de tous leurs moyens de transport pour la retraite de leurs forces armées ; les lignes de chemin de fer étaient déjà désorganisées, ils n’allaient pas se soucier de nous et nous abandonneraient à notre sort, c’est-à-dire à la Gestapo. Je le regardai et vis que son front était couvert de sueur et que la lumière grise de la peur brillait dans ses yeux. Alors, moi aussi, je fus pris.
[42]Et Einstein aussi, cela est sûr : n’est-ce pas essentiellement la peur de tomber aux mains des Allemands qui devait le pousser, quelques semaines plus tard, à se suicider en "se foutant à l’eau", pour reprendre sa propre formule dans ses conversations avec son ami Kahnweiler ?
Une première question se pose à propos de cet ultime parcours d’Einstein, du stade Buffalo, à Paris, au gave de Pau, entre la fin mai et la première semaine de juillet 1940 : venait-il, comme on le lit ici et là, de quitter le camp d’internement pour étrangers de Gurs, près d’Oloron-Sainte-Marie, dans le Béarn, quand il mit fin à ses jours ? Ne parlons pas des confusions que l’on trouve dans certains dictionnaires biographiques pourtant sérieux comme, par exemple, celui où il est dit non seulement qu’Einstein était, "à la fin, chez des moines à Gurs [sic] ", mais encore qu’il se suicida - alors que Gurs était en zone qui, en 1940, ne fut pas occupée par la Wehrmacht
! - "avant l’arrivée des troupes allemandes".
[43] Sans contenir pareilles erreurs, d’autres ouvrages n’en indiquent pas moins qu’avant de se jeter dans le gave de Pau, Einstein fut interné à Gurs : ainsi Jean-Michel Palmier dans son étude classique
Weimar en exil,
[44] Jürgen Serke dans son livre non moins intéressant
Les poètes brûlés[45] ou encore Barbara Vormeier, éminente spécialiste de la question, dans son excellente présentation de la situation des émigrés allemands en France pendant la guerre de 1939-1945.
[46] Le très sérieux téléfilm
Carl Einstein ou le Dilettante du miracle, réalisé par Mechthild Rausch, donne encore la même indication,
[47] qui ne saurait être directement vérifiée ou plutôt infirmée - puisque, disons le d’emblée, elle est fausse -, du fait que toutes les archives du camp de Gurs contenant les listes de détenus ont été brûlées sur ordre de son commandant, le 24 juin 1940, deux jours après l’armistice, décision justifiée par l’arrivée annoncée pour le lendemain d’une commission d’inspection allemande qui aurait pu faire usage de ces documents pour mettre la main sur les détenus, dont les noms figuraient sur les listes noires de la Gestapo.
[48] Dès lors se pose la question de savoir à quelle source remonte l’information erronée selon laquelle Einstein fut interné dans le camp en question.
Dans la solide monographie qu’il a consacrée au camp de Gurs, Claude Laharie signale un article paru dans le journal
la Petite Gironde du 14 juillet 1940, relatant qu’Einstein, plutôt que de se rendre après son évasion de ce camp, s’était jeté dans le gave d’Oloron [sic] et s’était noyé.
[49] S’il s’avère impossible aujourd’hui de retrouver cet article,
[50] auquel renvoie une note en date du 15 juillet d’Arthur Koestler dans le récit de ses pérégrinations en Béarn,
[51] il n’en est pas moins clair qu’il contenait des erreurs d’autant plus étonnantes qu’à la date du 13 juillet la presse de la région avait déjà fait connaître, pour l’essentiel, comment les choses s’étaient réellement passées,
[52] c’est-à-dire telles qu’elles sont retracées dans la déposition faite à la police par le Père Buzy sur le séjour d’Einstein à Bétharram avant son suicide et dans la lettre que ce religieux écrivit, quelque temps après le drame, au beau-frère de celui-ci.
[53] Ces deux documents ne peuvent laisser planer le moindre doute sur la situation géographique du camp, où Carl Einstein fut interné en dernier. En effet, il y est question de "camp de concentration de Bordeaux" ou de "camp de concentration à Bordeaux ou des environs".
[54]À moins de considérer, comme l’auteur pourtant sérieux d’une notice biographique sur Einstein, que Gurs est situé "près de Bordeaux", alors que quelque 200 km séparent cette localité béarnaise du département des Pyrénées-Atlantiques (ex-Basses-Pyrénées) de la capitale du département de la Gironde !
[55] -, un simple coup d’œil sur la carte du Sud-Ouest suffit à faire éclater l’absurdité de ce qu’on appellera ici par commodité la "version Gurs" des derniers jours d’Einstein. Gurs se trouve, à la distance indiquée, directement au sud de Bordeaux. C’est dire que, dans l’hypothèse où il serait parti de ce camp, Einstein aurait pris la direction du nord, allant ainsi à la rencontre des troupes de la Wehrmacht qui descendaient du nord de la Loire vers l’Aquitaine. Mais alors, comment expliquer qu’il ait déclaré au Père Buzy qu’"interné dans un camp de concentration à Bordeaux ou des environs, [...] il (avait) été relâché juste quelque temps avant l’arrivée des Allemands" et qu’"afin de ne pas rencontrer les envahisseurs, pour lesquels il avait une aversion particulière, il s’(était dirigé)
vers le midi" ?
[56] Comment penser un instant qu’il ait pu parler au supérieur des Prêtres de Bétharram de la direction diamétralement opposée à celle qu’il avait suivie pour ne pas tomber dans la gueule du loup ?
Non pas le camp de Gurs, donc, cela est sûr, mais bien "un camp de concentration à Bordeaux ou des environs", et la question se pose de savoir lequel. Ce ne peut avoir été, comme cela a pu être écrit, le trop fameux camp de Mérignac qui ne fut inauguré qu’en octobre 1940.
[57] Au mois de juin précédent, il y avait en fait deux camps d’internement pour étrangers en Gironde : celui de Libourne, à une trentaine de kilomètres à l’est de Bordeaux, qui avait été ouvert dès le début de la guerre, en septembre 1939, et celui de Bassens, sur la rive droite de la Garonne, à environ 12 km au nord de Bordeaux, en longeant le fleuve, qui ne figure pas sur la carte générale des camps de rassemblement et d’internement français de septembre 1939 à juin 1940 et qui est resté jusqu’à ce jour totalement inconnu, même des spécialistes les plus avertis de l’histoire de ces camps pendant la Seconde Guerre mondiale.
[58]La comparaison des distances séparant Bordeaux de Libourne et de Bassens ne peut que faire penser qu’Einstein, parlant de "camp de concentration à Bordeaux ou des environs", faisait allusion au camp établi à Bassens, ce que confirment sans le moindre doute possible deux documents : le registre des entrées et sorties de l’hôpital de Mont-de-Marsan à la date du 26 juin 1940 - "Einstein Carl [...] Domicile : Bassans [sic]"
[59] - et un article paru le 30 mai 1941 dans la revue
Aufbau qui était, à New York, un organe important des émigrés du III
e Reich. Signé du pseudonyme S. Law derrière lequel se cachait le social-démocrate Hermann Budzislawski, ex-éditeur de la célèbre
Neue Weltbühne, qui avait été lui même interné à Bassens en 1940, cet article était consacré à une des figures de proue de la résistance des exilés allemands à Hitler, Georg Bernhard, directeur à Paris de 1933 à 1937 du
Pariser Tageblatt, puis de la
Pariser Tageszeitung. Lui aussi avait connu le camp de Bassens, où se trouvaient aussi en même temps - nommément mentionnés par Budzislawski - le journaliste social-démocrate Robert Groetzsch, le pacifiste Alfred Apfel, Julius Bab et Carl Einstein.
[60] Personne, jusqu’à ce jour, n’a entrepris de retracer l’histoire du camp de Bassens,
[61] dont il pouvait paraître impossible de retrouver d’autre trace que le nom cité, ici ou là, à propos de tel ou tel émigré du III
e Reich plus ou moins connu qui y fut détenu. Dans la zone portuaire de Bassens, sur les bords de la Garonne, un épais manteau de végétation sauvage - arbres, buissons et broussailles - recouvre aujourd’hui le vaste emplacement qu’occupait la poudrerie construite pendant la Première Guerre mondiale, désaffectée depuis 1921, dans les bâtiments de laquelle le camp fut établi en toute hâte au printemps 1940 pour recevoir des étrangers indésirables. À Bassens même - aujourd’hui ville de 7000 habitants environ qui en comptait 2194 au recensement de 1947 -, pas le moindre souvenir exploitable au sujet de ce camp, même chez les témoins de l’époque et vieux férus d’histoire locale. Dans les archives municipales, rien, non plus, si ce n’est une vague mention - postérieure à la période en question - dans le registre des délibérations du conseil de mairie et, dans ceux de l’état civil, l’acte de décès d’un certain Arthur Berger, "né à Berlin, Allemagne, le 4 novembre 1885 » et « décédé le 1
er juin 1940, à sept heures, au camp des internés civils allemands", acte dressé sur la déclaration d’Alexandre François Equilbec, "cinquante ans, lieutenant de réserve au camp des prisonniers allemands Bt 18, I.C.".
[62] En fait, il faut renoncer à l’espoir de retrouver jamais les papiers du camp qui ont été détruits, ainsi que cela ressort de documents conservés aux archives de l’Armée de terre, à Vincennes.
Cependant, au terme de longues et difficiles recherches, suffisamment de renseignements se trouvent maintenant réunis pour que l’on puisse se faire une idée assez précise des conditions de vie que, dans les quatre semaines ou cinq semaines qui précédèrent son ultime voyage, Carl Einstein connut au camp de Bassens. On peut de même indiquer un assez grand nombre des hommes qu’il put y rencontrer parmi les quelque 1100 détenus, dont 750 étaient des israélites et 350 des militaires allemands : des officiers - dont plusieurs appartenaient à l’OKW, le haut commandement de l’armée allemande - ainsi que des parachutistes et soldats d’autres troupes qui avaient été faits prisonniers depuis le début du Blitzkrieg sur la France.
Outre les personnages déjà cités - Hermann Budzislawski, Georg Bernhard, Robert Groetzsch, Alfred Apfel et Julius Bab - se trouvaient à Bassens, en même temps qu’Einstein, d’autres figures notoires de l’émigration allemande depuis 1933, à commencer par un homme dont le parcours initial sous la République de Weimar n’avait pas tardé à diverger du sien, l’ex-spartakiste Heinrich Brandler qui était devenu président du KPD en 1923. Écarté plus tard de la direction du Parti pour "déviationnisme de droite", il avait été un des co-fondateurs et dirigeants du KPO, le Parti communiste allemand d’opposition, puis, à partir de mars 1933, le principal leader avec August Thalheimer, à Strasbourg et ensuite à Paris, du comité de ce parti à l’étranger au sein duquel, pendant la guerre d’Espagne, ses sympathies pour le POUM provoquèrent une scission.
[63] Y avait-il là, pour l’ex-membre de la colonne Durruti Einstein, matière à échanges de vues complices, s’il eut à Bassens l’occasion de parler à Brandler qui devait émigrer à Cuba en 1941 ?
Détenu alors aussi à Bassens, Henry Jacoby. Ce publiciste berlinois passé du pacifisme au Parti communiste allemand d’opposition, qui avait connu les geôles nazies avant d’émigrer à Paris, a évoqué dans ses mémoires encore d’autres personnages qu’Einstein - dont il ne cite pas le nom - put alors rencontrer aussi
[64] : le publiciste Paul Fröhlich, membre du KPD à sa fondation devenu dans les années 30, après son exclusion du Parti, une des figures les plus marquantes du SAPD (Parti ouvrier socialiste d’Allemagne), le médecin berlinois Ernst May, ex-membre du KPD, lui aussi, le syndicaliste Fritz Opel, autre communiste opposé à la ligne de Moscou, et Franz Pfemfert, le premier beau-frère d’Einstein, qui avait émigré dès 1933 en Tchécoslovaquie et de là, en 1936, à Paris, où il ne semble pas qu’il ait à nouveau fréquenté Einstein après le retour de celui-ci de la guerre d’Espagne. Il faut dire qu’à l’origine idéologiquement très proches dans leur rejet du communisme soviétique, les deux ex-spartakistes attirés par l’anarchisme s’étaient éloignés par la suite l’un de l’autre aussi pour des raisons familiales : Einstein avait demandé en 1923 le divorce d’avec Maria Ramm, la belle-sœur de Pfemfert, et marquait trop peu d’intérêt pour sa fille Nina qu’une tendre complicité unissait à son oncle.
[65] Franz Pfemfert fut touché par la même vague d’internements qu’Einstein. De même, sa femme Alexandra qui compta au nombre des presque 10 000 Allemandes, Autrichiennes, Dantzigoises, Tchécoslovaques, Polonaises, etc. enfermées comme "indésirables" au camp de Gurs, en mai-juin 1940.
[66] Libérée, et après un court passage à Lourdes, elle devait retrouver son mari au mois de juillet suivant à Perpignan et réussir à passer avec lui outre-Atlantique, où leur périple se termina à Mexico.
[67] On a écrit à leur sujet :
Sur les routes de l’errance, ils auraient pu croiser Carl Einstein, lui aussi sorti d’un camp français et qui, dans la même région (Alexandra est à Lourdes début juillet), choisit le suicide. Tragique d’une rencontre qui n’a pas eu lieu, mais aurait-elle changé quelque chose à l’état d’esprit d’Einstein ?
[68] De fait, en ce dramatique début de l’été 1940, les destins d’Einstein et de Pfemfert se rencontrèrent bel et bien encore une fois, non quelque part sur les routes de l’Aquitaine, mais au camp de Bassens. Eurent-ils là l’occasion de se parler à nouveau et, qui sait, peut-être de se rapprocher après des années de brouille ? En l’absence de documents qui l’attesterait sûrement, on ne peut évidemment pas l’affirmer, mais - et la remarque vaut aussi pour les autres internés de Bassens évoqués ici - l’hypothèse est plus que vraisemblable : comment, en effet, imaginer que les détenus aient pu, pendant plusieurs semaines passées ensemble dans une enceinte close, s’ignorer les uns les autres, surtout s’ils se connaissaient déjà personnellement ou même simplement de nom, quand il s’agissait de politiques, d’intellectuels ou d’artistes qui avaient plus ou moins fait parler d’eux avant comme après 1933 ? Dans le monde plutôt fermé des intellectuels, artistes et politiques émigrés du Reich, tous n’étaient-ils pas plus ou moins directement ou indirectement au courant des faits et gestes des uns et des autres par l’intermédiaire de connaissances communes ?
C’est ainsi qu’ayant suivi, comme il l’avait fait depuis plus de trente ans, l’évolution des arts contemporains, Einstein ne pouvait que connaître, au moins de nom, le peintre et dessinateur Horst Strempel, collaborateur occasionnel du
Monde, de
Ce soir et de la
Patrie humaine depuis son émigration à Paris en 1933 et membre - comme l’illustre Max Ernst - du "Collectif des artistes allemands" fondé dans les premiers mois de 1936 dans le but de regrouper les artistes communistes et les artistes antifascistes sans appartenance politique précise. Or Strempel a raconté qu’il avait eu des discussions sur l’art avec Max Raphael et Carl Einstein, alors qu’il se trouvait, comme il l’a dit sans autre précision, "au camp d’internement".
[69] Ce camp ne peut avoir été, comme on a pu le penser,
[70] le camp de Gurs - puisque Einstein n’y a jamais été -, mais bien le camp de Bassens. D’ailleurs Strempel n’a sûrement jamais été enfermé au camp de Gurs, mais n’en a connu que les environs où, comme l’indique sa biographe, il vécut avec sa femme Erna libérée du camp, à 2 km du village, de juillet à octobre 1940, après "s’(être) enfui d’un autre camp".
[71] Cet autre camp ne peut manifestement qu’avoir été celui de Bassens, où l’on se plait donc à imaginer Strempel discutant de peinture et d’autres sujets du même genre - "alors que les SS étaient en train de gagner la guerre", comme il l’a dit -, avec l’auteur de
L’art du XXe siècle et aussi avec l’historien et théoricien de l’art marxisant Max Raphael qu’Einstein, semble-t-il, n’avait pas fréquenté à Paris et qui devait finir par se suicider, lui aussi, mais après la guerre, en 1952, à New York.
[72]Au même moment se trouvaient aussi internés à Bassens deux anciens représentants de l’expressionnisme, proches de Franz Pfemfert et ex-collaborateurs de sa revue
Die Aktion, qu’Einstein, lui même lié de près à ce mouvement dès ses débuts, ne peut qu’avoir connus : le peintre et sculpteur Otto Freundlich, ami de Picasso, qui devait finir en 1943, au camp d’extermination de Maidanek
[73], et l’essayiste Kurt Kersten, antifasciste résolu, qui put, lui, émigrer outre-Atlantique et mourut en 1962 à NewYork.
[74]Les limites imposées au présent article ne permettent pas de présenter plus longuement tous les codétenus d’Einstein à Bassens et de décrire en détail la vie quotidienne dans le camp, comme cela est le cas dans l’étude particulière annoncée plus haut.
[75] Pour le dire en quelques mots : rien, dans les sources finalement assez nombreuses que nous avons pu mettre à jour, n’indique que les internés aient eu à souffrir des maux que connurent au même moment à divers degrés - trop souvent jusqu’à l’intolérable - ceux d’autres camps d’étrangers en France : promiscuité, logement insalubre, mauvaise nourriture, manque d’hygiène, inhumanité des gardiens, etc. À preuve les souvenirs d’Henry Jacoby qui permettent de se faire une idée assez précise des conditions de vie apparemment décentes - en tout cas en rien comparables à celles, autrement dures, qui régnaient, en particulier, à Gurs où sa femme Frieda était détenue au même moment - qu’Einstein connut donc, comme lui, dans la poudrerie désaffectée de Bassens. Jacoby raconte :
Nos châlits étaient installés dans un immense entrepôt. Il y avait en outre encore un bâtiment dans les diverses pièces duquel se trouvaient des lits qui furent occupés, peu après notre arrivée, par des hommes appartenant à des classes d’âge plus anciennes qui avaient été internés entre-temps [...]. Au milieu du terrain de la fabrique se dressaient quelques tours à poudre inachevées, pas très hautes et qui étaient recouvertes d’arbres et de buissons qui avaient pu se développer ici tranquillement pendant vingt ans. Ce coin ne tarda pas à s’avérer très intéressant pour moi. Tous les matins, il fallait nous mettre en rangs afin que puissent être choisis des hommes dont on avait besoin sur le port de Bordeaux pour des travaux de chargement. En général, le nombre d’hommes requis était facilement réuni parce que beaucoup étaient heureux de sortir du camp et de gagner de l’argent de poche. En principe, les travaux intérieurs - avant tout le nettoyage des dortoirs - devaient être exécutés par ceux qui n’étaient pas aptes au travail sur le port, mais, pratiquement, ils étaient pris en charge par un groupe d’homosexuels - des Allemands de l’étranger - qui voulaient rester entre eux. Mais comme tout le monde devait être affecté à une tâche, le mieux était - quand on préférait malgré tout ne pas être envoyé sur le port - de se faire invisible. Le secteur des tours à poudre était tout à fait désigné pour cela, et c’est là que je passais le temps entre les repas avec un livre. Je pouvais alors, quand il faisait beau, m’exposer au soleil, et quand il faisait mauvais, trouver à m’abriter.
[76]Cependant, l’avance des troupes allemandes en France se faisait de plus en plus inquiétante : entrée victorieusement à Paris le 14 juin, la Wehrmacht poursuivit aussitôt en direction de l’Aquitaine, alors que le gouvernement français s’était replié à Bordeaux et qu’y affluaient, depuis le 20 mai, des masses de réfugiés venus de Belgique, du Luxembourg, des départements du nord de la France et de la région parisienne. Dans cette marée humaine, qui créa dans la capitale girondine de gigantesques problèmes de circulation, de logement et de ravitaillement, étaient noyés aussi de nombreux émigrés du III
e Reich qui avaient échappé jusque là, d’une façon ou d’une autre, aux internements ordonnés par le gouvernement français depuis le début de la "drôle de guerre", des hommes et des femmes isolés, mais aussi des couples avec ou sans enfants, des gens aux abois, poussés à l’exode vers le sud par la peur bien compréhensible de tomber aux mains des nazis qu’ils avaient fuis pour raisons politiques et/ou raciales.
[77] C’est la même angoisse que vivaient au même moment les internés de Bassens et de Libourne comme ceux de Gurs, angoisse accrue par le sentiment d’être déjà pris au piège et à la merci de gardiens français capables de les livrer aux Allemands, dont ils savaient l’arrivée imminente. Dans les premiers mois de l’année, la hantise d’être interné avait fait dire à Einstein dans ses conversations avec son ami Kahnweiler qu’il savait comment les choses se passeraient : ce seraient d’abord les gardes mobiles français, puis les SS qui le garderaient.
[78] Cette prophétie n’était-elle pas maintenant sur le point de se réaliser ? Comme Henry Jacoby le raconte :
Les choses finirent par en arriver au point que nous n’eûmes plus besoin d’aucune nouvelle sur la situation de l’armée allemande, car nous entendions le bruit du canon approcher d’heure en heure. Nous autres, les émigrés politiques du camp, ne doutions pas un instant que la Gestapo s’avançait avec l’armée allemande et qu’elle mettrait avidement la main sur nous. Une nuit, des coups de feu éclatèrent dans le camp. La garde avait tiré sur un avion de reconnaissance allemand volant à basse altitude.
[79] Dans la nuit du 19 juin, Bordeaux connut son premier bombardement de la guerre. Ce raid de la Luftwaffe sans objectif militaire, destiné uniquement à intimider le gouvernement français et à agir sur les nerfs de la population de la ville - où il fit 63 morts, 185 blessés et de gros dégâts matériels
[80] -, ne pouvait manquer d’avoir aussi au camp de Bassens l’effet psychologique qu’on imagine.
L’heure pouvait paraître aux détenus d’autant plus grave que le commandant du camp faisait preuve d’une incompréhension totale pour leur situation et leurs appels de plus en plus pressants pour qu’on les laissât quitter le camp. Ainsi que Henry Jacoby le rapporte, une délégation conduite par Georg Bernhard étant allée demander à cet officier d’établir des certificats de libération et de laisser partir tous les internés qui le désiraient, celui-ci répondit avec étonnement : "Messieurs, moi qui suis français, je n’ai pas peur de l’armée allemande ; pourquoi en auriez-vous peur, vous qui êtes allemands
?"
[81]Einstein ne pouvait que partager les mêmes craintes que les autres, mais à la différence de ses codétenus communistes qui semblent avoir esquissé les préparatifs d’une évasion massive, il ne put connaître le précieux soutien que, dans de telles situations, la solidarité d’un groupe animé d’un même idéal apporte à l’individu. Sans doute n’est-il pas exclu qu’il ait pu trouver alors quelque réconfort à parler avec des hommes tels que Horst Strempel, Max Raphael, Otto Freundlich et Kurt Kersten ; peut-être se rapprocha-t-il aussi à nouveau de son ancien compagnon de route et premier beau-frère Pfemfert, mais rien ne permet vraiment de l’affirmer avec certitude et, même s’il eut l’occasion de faire de nouvelles connaissances, voire de sympathiser avec tel ou tel autre détenu, on n’imagine en fait que trop bien sa solitude morale en ces jours et ces heures d’angoisse qui furent, sur les bords de la Garonne, le prélude de sa fuite tragique vers les Pyrénées, après que la dissolution officielle du camp de Bassens par son commandant ait apporté un fugitif moment de soulagement.
En effet, ayant fini par comprendre la situation des internés placés sous sa garde, le capitaine Cardineau - puisque tel était son nom - décida de les relâcher quand ils n’étaient pas signalés comme politiquement suspects, ce qui n’était pas le cas de Jacoby, par exemple, qui se vit refuser le précieux certificat de libération, mais n’en réussit pas moins à quitter le camp sans trop d’encombres.
[82] Einstein, quant à lui, devait raconter au Père Buzy, à Bétharram, qu’"à l’arrivée des Allemands [à Bordeaux], il avait dûment été élargi" et lui "montra le papier de sortie".
[83] Ce document n’ayant pu être retrouvé, on ne saurait dire à quelle date exacte il quitta Bassens, car les papiers du camp ne sont pas conservés, et pour cause. Comme le colonel commandant du camp de Gurs le fit au même moment,
[84] le capitaine Cardineau détruisit ces documents, selon ses dires mêmes, "à l’armistice" qui fut signée le 22 juin, pour éviter qu’ils ne tombent aux mains de l’ennemi.
[85]C’est quatre jours plus tard, le 26 juin, que l’on retrouve la trace d’Einstein qui fit ce jour-là, dans les Landes, sa première tentative de suicide.
[86] Depuis quand était-il libre ? Au plus depuis six jours puisque c’est du 20 que datent les premières traces de départs du camp de Bassens qui ont été conservées. Au Père Buzy, à Bétharram, Einstein devait raconter comment, quittant le camp, il "avait pris à pied la route de Mont-de-Marsan".
[87] Aucune autre précision, mais point n’est besoin d’un grand effort d’imagination pour suivre Einstein en pensée, au sortir du camp, cheminant à travers la zone portuaire de Bassens dans la seule direction possible pour aller vers les Landes, c’est-à-dire celle de l’entrée nord de Bordeaux par le célèbre pont de pierre reliant la rive droite de la Garonne à sa rive gauche - seul ou en compagnie d’autres ex-codétenus ? -, sans doute chargé du pauvre bagage qu’il avait dû traîner avec lui depuis qu’il avait quitté Paris.
Évoquant son départ de Bassens dans des conditions qui, en gros, ne peuvent qu’avoir été semblables, Jacoby écrit :
À vrai dire, je ne possédais que le strict nécessaire, mais c’était cependant plus que ce qui pouvait entrer dans le sac. J’étais d’ailleurs convaincu que la mobilité était l’essentiel et que toute charge de bagages évitable pouvait devenir un danger mortel. Comme c’était l’été, je tranchai rigoureusement la question en me prononçant contre les vêtements d’hiver. [ ...] Les gardes du camp s’étaient habitués à voir partir des groupes de détenus. Ce qui déjà devait les intéresser, c’était leur propre sort. Nous disposions en tous cas de quelques paquets de cigarettes pour aider, si nécessaire, à une négociation, et c’est ainsi que nous nous trouvâmes bientôt sur la route de Bordeaux, obligés de nous arrêter par instants pour donner au Dr May [Ernst M., médecin berlinois, ex-membre du KPD], avec sa petite valise et son petit bide, le temps de souffler. Nous pouvions lui prendre alternativement la petite valise, mais pas le petit bide.
[88] Comme bon nombre des détenus sortis du camp de Bassens, Jacoby gagna tant bien que mal la gare ferroviaire de Bordeaux-Saint-Jean pour essayer de fuir au plus vite la ville où l’arrivée des Allemands était imminente, et l’on ne peut que se demander pour quelle raison Einstein ne fit pas de même, c’est-à-dire pourquoi il ne quitta pas Bordeaux, comme Jacoby et plus d’un autre de ses ex-compagnons de détention, par un train partant encore pour Pau, Montauban et Toulouse ?
[89]En ces jours dramatiques de juin 1940, il y avait à la gare Saint-Jean une cohue indescriptible de voyageurs civils et de militaires, français - permissionnaires ou déserteurs -, des soldats tchèques et polonais aussi, qui avaient été précipitamment retirés du front.
[90] Einstein n’arriva-t-il pas à temps ou ne réussit-il pas à monter encore dans un train, tant les wagons étaient pleins de monde ? Ou alors, craignant de se noyer dans cette multitude affolée, choisit-il délibérément de tenter sa chance autrement ? Le fait est qu’au lieu de prendre en train la direction du Sud-Est, il prit celle du Sud, c’est-à-dire la route des Landes, et ce, comme il le précisa au Père Buzy, "à pied".
[91] Pour fuir donc tout seul droit devant lui, à l’aventure ? Ou avait-il un but plus précis ? Autant de questions qui restent sans réponse, le seul fait sûr étant qu’après son départ de Bassens - pour reprendre textuellement le témoignage du Père Buzy - "sa grande préoccupation avait été de fuir l’invasion des Allemands" et que "pour les éviter, il était prêt à fuir n’importe où, même à l’étranger, s’il en avait la possibilité".
[92] À l’étranger, mais où ? Einstein ne pouvait songer à l’Espagne et au Portugal qu’au même moment une multitude de réfugiés du Nord - parmi lesquels beaucoup d’émigrés du III
e Reich - cherchaient à gagner depuis Bordeaux.
[93] En effet, la victoire du général Franco avait irrémédiablement fermé la péninsule ibérique à tous les étrangers qui, pendant la guerre civile, avaient combattu dans les rangs des Brigades internationales ou ceux des anarchistes. Alors, quel autre pays Einstein pouvait-il envisager comme refuge ? L’Angleterre, certainement pas, puisque ses amis Heckroth n’avaient pu obtenir là-bas un visa d’entrée pour lui.
[94] Restait l’Amérique où il avait déjà cherché à établir le contact avec l’
American Guild for German Cultural Freedom, dont il n’avait pas reçu de réponse avant son départ de Paris.
[95] Et puis fallait-il encore, pour parvenir à destination, prendre le bateau, c’est-à-dire gagner d’abord un port en n’ayant d’autre choix que celui de Marseille, le seul de la côte méditerranéenne, de la frontière espagnole à la frontière italienne, à avoir offert à nombre de réfugiés du III
e Reich, encore après l’armistice du 22 juin, des possibilités de quitter la France.
[96] Le Père Buzy déclarera qu’Einstein lui avait dit qu’"il avait à St-Tropez un beau-frère, auquel il tenait beaucoup et qui, dès qu’il pourrait se mettre en communication avec lui, lui enverrait les subsides nécessaires".
[97] Mais le destin en décida autrement puisque dans les Landes, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Mont-de-Marsan, entre les villages de Commensacq et de Sabres, le fugitif tenta de mettre fin à ses jours.
Impossible de reconstituer exactement l’itinéraire qui mena ainsi Einstein au cœur de la Haute Lande. Mais - à moins qu’ayant quitté Bordeaux, il ait complètement divagué dans la région -, il ne peut avoir suivi qu’un chemin pour s’être retrouvé ainsi du côté de Sabres : comme un simple coup d’œil sur la carte suffit à le montrer, non la route nationale en direction de Mont-de-Marsan qui fait un léger crochet vers l’est par Langon et Bazas, mais la départementale filant, droit vers le sud, par Léognan, Saucats, Hostens, Belhade et Pissos. Il est d’autant plus probable - pour ne pas dire certain - que tel fut le trajet d’Einstein, qu’il importait hautement, dans les circonstances du moment, d’éviter les grands axes de circulation plus dangereux pour un étranger dans sa situation que les voies secondaires. Celles-ci étaient moins surveillées et le risque y était moindre d’être directement talonné par les troupes allemandes qui devaient, bel et bien, prendre la route nationale pour gagner le Sud par Mont-de-Marsan.
[98] Mais sans doute ne saura-t-on jamais dans quelles conditions - toujours à pied et toujours seul ? - et combien de temps, exactement, Einstein mit pour parcourir les quelque 78 kilomètres séparant Bordeaux de Sabres d’où il adressa le 26 juin sur une carte postale à un parent de son beau-frère Gabriel Guévrékian, Marcel Lejeune, à Saint-Tropez, ces quelques mots d’adieu, poignants de brièveté, destinés à sa femme : "Mon cher Gabriel, dites à Lyda tout mon amour pour elle. C’est fini. Charles". Le même jour, il était trouvé gisant sur la route entre Sabres et Commensacq, blessé aux deux poignets et porteur d’un billet sur lequel il avait écrit :
Mon nom est... Homme de lettres, Paris.
Je me suis tué.
Les déclarations du Père Buzy à la police après la découverte du cadavre d’Einstein au bord du gave de Pau et la lettre dans laquelle, le 23 juillet, il fit part à Gabriel Guévrékian de ce que le malheureux lui avait raconté à son arrivée au monastère de Bétharram, permettent de reconstituer avec assez de précision ce qui s’était passé. À la police, l’ecclésiastique rapporta :
Il [Einstein] déclara avoir été interné ces derniers temps dans un camp de concentration à Bordeaux ou des environs, lieu d’où il a été relâché juste quelque temps avant l’arrivée des Allemands. Afin de ne pas rencontrer les envahisseurs, pour lesquels il avait une aversion particulière, il se dirigea vers le midi. Très découragé par tous ces événements [depuis l’invasion de la France au mois de mai précédent], il [Einstein] résolut de mettre fin à ses jours ; à cet effet, avec son canif, il essaya de se sectionner les veines des deux poignets dans un bois de pins près de Mont-de-Marsan. Cela à la date du jeudi 27 ou du vendredi 28 [en fait, le 26] juin. Quelques heures après, il aurait repris ses sens, et, se traînant sur le bord de la route, il aurait été recueilli par un camion militaire qui le conduisit à l’hôpital de Mont-de-Marsan [...].
[100]Et à Gabriel Guévrékian, après avoir évoqué la libération d’Einstein du camp de Bassens :
[...] il avait pris à pied la route de Mont-de-Marsan, extrêmement accablé de la tournure des événements, persuadé que tous les efforts de sa vie intellectuelle et artistique avaient été vains et qu’il ne valait pas la peine de prolonger une vie inutile et manquée.
Dans les environs de Mont-de-Marsan, le mercredi 26 ou le jeudi 27 juin, il s’écarta dans un bois de pins et, sous le coup de ses sentiments, à l’aide de son canif, il se taillada les veines des deux poignets, "pour en finir". (Un docteur m’a dit qu’il n’atteignit pas les veines les plus profondes.)
Il perdit beaucoup de sang et resta là, pensait-il, un jour ou un jour et demi [en fait, quelques heures au plus !].
Tout à coup il se réveille de son évanouissement et se voit environné d’une clarté éblouissante, très douce, très pénétrante, et il a le sentiment que c’est Dieu. En un instant cette clarté lui montre pourquoi sa vie antérieure a été vaine, ainsi que celle des milieux intellectuels qu’il fréquentait à Paris ; il saisit où est la vérité, dans l’adhésion intégrale au catholicisme ; il sent qu’il doit réparer, en servant la bonne cause ; pour cela, il doit vivre ; il le veut.
Il ne savait pas si cette lumière fut d’un instant ou d’une heure.
Aussitôt, se traînant sur les coudes et les genoux, à cause de sa faiblesse, il se dirige vers la grand-route, où il est recueilli par un camion militaire et conduit à l’hôpital [de Mont-de-Marsan].
[101]Il est permis de spéculer sur la nature de l’éblouissement qu’Einstein aurait donc eu dans les Landes et sur l’interprétation qu’il convient d’en donner - illumination mystique véritable ou, tout simplement, impression des sens d’un blessé, victime d’hémorragie, sortant d’évanouissement ? -, mais aucun doute, par contre, n’est possible sur la vérité des faits rapportés par ailleurs.
Voici donc Einstein dans un état non désespéré, mais tout de même sérieux, transporté à bord d’un camion militaire sur une trentaine de kilomètres, des environs de Sabres à Mont-de-Marsan. Cette ville, dont la population normale s’élevait alors à quelque 14 000 âmes, avait déjà reçu beaucoup d’Espagnols de la guerre civile et était maintenant envahie de réfugiés venus du nord de la Loire sur les routes de l’ "exode". Du 30 avril au 19 juin 1940, le nombre de ces réfugiés dans les Landes était passé de 26 222 à 63 000 et, vers le 26 juin, il continuait à monter en flèche vers le chiffre record de 75 736 qu’il atteignit le 10 juillet.
[102] On comprend que, dans ces conditions, l’unique grand hôpital général du département, l’hôpital civil mixte Lesbazeilles de Mont-de-Marsan, ait connu une affluence d’autant plus importante que s’ajoutaient aux réfugiés les militaires blessés et victimes civiles évacués de la zone des combats par trains sanitaires. Comme le montre le registre des hospitalisations datant de l’époque, tout ce monde était placé aussi dans des sites extérieurs à l’établissement, ainsi que dans trois baraques A, B et C, construites pour recevoir respectivement les femmes, les jeunes filles, les hommes et les jeunes garçons.
Dans les colonnes du registre en question, à la page 10 qui couvre la période du 13 au 26 juin 1940, on lit :
Numéro d’ordre : 67.
Nom et prénoms : Einstein Carl, né le 26 avril 1885 à Neuwied.
Domicile : Bassans [!].
Dates de l’entrée : 26 juin.
de la sortie : 28 juin.
Nombre de journées. Chirurgie hommes : 2.
Prix de la journée : -
Montant : -
Observations : Baraque C.
[103]Sur la même page 10 figurent onze autres noms, ceux d’hommes domiciliés à Paris, à Verdun, à Orléans et dans des localités des départements de l’Oise et de Seine-et-Oise, tandis qu’on trouve sur les autres pages du registre beaucoup d’autre noms de personnes venues de la région parisienne et des départements du Nord, mais aussi ceux d’étrangers, en majorité des Belges.
Malgré l’encombrement de l’hôpital et les circonstances générales du moment, Einstein fut soigné apparemment au mieux dans les plus brefs délais. Comme il devait le raconter au Père Buzy, un médecin lui fit des points de suture aux deux poignets, et le voilà qui "demande l’aumônier à qui il raconte son cas et qui l’encourage".
[104] Mais du repos est nécessaire. Du 26 au 27 juin, première nuit à l’hôpital, et c’est dans la nuit suivante, alors qu’Einstein s’y trouvait toujours, que les premiers soldats allemands occupèrent Mont-de-Marsan. Le même jour - le 27 juin donc -, des détachements d’avant-garde de la 7
e armée commandée par le général Dollmann avaient fait leur apparition dans Bordeaux, pour filer directement vers le Pays basque afin de verrouiller au plus vite la frontière franco-espagnole.
[105] Dans la soirée du vendredi 28, la Kommandantur promptement installée à Mont-de-Marsan, dans un hôtel, communiquait au public l’avis suivant :
Ce soir à minuit, les pendules seront avancées d’une heure. À partir du 29 juin, les magasins seront fermés à 20 h, les cafés et hôtels à 23 h. La circulation est interdite dans les rues de Mont-de-Marsan à partir de 23 h jusqu’à 6 h du matin, sauf pour les personnes munies d’une autorisation établie par le commissaire de police et visée par la Kommandantur.
Toute personne détentrice d’une arme quelle qu’elle soit, devra en faire le dépôt immédiatement à la mairie ou au commissariat de police.
[106]Ce n’est évidemment pas un hasard si Einstein quitta l’hôpital Lesbazeilles, "furtivement, le 28", et ce, "vers 18 h", comme la police de Mont-de-Marsan devait le faire savoir par la suite à son beau-frère en précisant qu’"aucune indication n’(avait) pu être obtenue sur sa nouvelle destination" et que "ses blessures ne (semblaient) pas graves".
[107] Pour "furtif" qu’il se soit voulu, ce départ ne s’en était pas moins fait dans les règles, puisque le registre des entrées et sorties de l’hôpital en a gardé la trace.
[108] Sans précision particulière, mais, grâce au récit qu’Einstein lui-même en fit au Père Buzy, on sait, pour l’essentiel, comment les choses se passèrent.
Hospitalisé depuis l’avant-veille, le blessé avait, à l’évidence, gagné toute la sympathie du Père Jean Fôret, aumônier de l’établissement depuis 1932, un homme de 56 ans - de son âge, donc -, et c’est ce Landais de Gamarde, près de Dax,
[109] qui l’aida dans sa fuite en prenant lui-même des risques certains. Ainsi que le Père Buzy le rapporta à Gabriel Guévrékian :
[...] les Allemands arrivent à M[on]t-de-Marsan. M. Einstein veut fuir. L’aumônier lui donne des habits ouvriers : pantalon en valet chandail, veste noire usagée, casquette, sandales jaunes, et lui-même l’accompagne à travers les sentinelles allemandes jusqu’à la campagne, où, de nouveau, il monte sur un camion militaire, pour arriver à Pau, puis à Bétharram.
[110]Plus encore que Mont-de-Marsan, Pau, qui avait aussi accueilli, comme l’ensemble du Béarn, une masse considérable d’Espagnols de la guerre civile,
[111] connaissait depuis la fin mai, et surtout depuis la mi-juin, une affluence extraordinaire de réfugiés français et étrangers, beaucoup de Belges, nombre d’émigrés germaniques aussi, qui, pour la plupart, venaient de fuir la région bordelaise à l’approche des troupes allemandes. Ainsi Franz Werfel et sa femme Alma, la veuve du compositeur Gustav Mahler, qui a raconté dans ses mémoires leur rencontre avec des amis allemands dans la capitale béarnaise où "tout était réquisitionné par le gouvernement qui [ayant quitté Paris pour Bordeaux] était en partie déjà là [à Pau], en partie encore attendu de Bordeaux". "Sans patrie, sans logis, le visage creusé, écrit-elle, nous étions assis autour d’une table et avalions quelque chose d’indigne d’êtres humains".
[112] La proximité de Gurs faisait aussi que Pau voyait alors passer dans ses murs, entre autres émigrés du III
e Reich, plus d’une des presque 10 000 "indésirables" - Allemandes, Autrichiennes, Dantzigoises, Tchécoslovaques, Polonaises et autres - qui avaient été internées là-bas au début du printemps et que, dans de nombreux cas, leurs maris - eux-mêmes souvent fraîchement relâchés, comme Einstein, d’un lieu d’internement ou d’un autre - venaient chercher maintenant qu’elles avaient la possibilité de quitter le camp.
[113] Parmi ces hommes, au moins un ex-codétenu d’Einstein à Bassens, Henry Jacoby : ayant, de Bordeaux, d’abord gagné Montauban par le train via Pau, il revint dans cette ville pour aller, de là, retrouver sa compagne à Gurs. De même le journaliste socialiste Adolf Weingarten qu’il rencontra alors par hasard à son arrivée à Pau.
[114] À lire les lignes dans lesquelles Jacoby a évoqué la pagaille qui régnait alors dans la cité du "bon roi Henri", à la préfecture des Basses-Pyrénées comme à la gendarmerie et à la mairie, où il fallait faire interminablement la queue pour obtenir des autorisations de voyager,
[115] on comprend qu’Einstein ait choisi de s’en éloigner. Ayant parcouru en camion, encore convalescent, une centaine de kilomètres depuis Mont-de-Marsan pour parvenir à Pau, le samedi 29 juin, certainement épuisé par la nuit mouvementée qu’il venait de vivre, il préféra au milieu de la confusion générale - mais avait-il d’autre choix ? - faire confiance à l’aimable scout qui l’accueillit à son arrivée. Pour reprendre le récit du Père Buzy : "Le jeune homme crut avoir trouvé à Bétharram un asile où il [Einstein] pourrait refaire ses forces et se recueillir, et, le voyant trop faible pour voyager seul, il fit la bonne action de l’accompagner. " Et c’est ainsi qu’Einstein arriva le même jour, vers 16 h, au monastère des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus,
[116] à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Pau, sur la route qui mène à Lourdes.
On doit au Très Révérend Père Denis Buzy, alors supérieur général de la congrégation, de précieux détails sur le séjour d’Einstein dans cette maison depuis longtemps célèbre par les pèlerinages à l’église Notre-Dame-de-Bétharram et le grand collège libre d’enseignement secondaire, dont les vastes bâtiments furent construits vers 1860 à côté, le long du gave descendant du cirque de Gavarnie par Lourdes vers Pau. Cet ecclésiastique de 57 ans - un pur Béarnais originaire du village tout proche de Bénéjacq -, avait fait ses études cléricales à Bethléem, avant d’être ordonné prêtre à Jérusalem en 1906, puis envoyé à Rome pour y prendre ses doctorats de philosophie et de théologie. Auteur, depuis sa thèse "Introduction aux Paraboles évangéliques" soutenue en 1911, d’une série ininterrompue d’importants ouvrages bibliques, pionnier de la diffusion populaire de la Bible avec sa traduction française du Nouveau Testament en 1937, cet éminent exégète des Saintes Écritures, que l’on a pu comparer à saint Jérôme, était, aux dires de ceux qui connurent son enseignement, "un professeur très vivant, avec sa très vaste culture, sa grande clarté d’exposition et sa chaleur d’âme". C’est la haute estime dont il jouissait dans sa congrégation des Pères du Sacré-Cœur de Bétharram, qui, le 12 janvier 1935, l’avait fait élire supérieur général. Lourdes fonctions qu’il devait exercer jusqu’en 1958, date à laquelle il retourna en Palestine, où il fut nommé par le patriarche de Jérusalem supérieur-délégué des carmels de Bethléem et Nazareth et mourut en 1965.
[117]C’est incontestablement un homme exceptionnel que le destin plaça donc au bout de la route d’Einstein en ce dramatique début de l’été 1940. Un homme de Dieu, dont l’horizon et l’action dépassaient plus que largement les limites du sanctuaire pyrénéen où sa riche carrière l’avait ramené de la Terre Sainte, un prêtre exemplaire, grand théologien et non moins remarquable administrateur, mais aussi témoin douloureux des événements de son temps. Marqué déjà par la guerre d’Espagne qui avait touché plus d’un de ses Pères, anxieux depuis septembre 1939 du sort de ses "40 mobilisés", dont le départ avait laissé de grands vides dans les œuvres de la Congrégation, il devait être bientôt meurtri par l’annonce des premières victimes - dont son cousin, prêtre lui aussi, et un autre Père, tués au front, un autre mutilé, beaucoup prisonniers -, tandis que la maison de Bétharram même, loin de rester à l’écart du "déferlement tragique des réfugiés", était réquisitionnée en partie, ainsi que l’a rapporté le Père Duvignau, pour un hôpital de 338 lits.
[118] Bref, on comprend que le Père Buzy ait reçu avec grande sollicitude le malheureux qu’un scout amena donc à Bétharram le 26 juin, au milieu de l’après-midi. Dans sa lettre à Gabriel Guévrékian, il a raconté comment, "appelé au parloir, (il eut) avec M. Einstein une première longue conversation d’une heure ou d’une heure et demie", durant laquelle celui-ci lui raconta "toute son histoire" et comment, poursuit-il, "je finis par trouver dans notre collège attenant une chambre où il [Einstein] serait à l’abri, où il trouverait la solitude et le recueillement dont il disait avoir grand besoin".
[119] On apprend aussi par la déposition faite à la police par le Père Buzy que le nouveau-venu "demanda à être hospitalisé pour quelques jours". Le Père raconte :
[120]Le voyant dans une grande nécessité physique et morale, j’acceptais de le recevoir. Le lendemain, dans un long entretien qu’il eut avec moi, il me déclara, pièces à l’appui, s’appeler Carl Einstein ; être le neveu du savant du même nom ;
[121] être né en 1885 ; être juif allemand et domicilié à Paris depuis 1925, date de son départ d’Allemagne.
[122] Il ajouta être un homme de lettres, qui écrivait et donnait des conférences ; avoir sa femme à Paris et son gendre mobilisé dans l’armée française.
[123] Il précisa même avoir contracté en septembre 1939 un engagement dans la Légion garibaldienne.
[124] Il dit également être en relations avec Jacques Maritain et Marcel Schwob.
[125]Et de poursuivre :
Il est resté à Bétharram la nuit du 29 au 30, toute la journée du dimanche 30 juin et toute la matinée du lundi 1
er juillet. Il passa son temps à lire des ouvrages qu’il nous demanda. À ce moment-là, il témoignait de dispositions excellentes, disant qu’il voulait travailler encore et servir la bonne cause. Il semblait vouloir prolonger son séjour à Bétharram en raison de sa solitude, pour y poursuivre, disait-il, son évolution mentale. Il n’avait qu’une préoccupation : être réclamé par les Allemands ; moins à cause de lui-même, qu’à cause de son nom.
[126] Il me dit qu’au cas où il viendrait à être demandé, pour ne pas nous créer d’ennuis, il partirait. Le dimanche soir, je le revis une dernière fois et il eut une conversation très calme et très élevée, ne laissant en rien soupçonner une nouvelle tentative de suicide.
Le lundi matin 1er juillet, il prit chez nous son petit déjeuner, se déclara très reconnaissant de l’accueil dont il était l’objet. Il ne reparut pas pour le déjeuner de midi. Il avait laissé sur sa table les livres qu’on lui avait prêtés et partit sans rien dire à personne.
Le dimanche 30 juin, la sœur infirmière du collège lui refit le pansement des deux poignets.
[127]En dehors des éléments de ce récit avec lesquels elle se recoupe, la lettre du Père Buzy à Gabriel Guévrékian apporte des précisions du plus grand intérêt sur les dispositions d’esprit d’Einstein en ces derniers jours de sa vie. Le prêtre écrivait :
[128] À Bétharram, je l’ai trouvé dans des dispositions admirables. Esprit très élevé, conversation tout intellectuelle et spirituelle ; âme transformée par sa lumière du bois des pins [dans les Landes] ; cœur tout attiré vers le baptême, l’Eucharistie...
"Je voudrais, me disait-il, rester ici où vous êtes si bon pour moi, m’y recueillir q[uel]q[ues] jours, y recevoir le baptême. Je partirai ensuite. Si les Allemands venaient ou me réclamaient, vous me donneriez encore le repas du soir, et je partirais dans la nuit vers mon destin. Car je ne voudrais vous causer aucun embarras..."
Il avait demandé les "Confessions" de s[aint] Augustin, les "Pensées" de Pascal, un Nouveau Testament, un catéchisme.
Je le revis dans la soirée du dimanche 30, pendant une heure et demie. Plus apaisé. Plus attiré que la veille. Heureux comme jamais, me disait-il. La sœur infirmière lui avait refait les pansements des poignets qui étaient en bon état. Il souffrait beaucoup moins, et son bien-être spirituel dominait toutes les souffrances.
Il m’a reparlé de vous et de sa femme. "Elle est catholique et sera très heureuse de ma conversion.
[129] J’ai gagné beaucoup d’argent, mais avec elle nous sommes d’accord pour vivre pauvrement et tout donner aux artistes dans le besoin..."
Il fut entendu que, le lundi matin, il assisterait à ma messe. Il y assista en effet et, au retour et au petit déjeuner, exprima sa joie à la sœur infirmière.
Rien ne laissait prévoir un brusque changement.
À midi, il ne se présenta pas au déjeuner. On crut qu’il s’était attardé dans les bosquets voisins. Mais il ne reparut plus. Il avait laissé les livres sur sa table, à l’exception du Nouveau Testament et du chapelet que je lui avais donnés. On ne trouva pas de mot de lui. Il ne fit ses adieux ni à la sœur ni à aucun de nous.
J’eus tout de suite le pressentiment du drame que rien cependant ne me laissait prévoir.
Et, en post-scriptum, ce détail émouvant : "Avec les livres, sur la table de sa chambre, M. Einstein a laissé sa pipe - usagée - dans une petite housse neuve. Je la tiens à votre disposition, si vous la désirez. Il n’a rien laissé d’autre".
[130]Il paraît incontestable qu’un dialogue profondément grave s’était noué entre les deux hommes dans un climat de sympathie et de confiance réciproques. De même, on ne saurait douter un instant de la sincérité du Père Buzy, quand il écrivait dans sa lettre à Gabriel Guévrékian :
De cette mort tragique j’ai ressenti un chagrin extrême. Je m’étais vivement attaché à M. Einstein, et j’aurais voulu lui permettre d’achever "son évolution" dans un cadre de solitude et de sympathie. Dieu ne l’a pas permis.[...]
L’âme du cher disparu m’a paru si élevée, si spirituelle, si près du Bon Dieu, que, malgré une fin si tragique, j’ai bon espoir qu’elle aura trouvé grâce auprès du Dieu de miséricorde.
Sans doute ceux qui connurent le Père Buzy ont-ils vanté "les trésors de sa spiritualité toujours riche de sève biblique et son expérience unique de directeur d’âmes".
[131] D’aucuns sont même allés jusqu’à qualifier de "séducteur" son sourire, "tant il avait de pouvoir sur les cœurs" :
À travers ce sourire, c’est une âme qui se livrait, une âme où s’irradiait admirablement la grâce de Dieu. On y sentait brûler une flamme dont l’ardeur communicative pénétrait en s’insinuant, jusqu’à prendre possession des cœurs presque à leur insu, et dès lors, elle les retenait captifs.
[132]Mais si puissant qu’ait été ce charisme, on ne peut que s’interroger sur l’"évolution" qui, sous cette action, aurait donc amené Einstein à manifester l’intention de se convertir au catholicisme.
[133] Que penser de ses confessions, des pieuses lectures chrétiennes qu’il demanda et de sa présence, le matin du lundi 1
er juillet, à la messe célébrée par le Père Buzy, après laquelle il disparut en emportant apparemment le chapelet et le Nouveau Testament que celui-ci lui avait donnés ? Il y aurait certainement erreur à penser qu’il a, à dessein, abusé ce prêtre par ses actes autant que par ses propos, car on retrouve là, comme on a dit, "des accents profonds de vérité dans l’affirmation d’Einstein cherchant la lumière et l’absolu et - peut-être - le refuge de la religion, tentation qu’il a éprouvée tout au long de sa vie et qu’il a toujours repoussée même à l’ultime seconde".
[134] Autre question : le Père Buzy n’a-t-il pas eu trop tendance à interpréter dans le sens de son désir évident de "sauver une âme" le besoin élémentaire d’un homme aux abois de se raccrocher à l’espoir d’une protection surnaturelle ? Sans doute. Reste en tout cas, à l’origine de la tragédie qui allait se jouer sur les bords du gave, le fait que, même hors de portée, pour l’instant, des griffes nazies dans son refuge béarnais, Einstein se sentait traqué et était à l’évidence plus que jamais terrorisé à l’idée d’être rattrapé par l’horreur hitlérienne.
"Il n’avait qu’une préoccupation", nota le Père Buzy, "être réclamé par les Allemands, moins à cause de lui-même, qu’à cause de son nom." Son nom était, en effet, celui de l’illustre physicien avec lequel sa famille n’avait en fait aucun lien de parenté attesté,
[135] - mais dont cependant il se présenta à Bétharram comme le neveu
[136] - et ce nom, les autorités du Reich hitlérien l’avaient inscrit dès la première heure sur leur liste des "ennemis du peuple allemand" déchus de leur nationalité : depuis son émigration dès 1933, Einstein ne cessait-il pas d’alerter l’opinion internationale contre le péril brun ?
[137] Assurément, on n’imagine que trop bien le sort que la Gestapo aurait réservé au juif ex-spartakiste, ex-combattant antifasciste en Espagne et théoricien d’un "art dégénéré" Carl Einstein, au cas où elle l’aurait capturé, mais il convient de noter que, jusqu’à preuve du contraire, celui-ci ne fut jamais, comme cela a été écrit,
[138] officiellement déchu de la citoyenneté allemande ni nommément inscrit sur les listes noires des nazis. En tout cas, son nom n’apparaît pas sur la fameuse "liste Hagen", c’est-à-dire la liste de tous les Allemands réputés ennemis du régime hitlérien, réfugiés en France - y compris les ex-volontaires des Brigades internationales -, dont disposait le redoutable capitaine SS Herbert Hagen, celui qui installa la Gestapo à Bordeaux et dont une des principales missions était précisément de faire la chasse aux émigrés du Reich dans le Sud-Ouest.
[139] Mais pourquoi Einstein quitta-t-il aussi précipitamment le havre de paix et de sécurité au moins momentané qu’il avait trouvé auprès des Prêtres du Sacré-Cœur de Bétharram ? Le Père Buzy avait son idée sur la question et ne doit pas avoir été loin de la vérité quand il écrivait :
[...] je reconstitue hypothétiquement les faits de la manière suivante.
Le lundi matin, 1er juillet, il [Einstein] a dû être brusquement repris par un accès de neurasthénie, en dépit de l’hospitalité indéfinie qui lui était offerte et des attentions de tout genre que nous et les sœurs avions pour lui (on le servait à part, et [il] n’avait à faire [sic] à personne...). Peut-être l’obsession des Allemands !
Il aura erré le mardi et le mercredi dans la région. Le mercredi soir, il aura été de nouveau sous le coup irrésistible d’une obsession semblable à celle du bois de M[on]t de Marsan...
[140]En fait, tous les scénarios sont possibles pour les derniers jours d’Einstein, du lundi 1er juillet, où il quitta le monastère de Bétharram dans la matinée, au moment de son suicide dont il n’est pas possible de déterminer précisément la date et le lieu. Car rien ne permet d’affirmer avec une certitude absolue, comme il est évidemment plus que tentant de le penser, que le malheureux s’est jeté, à Lestelle-Bétharram même, du pont élevé qui enjambe le gave directement devant le monastère.
En ce qui concerne la date, on remarquera que le Père Buzy a situé l’instant fatal dans la soirée du mercredi 3 juillet, alors qu’Einstein, d’après les actes officiels, s’est suicidé le vendredi 5,
[141] jour où, toujours selon la lettre de l’ecclésiastique à Gabriel Guévrékian, "le journal local annonça qu’on avait trouvé, au gave, le cadavre d’un homme qui portait des marques suspectes".
[142] Or paraissaient alors à Pau, non pas un journal local, mais deux,
le Patriote et
l’Indépendant, et ni l’un ni l’autre n’a donné cette nouvelle le jour indiqué.
[143] Bien que fort surprenante de la part du Père, l’erreur est manifeste et laisse entière la question de savoir ce qu’Einstein a fait entre son départ de Bétharram et le moment de son suicide. Il aurait erré dans la région, non pas deux jours - comme le pensait le Père Buzy -, mais quatre, du lundi 1
er au vendredi 5 juillet, jour où, d’après les constatations du médecin légiste, le drame se serait produit.
[144] Mais dans quelles conditions Einstein, s’il ne se jeta pas du pont de Bétharram dans le gave immédiatement après être sorti du monastère, vécut-il ce ou ces ultimes journées et nuits de sa vie ? En vagabond solitaire fuyant farouchement, tel un animal aux abois, tout contact humain, ou rencontra-t-il encore certaines gens, au hasard de l’errance qui se termina à quelques kilomètres, à peine, de son point de départ ? Comment, dans cette hypothèse, expliquer qu’au bout de plusieurs jours il se soit encore trouvé là - si près de Bétharram et, finalement, si près aussi de la ligne de démarcation séparant depuis peu la zone occupée de la zone libre -, alors que l’impératif élémentaire qui l’avait guidé depuis son départ de Bassens était de mettre à tout prix la plus grande distance possible entre les troupes allemandes et lui ?
On peut penser que le calcul d’Einstein - si tant est que la panique ne lui ait pas fait perdre complètement la tête et qu’il ne se soit immédiatement suicidé après avoir quitté le monastère - était de fuir le Béarn et de gagner la Provence, la seule région de la zone non occupée où se trouvait un proche susceptible de lui offrir, au moins momentanément, un refuge - le parent de son beau-frère, à Saint-Tropez, auquel il avait adressé des Landes ses mots d’adieu à sa femme
[145] -, la seule région aussi offrant un port - celui de Marseille - d’où il était encore possible - mais Einstein le savait-il ? - de quitter la France. Encore fallait-il, pour y arriver, avoir l’autorisation de voyager sans laquelle, en cas de contrôle de police, un étranger dans sa situation, plus que tout autre, ne pouvait que s’attendre à de sérieux ennuis, l’obtention du précieux document étant elle-même déjà une opération non dénuée de danger, parce que dépendant aussi de vérifications policières. Einstein ne peut qu’avoir espéré s’échapper de la véritable nasse que le Sud-Ouest représentait pour lui, du fait que la frontière de l’Espagne lui était fermée, mais ayant peut-être envisagé de le faire en prenant le train à Pau, ne parvint-il pas, au milieu de la cohue générale régnant alors dans la ville, à se faire délivrer le sauf-conduit nécessaire ? Peut-être aussi que, découragé par les difficultés de l’entreprise avant même de l’avoir tentée, il revint sur ses pas pour errer, à la recherche d’une autre possibilité de fuir loin de là, dans le secteur où il devait finalement mettre un terme à sa vie, c’est-à-dire quelque part sur le cours du gave de Pau, depuis le pont de Bétharram jusqu’à quelque treize kilomètres environ au sud et en aval de cette ville, là où est situé le village de Boeil-Bezing qu’une quinzaine de kilomètres, par la route, séparent de Lestelle-Bétharram.
Les archives de la commune de Boeil-Bezing conservent dans les registres d’état civil un acte ainsi conçu :
[146] Le sept juillet mil neuf cent quarante, neuf heures. Nous avons constaté le décès paraissant remonter à deux jours,
[147] de Einstein Carl, né le vingt six avril mil huit cent quatre vingt cinq à Nieuwied [Neuwied] (Allemagne), écrivain, fils de David Einstein et de Lichtenstein [Lichstenstein] Sophie, domicilié à Paris, 50 rue de Vavin (6
e arrond[issemen]t),
[148] présumé célibataire. Le corps a été trouvé sur le territoire de notre commune, dans le lit du gave de Pau au lieu dit "Pont de pierre". Dressé le neuf juillet mil neuf cent quarante, dix-huit heures, sur la déclaration de Bordenave-Magendie Jean, soixante ans, cultivateur, qui a découvert le cadavre, domicilié en cette commune, qui lecture faite a signé avec Nous, maire de Boeil-Bezing.
Le même jour, mardi 9 juillet 1940, on pouvait lire dans le journal palois
le Patriote, sous le titre "Un noyé suspect à Boeil-Bezing", l’article suivant :
[149]Ce matin lundi [8],
[150] un noyé a été repêché dans le Gave, à Boeil-Bezing.
Comme le cadavre présentait des plaies suspectes, la gendarmerie de Nay a avisé le parquet.
Un transport a eu lieu cet après-midi, composé de MM. Bergé, substitut du procureur de la République ; Pons, juge d’instruction ; Aussepé, greffier ; Dr Marsoo, médecin-légiste, accompagné des inspecteurs de la police mobile.
Et dans
l’Indépendant, l’autre feuille locale de l’époque, les lignes suivantes qui apportaient quelques détails supplémentaires sous le titre "Un cadavre portant des blessures suspectes est découvert sur les bords du Gave" :
[151]Ce matin,
[152] on a découvert sur les rives du Gave, près de la passerelle de Boeil-Bezing, le cadavre d’un homme paraissant âgé d’environ 45 ans et qui était presque complètement dévêtu.
Le cadavre portant des blessures suspectes, le parquet de Pau, composé de M. Pons, juge d’instruction, Bergé, substitut, et Aussepé, greffier, s’est rendu sur les lieux dans le courant de l’après-midi.
C’est du même mardi, 9 juillet 1940, que date aussi le rapport circonstancié dans lequel l’inspecteur Émilien Amalric écrivait à son supérieur, le commissaire divisionnaire, chef de la 17e brigade régionale de police mobile, à Pau :
J’ai l’honneur de vous rendre compte que, conformément à vos instructions et à celles contenues dans la commission rogatoire de Mr le juge d’instruction près le tribunal de Pau, en date du 8 juillet courant, je me suis livré à d’actives recherches en vue d’une part : 1° Identifier le cadavre découvert le 7.7.1940, dans le gave de Pau, commune de Boeil-Bezing (B[asses]. P[yrénées].) ; 2° d’identifier le praticien qui a pratiqué les cinq points de suture relevés à l’autopsie sur les poignets du cadavre.
À cet effet, mes recherches se sont limitées dans le périmètre Pau-Bétharram, où elles ont été couronnées de succès.
Constatations : - À notre arrivée sur les lieux à Boeil-Bezing, en compagnie de MM. Bergé, substitut de Mr le procureur de la République, Pons, juge d’instruction, son greffier, et le médecin légiste, le Dr Marsso, nous nous sommes trouvés en présence du cadavre d’un homme assez bien conservé encore, âgé de 50 ans au moins, complètement chauve ; rasé ; barbe et cheveux grisonnants ; d’une forte corpulence ; d’une taille de 1m 70 ; très mauvaise dentition, n’ayant plus que trois dents à la mâchoire supérieure (côté gauche) et trois à la mâchoire inférieure, dont une en or (côté droit) ; complètement dévêtu, n’ayant que des chaussettes grises en laine et des espadrilles aux pieds et le reste d’un caleçon au bas des jambes. - Enfin, un point essentiel, sur chaque poignet, une trace de sectionnement laissant apparaître une cicatrice horizontale de six à sept cm de long ; contenue par des points de suture faits proprement avec du crin de florence : deux sur le poignet droit, trois sur le poignet gauche.
Investigations : - De nos constatations faites la veille avec le concours de mon collègue Rémy, il nous apparut que le cadavre de cet homme était celui d’un juif allemand. En effet, outre son faciès particulier, nous avons relevé une preuve indicielle, à savoir que cet homme avait subi l’opération de la circoncision - opération particulière aux juifs - bien que pouvant être pratiquée sur un sujet quelconque à la suite de certaine maladie.
À défaut de papiers et d’effets vestimentaires, ces remarques m’ont amené à rechercher si cet homme n’aurait pas été soigné soit dans un hôpital, soit par un médecin de notre région. C’est ainsi, que de Pau jusqu’à Bétharram, j’ai vu tous les hôpitaux, hospices, et médecins civils et militaires, mais vainement.
À Bétharram, j’ai vu monsieur Germain, médecin chef de l’hôpital militaire, lequel m’a été d’un précieux concours. Cet officier m’a conduit devant le supérieur général du collège de Bétharram, où j’ai pu enfin retrouver trace du passage du sujet de nos recherches.
Et l’inspecteur Amalric de rapporter ensuite longuement le témoignage de "Monsieur Buzy, Denis, 57 ans, supérieur général des Prêtres du Sacré-Cœur de Bétharram", qui lui avait fourni les informations que l’on connaît sur le séjour d’Einstein dans la maison de sa congrégation et ses entretiens avec lui. Et pour terminer :
Monsieur Buzy, [...] à qui nous avons présenté la photographie du cadavre, a reconnu la personne qu’il avait hébergée, se disant Einstein (Carl). Cet ecclésiastique avait également remarqué la mauvaise dentition du susnommé.
Si on s’en rapporte à la déclaration du supérieur général Buzy, qui jouit à Bétharram d’une grande notoriété, il semblerait que toute idée de crime doive être écartée.
[153]De son côté, le Père Buzy rapporta à Gabriel Guévrékian le déroulement de l’enquête en ces termes :
[154]
Le vendredi 5, le journal local annonça qu’on avait trouvé, au gave, le cadavre d’un homme qui portait des marques suspectes. Je n’y fis pas attention. Mais le 7, un confrère me rapportait cet entrefilet, lorsqu’un inspecteur de police se présenta.
Il était parti des blessures des poignets et faisait le tour de tous les hôpitaux de la région, à la recherche du docteur qui aurait pratiqué les points de suture.
Un court entretien avec le policier me convainquit de la triste identité. Le soir, on me porta la photo du cadavre. Malgré la boursouflure de la tête, je n’eus pas de peine à le reconnaître. C’était bien Karl [!] Einstein, notre hôte de 48 heures.
La photo, dont parle le Père Buzy, fait partie du dossier conservé aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, à Pau, sous la cote 1031 W 228 : "Suicide du juif allemand Einstein, Carl, né en 1885. Cadavre découvert à Boeil-Bezing, le 7 juillet 1940. N° 4646. Affaire 83. Pau, le 10 juillet 1940. Le commissaire divisionnaire". Il comprend quatre pièces : le rapport d’enquête de l’inspecteur Amalric au commissaire divisionnaire, chef de la 17
e brigade régionale de police mobile, daté de Pau, le 9 juillet 1940,
[155] la lettre dudit commissaire au préfet des Basses-Pyrénées, datée du lendemain et résumant le précédent rapport,
[156] deux photographies du cadavre qui soulèvent de nombreuses questions auxquelles il paraît bien difficile de répondre. L’une présente le corps tout entier, complètement dénudé jusqu’en dessous des genoux,
[157] allongé sur des planches et curieusement enroulé d’une grosse corde,
[158] la tête reposant, face tournée vers le ciel, sur une sorte de poutrelle transversale.
[159] L’autre photo, qui ne montre que le buste, permet de mieux constater l’état horrible du visage tuméfié et tout gonflé après son séjour de deux jours - ou plus - dans les eaux du gave. A l’évidence, l’identification de ce cadavre, découvert sans aucun papier ou objet personnel, d’un homme totalement étranger à la région n’aurait pas été aussi rapidement possible sans le concours du Père Buzy. À son arrivée à Bétharram, Einstein lui avait présenté ses papiers d’identité,
[160] en sorte que le religieux put fournir à la police tous les renseignements d’état civil concernant son hôte de deux jours qui furent aussi très précisément transcrits dans l’acte de décès dressé le 9 juillet par le maire de Boeil-Bezing.
[161]Cependant la presse locale tarda quelque peu à faire connaître au public les résultats de l’enquête qui avait si rapidement abouti. Le mercredi 10 juillet, La France de Bordeaux et du Sud-Ouest en était encore à annoncer dans son édition des Basses-Pyrénées, reprenant la nouvelle publiée la veille par l’Indépendant et le Patriote :
Sinistre trouvaille.
Lundi matin [8], on a découvert aux abords de la passerelle de Boeil-Bézing le cadavre d’un homme paraissant âgé d’environ 45 ans, et qui était presque complètement dévêtu.
Ce cadavre portait des blessures suspectes, la gendarmerie de Nay a alerté le parquet de Pau qui s’est rendu sur les lieux, dans l’après-midi, composé de MM. Pons, juge d’instruction, Bergé, substitut, et Aussepé, greffier.
[162]Le même jour, c’est l’Indépendant qui, dans un article intitulé "La police mobile tente d’identifier le cadavre retrouvé à Boeil-Bezing", donnait ces détails supplémentaires :
Ainsi que nous l’avons relaté précédemment, le parquet de Pau s’est rendu lundi à Boeil-Bezing où le cadavre d’un inconnu, presque entièrement dévêtu, a été trouvé au bord du gave.
De l’examen auquel s’est livré le Dr Marsoo, médecin-légiste, il résulte que l’inconnu présentait aux deux poignets des blessures récemment suturées par un médecin.
La police mobile s’efforce donc de trouver dans la région le médecin qui a pratiqué des points de suture aux poignets d’un homme, ce qui permettra sans doute d’identifier le cadavre de Boeil-Bezing.
[163]Et le 12 juillet, La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, décidément encore retard, revenait en ces termes sur "la macabre découverte de Boeil-Bézing" :
Nous avons parlé hier de la découverte faite à Boeil-Bezing d’un cadavre d’homme intégralement nu. Des constatations d’usage, il ressort que le corps portait au poignet des marques de points de suture nombreux. En conséquence, on recherche dans la région un médecin ayant pratiqué cette opération.
Par ailleurs, l’enquête en cours se poursuit.
[164]Pourtant, la veille déjà,
le Patriote, de Pau, avait fait connaître les résultats de l’enquête dans l’article suivant :
[165]Un juif allemand, neveu du physicien Einstein, s’est suicidé près de Boeilh[!]-Bezing.
Nous avons relaté la découverte dans le Gave, à Boeilh[!]-Bezing, du corps d’un homme inconnu. Il vient d’être identifié.
Il s’agirait d’un israélite allemand, Karl [sic] Einstein, neveu du célèbre physicien [!], lequel, fuyant le nazisme, se trouve actuellement aux Etats-Unis.
Karl [sic] Einstein, qui, en tant que sujet allemand, avait été interné dans un camp de la région de Bordeaux, avait été libéré, à la suite de l’armistice.
Le malheureux, dans la crainte d’être appréhendé par les troupes allemandes, avait tenté de se suicider dans la forêt, près de Mont-de-Marsan, en se tailladant les poignets.
Recueilli par un camion militaire français, il avait été conduit en Béarn, hospitalisé et soigné.
[166]Il y a quelques jours, il arrivait à Bétharram et demandait asile au R.P. Buzy.
Celui-ci, découvrant ses blessures non encore cicatrisées, lui fit donner quelques soins.
Mais le malheureux proscrit mit bientôt et définitivement sa funeste détermination à exécution en se jetant dans la rivière.
Petit drame lamentable du grand drame européen.
Cet article contraria fort le Père Buzy qui écrivait douze jours plus tard au beau-frère d’Einstein :
[...] la police, après les conversations répétées qu’elle a eues avec moi, a fait paraître dans les journaux, sans m’en avoir demandé l’autorisation ni m’en avoir prévenu, un résumé de mes informations. J’en ai été très peiné. J’aurais voulu le lire. Je n’ai pu me le procurer. On m’a dit du reste qu’il n’y avait rien d’offensant ni pour le défunt ni pour moi. Mais je n’aurais pas voulu que son nom ni le mien fussent ainsi livrés à la publicité.
[167] Le 12
juillet, c’est
l’Indépendant qui, à son tour, avait fait savoir à propos du "noyé de Boeil-Bezing" :
[168] Une rapide enquête de la police mobile a permis d’identifier le cadavre trouvé lundi sur les rives du gave.
Il s’agit d’un réfugié allemand nommé Carl Einstein, 53 [55] ans, homme de lettres et conférencier, neveu du célèbre physicien allemand [!].
L’enquête a permis d’établir que Carl Einstein, interné dans un camp de concentration de la Gironde, avait été libéré à l’approche des armées allemandes et s’était tout d’abord réfugié à Mont-de-Marsan [ !] où il avait tenté de se suicider en se coupant les veines des poignets.
[169]Après avoir été soigné, il était parti pour les Basses-Pyrénées où il avait été recueilli par les Pères de Bétharram qui l’avaient nourri, réconforté et soigné, mais le 1er juillet, Carl Einstein disparaissait et il est évident qu’il s’est jeté volontairement dans le gave.
Nouvelle reprise, avec moins de précisions, le lendemain, samedi 13 juillet, par La France de Bordeaux et du Sud-Ouest sous le titre "Le noyé de Boeil-Bézing est le neveu d’Einstein" :
L’identité du noyé de Boeil-Bézing est connue. Il s’agit d’un israélite allemand, Karl [sic] Einstein, neveu du grand physicien.
M. Einstein, qui avait déjà essayé de mettre fin à ses jours en s’ouvrant les poignets, mais avait été soigné et hospitalisé, réussit à tromper la surveillance des ecclésiastiques qui lui donnaient refuge et se jeta dans le gave.
[170]Abstraction faite de la fausse indication - imputable à Einstein lui-même - sur sa parenté avec Albert Einstein et d’autres imprécisions minimes, les détails donnés jusqu’à la date du 13 juillet par les journaux
le Patriote,
l’Indépendant et
La France de Bordeaux et du Sud-Ouest étaient exacts pour l’essentiel. D’autant plus surprenantes sont les erreurs contenues, à propos du suicide d’Einstein, dans l’édition paloise de
la Petite Gironde du 14 juillet suivant. Au vrai, il faut, semble-t-il, renoncer à l’espoir de retrouver jamais ce numéro du grand quotidien du Sud-Ouest qui paraissait à Bordeaux.
[171] Mais il est possible de reconstituer approximativement le texte de l’article qu’il publia sur la mort d’Einstein à partir de deux résumés qui en ont été donnés, l’un par Claude Laharie, l’historien du camp de Gurs, l’autre par Arthur Koestler dans le récit de ses pérégrinations en Béarn dans les premières semaines de l’été 1940.
Selon les indications données par Laharie, l’article relatait que, "le 13 juillet [!], Charles Einstein, plutôt que de se rendre [après son évasion du camp de Gurs !], s’(était jeté) dans le gave d’Oloron [!] et s’(était noyé) ".
[172] Quant à Koestler, il avait noté dans son journal dès le 15 juillet 1940 :
Lu dans "la Petite Gironde" que Karl [sic] Einstein s’est suicidé ; d’abord il s’est coupé une artère au camp de concentration ; on l’a sauvé et relâché [!] ; il s’est jeté dans le gave d’Oloron [!], le torrent qui passe à Navarrenx, avec une pierre attachée autour du cou [!].
[173]C’est cet article de
la Petite Gironde qu’il convient de considérer comme la source première à laquelle remonte l’indication fausse, plus d’une fois colportée d’une étude ou notice sur Einstein à une autre, selon laquelle il aurait été interné au camp de Gurs avant de se suicider.
[174] Comment expliquer cette erreur et l’accumulation de toutes les autres, à commencer par celles sur le lieu de la première tentative de suicide d’Einstein et les circonstances dans lesquelles il fut alors sauvé, pour finir par la confusion entre les gaves de Pau et d’Oloron et le détail relatif à la pierre au cou du cadavre qui n’est nullement signalée dans le rapport de police relatif à sa découverte ? Manifestement, l’auteur de cet article a poussé le manque de sérieux dans son travail de journaliste au point d’en ignorer tout de ce que la presse avait déjà fait savoir d’exact à propos de l’enquête sur le tragique fait divers de Boeil-Bezing, qui était loin d’être passé inaperçu dans la région et qui, dans la stupeur où la France de la défaite était plongée en ce chaud été de 1940, eut aussi au-delà des échos surprenants.
Émigrée en France en 1938, au lendemain de l’Anschluss, l’actrice et femme de lettres viennoise Hertha Pauli, qui se trouvait au moment du suicide d’Einstein à Lourdes avec son compagnon, le poète satirique berlinois Walter Mehring, apprit la nouvelle un plus tard, à Marseille où elle cherchait les moyens de passer en Espagne pour gagner ensuite les Etats-Unis d’Amérique. Évoquant dans ses mémoires le honteux paragraphe 19 de l’armistice signé par le maréchal Pétain, qui garantissait au gouvernement allemand la possibilité de se faire livrer par la France tous les ressortissants du Reich résidant en France dont l’extradition serait demandée, elle écrit :
Des bruits fous nous inquiétaient : qui cherche à franchir la frontière clandestinement la frontière [franco-espagnole] se voit arrêté et livré, disait-on. Il n’y en avait qu’un à avoir été refoulé, le critique d’art et spécialiste de la sculpture nègre Karl [sic] Einstein qui s’est ensuite pendu à Marseille [!], personne ne savait pourquoi.
[175]Hertha Pauli devait réussir, au début de l’automne 1940, à quitter la France pour les USA via l’Espagne, grâce à la filière mise en place à Marseille, en août 1940, par le journaliste américain Varian Fry au nom de l’
Emergency Rescue Committee, l’organisation d’aide aux intellectuels européens menacés par le fascisme que patronnait l’épouse du président Roosevelt et qui aurait peut-être pu aider Einstein. Fry raconte
:
[176] Nous apprenions par exemple que le romancier tchèque Ernst Weiss s’était empoisonné à Paris quand les Allemands avaient occupé la ville,
[177] qu’Irmgard Keun, qui avait écrit à l’époque de la République [de Weimar] le best-seller "La
jeune fille de rayonne", s’était également suicidée,
[178] que le dramaturge Walter Hasenclever avait mis fin à ses jours au camp d’internement des Milles, pas loin de Marseille, avec une overdose de véronal,
[179] que le critique d’art et spécialiste de l’art nègre Carl Einstein s’était pendu à la frontière espagnole parce qu’il ne pouvait passer [!] et qu’on avait trouvé dans la région de Grenoble, pendu à un arbre, le corps déjà décomposé de Willy [Willi] Münzenberg, le député communiste allemand devenu plus tard l’ennemi acharné des communistes.
[180]Comment est née cette rumeur du suicide d’Einstein par pendaison à la frontière franco-espagnole ou à Marseille ? Confusion avec Walter Benjamin qui, tentant de passer à pied en Espagne, fut refoulé par la
guardia civil au poste de Port-Bou, et se suicida le 26 septembre 1940, mais non en se pendant - il absorba des cachets de morphine ?
[181] Peut-être. Confusion avec Willi Münzenberg, effectivement mort pendu, lui, au milieu de l’été 1940, mais du côté de la frontière franco-suisse ?
[182] Quelles que soient les déformations que les on-dit firent subir à la vérité, il reste que, malgré les événements autrement importants qui occupaient alors tous les esprits, le petit fait divers local que fut la triste fin d’Einstein dans un coin écarté du Béarn ne passa pas inaperçu du milieu des émigrés du III
e Reich. Sans doute Arthur Koestler y fut pour beaucoup, après qu’il en ait eu connaissance à la mi-juillet par l’article lu dans
la Petite Gironde, où il était question du cadavre d’Einstein retrouvé noyé, "avec une pierre attachée autour du cou".
[183] Car Koestler eut certainement plus d’une fois l’occasion d’en parler, au hasard de ses rencontres, tout au long de ses pérégrinations qui, durant l’été 1940, le menèrent du Sud-Ouest à Marseille pour le conduire finalement en Angleterre,
[184] où il devait publier dès l’année suivante, en anglais, son récit
La lie de la terre[185] avec la dédicace suivante : "À la mémoire de mes confrères, les écrivains exilés d’Allemagne, qui se suicidèrent lorsque la France capitula : Walter Benjamin, Carl Einstein, Walter Hasenclever, Irmjard [Irmgard] Keun, Otto Pohl, Ernest [Ernst] Weiss [...]".
[186]Du côté des intellectuels parisiens qui avaient connu Einstein et que l’invasion allemande avait dispersés depuis la mi-juin 1940, on trouve aussi un écho de sa mort dans les mémoires de son amie Clara Malraux, première femme d’André Malraux, qui avait en son temps traduit
Bebuquin avec Einstein lui-même.
[187] Réfugiée dans le Sud-Ouest au hasard de la débâcle comme Jean Cassou, autre connaissance parisienne d’Einstein, Vladimir Jankélévitch et Pierre Bertaux,
[188] Clara Malraux raconte :
J’étais repliée à Toulouse quand on m’apprit que Karl [sic] était mort. C’était indiscutablement la seule issue. Mais je n’appris que plus tard les détails d’une fin qui lui ressemblait. Karl n’était pas homme de métamorphoses, ayant échoué dans sa tentative pour s’ouvrir les veines, il fut recueilli par un religieux qu’il séduisit à coups de discours édifiants. Son sauveteur rassuré à la fois quant à la volonté de vivre et le salut éternel du néophyte, Karl trompa sa surveillance, se jeta dans le gave voisin, car tout se passait près d’une Espagne interdite. Les diverses expériences de Karl prenaient dans ses récits un caractère burlesque. Pourtant le pathétique judéo-allemand l’habitait et il continuait à s’expliquer avec un Dieu, venu de la Bible, auquel il ne croyait pas.
[189] Einstein avait-il joué la comédie au Père Buzy, comme semble l’avoir pensé Clara Malraux, qui, juive elle-même - elle était née Goldschmidt -, disait de son ami qu’"intellectuellement, il était l’homme de toutes les approches nouvelles", mais qu’il eut la naïveté de " (croire) encore qu’on guérit d’être juif" ?
[190] La grande critique d’art de Zurich, spécialiste de Paul Klee et de la sculpture moderne, Carola Giedon-Welcker, quant à elle, s’est bornée, dans son livre
Poètes à l’écart paru en 1946, à remarquer à propos de la fin tragique d’Einstein :
La façon dont il est mort - fuite de l’invasion allemande, tentative de suicide, sauvé et soigné chez des moines, déguisement en religieux [!], nouvelle fuite, désespoir et, pour finir, suicide réussi - est en rapport étroit avec sa vie et le climat moral de ses œuvres.
[191]Doit-on en dire autant des circonstances dans lesquelles l’auteur de Bebuquin retourna à la terre, loin du monde de la synagogue, dans un petit cimetière communal du Béarn entourant une église catholique ?
Dans un long article paru le 17 novembre 1985 dans le quotidien Sud-Ouest, sous le titre "L’autre Einstein noyé dans le gave de Pau", le journaliste Alain Bernard a rapporté à ce sujet des détails qu’il devait au cultivateur Pierre Fouchet, ex-maire du village de Boeil-Bezing, qui lui raconta :
C’est un certain Jean Magendie qui avait retrouvé le corps le 7 juillet 1940, au pont de pierre. Je m’en souviens bien. Mon père, Barthélemy Fouchet, était l’adjoint du maire Maurice Luciat. Einstein... Einstein... On connaissait le savant, et ce nom nous avait frappés. Finalement, on a enterré ce malheureux anonymement, derrière l’église. Il y avait d’autres urgences à ce moment-là, avec tous les réfugiés qui affluaient.
[192]Aujourd’hui encore, des anciens du village se rappellent fort bien cet afflux à Boeil-Bezing et dans les environs, en ces jours dramatiques de l’été 1940, de nombreux réfugiés, dont certains venaient en particulier de Lorraine, et une habitante de la commune, qui n’était alors encore qu’une fillette, se souvient même que, dans le désordre du moment, le noyé du gave ne fut pas inhumé immédiatement, mais resta deux jours dans un cercueil de fortune, posé sur la charrette à bras servant de corbillard qui était remisée dans un abri sommaire, proche de l’ancien presbytère, en face de l’église.
[193] Aucun document n’est retrouvé à ce jour, qui permettrait de préciser la date de l’enterrement, lequel, à l’évidence, eut lieu - et pour cause - à la sauvette, sûrement en présence de quelques personnes à peine, parmi lesquelles devait se trouvait au moins un représentant de la loi, le maire ou un autre membre de la municipalité.
Pierre Fouchet était maire de Boeil-Bezing quand, le 25 mai 1966, il reçut de l’attachée culturelle à l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Paris une demande de renseignements à l’occasion de l’ouverture officielle, à l’Académie des Arts de Berlin-Ouest, d’archives Carl Einstein réunissant les papiers dits "fonds de Berlin", déposés dès 1963 par sa fille Nina Auproux, et ceux, dits "fonds de Paris", que sa seconde épouse, Lyda Guévékrian, avait confiés à l’ami Georges Braque en 1948, lorsqu’elle était retourné en Iran, son pays d’origine.
[194] Et c’est des semaines qui suivirent la demande de renseignements sur la mort d’Einstein adressée à la municipalité de Boeil-Bezing, du 5 juillet 1966 exactement, que datent les lignes - apparemment tirées d’une publication locale - qu’on trouve, relativement à sa fin en terre béarnaise, dans la première grande étude parue trois ans plus tard sur sa vie et son œuvre :
Le noyé, un certain Carl Einstein, né en 1885 en Allemagne, réfugié à Lestelle-Bétharram, fut enterré dans un coin du cimetière [de Boeil-Bezing]. Sa tombe anonyme, presque confondue avec l’allée, est proche du caveau de Bernadotte, frère du fondateur de la dynastie suédoise.
[195]Dans les annales du village, qui a conservé une grande demeure édifiée par la famille paloise des Bernadotte, on relève en effet qu’au début du XX
e siècle, le neveu de Charles-Jean XIV, le maréchal de Napoléon devenu roi de Suède et de Norvège, fut enseveli dans le caveau familial,
[196] qui se trouve non loin de l’endroit où Einstein fut enterré, sous un arbre aujourd’hui disparu, contre le mur du cimetière en surplomb de plusieurs mètres sur un champ de maïs,
[197] là où a été érigée plus tard une petite stèle sur laquelle on lit, gravé sur une plaque de marbre noir :
À la mémoire de
CARL EINSTEIN
Poète et historien d’art
Combattant de la liberté
Né le 26 avril 1885 à Neuwied, Allemagne
Il se donna la mort le 5 juillet 1940
pour échapper
à la persécution nazie.
[198]Le modeste monument doit son existence à Nina, la fille d’Einstein, qui était venue en 1968 à Boeil-Bezing avec son mari Jean Auproux. Le 14 novembre de ladite année, Daniel-Henry Kahnweiler, qui avait survécu à l’Occupation caché dans le centre de la France, lui écrivait de Paris à Sodère, dans les Pyrénées orientales, où elle demeurait :
Ma chère Nina,
J’espère que vous êtes bien rentrée [...].
Voici donc un texte dû à la collaboration de mon beau-frère et de moi. Vous me direz ce que vous en pensez et éventuellement quels changements vous aimeriez y apporter :
À la mémoire de
CARL EINSTEIN
poète et historien d’art
combattant de la révolution spartakiste et de
l’armée républicaine espagnole. Né le 26 avril 1885 à Neuwied
(Allemagne). Il se donna la mort le 5 juillet 1940 à ...
pour échapper à la persécution nazie.
On me dit qu’une plaque de marbre vaudrait mieux qu’une plaque de bronze. Je pourrais m’en charger également, bien entendu.
[199]Il convient de remarquer que Daniel-Henry Kahnweiler et son beau frère, l’écrivain surréaliste et ethnographe Michel Leiris, proposaient une épitaphe quelque peu contestable du fait qu’elle indiquait que leur ami avait été un "combattant de l’armée républicaine espagnole" : en fait, à la différence des membres des Brigades internationales, Einstein s’était engagé dans la lutte contre le franquisme, à proprement parler, non par adhésion au régime du
Frente popular et pour sa victoire ou l’instauration d’un régime soviétique en Espagne, mais pour la révolution prônée par Buenaventura Durruti et ses compagnons anarcho-syndicalistes, dont sortirait une société libertaire et égalitaire fondée sur l’action anonyme dans la masse. Mais il était tout à fait juste, parce que bien conforme à l’option idéologique fondamentale qui avait été la sienne, de le qualifier de "combattant de la révolution spartakiste" : Spartakus, en effet, "la volonté de rendre à l’être humain la possibilité d’une société humaine", comme il l’a écrit, avait bien été pour lui, en 1918-1919, l’expérience de base décisive qui devait terminer son engagement dans la guerre d’Espagne.
[200] Cependant pas plus cette formule que la précédente ne fut retenue, et c’est finalement la belle expression "combattant de la liberté" que choisirent Nina Auproux et les deux vieux amis de son père. Daniel-Henry Kahnweiler envoya alors au maire de Boeil-Bezing de quoi faire ériger dans le cimetière de la commune, à la mémoire d’Einstein, la stèle sur laquelle devait être scellée la plaque de marbre gravée qui fut réalisée à Paris. Contact fut pris par Pierre Fouchet avec un maçon du pays qui exécuta le travail, et c’est en 1975 que le petit monument fut enfin inauguré :
[201] "Heureusement, lors de l’inhumation, j’avais relevé dans ma tête l’emplacement",
[202] devait déclarer plus tard Pierre Fouchet en se rappelant l’herbe qui couvrait la fosse anonyme dans laquelle Einstein avait été enseveli trente cinq ans plus tôt.
Cependant, parallèlement aux recherches menées depuis le début des années 1960 par l’Allemande Sibylle Penkert qui donna en 1969 la première monographie sur Einstein,
[203] avait commencé, depuis quelques années, à se manifester aussi en France un intérêt nouveau pour l’œuvre du grand écrivain. Jean Laude, professeur à la Sorbonne en histoire de l’art contemporain, spécialiste des arts africains, avait frayé les voies à l’étude de cette œuvre que devait poursuivre, après sa mort en 1983, Liliane Meffre, dont il avait encouragé les premiers travaux de recherche sur l’auteur de
L’art nègre et de
L’art du XXe siècle.
[204] Arriva, en 1885, le bicentenaire de la naissance d’Einstein que le monde universitaire ne manqua pas de célébrer et qui ne passa pas inaperçu, non plus, en Béarn. Au printemps, une équipe de télévision allemande - le "Hessischer Rundfunk" - vint à Boeil-Bezing tourner une interview de Pierre Fouchet sur les bords du gave, à l’endroit où le corps d’Einstein avait été trouvé en juillet 1940, et elle alla faire aussi des prises de vue du site de Lestelle-Bétharram destinées, comme l’interview, à trouver place dans le film
Einstein ou le Dilettante du miracle, réalisé par Mechthild Rausch, qui fut diffusé l’année même.
[205] Le 17 novembre suivant, Alain Bernard, journaliste au
Sud-Ouest, présentait avec deux photos - un grand portrait et une reproduction de la plaque commémorative qu’on sait - "l’autre Einstein noyé dans le gave de Pau" dans un article substantiel de quatre colonnes retraçant les grandes étapes de sa vie et soulignant l’importance de ce "représentant et interprète des avant-gardes littéraire, artistique et politique de son époque qu’il (avait) essayé, sa vie durant, et jusqu’au désespoir, de faire coïncider pour transformer l’homme et la réalité".
[206] Ainsi l’inconnu enterré depuis 1940 dans le cimetière de Boeil-Bezing sortit-il enfin de l’oubli dont son repos en terre béarnaise était resté entouré jusque-là, pour les gens du pays aussi, et il se trouva à Pau un ancien combattant de la guerre d’Espagne, François Mazou, pour s’employer à faire revivre et honorer son souvenir au niveau local, quand bien même, dans le camp des antifranquistes, il n’avait pas été du tout, en tant qu’officier commissaire politique des Brigades internationales, du même bord que le
compañero Einstein de la colonne Durruti. C’est lui, pourtant, qui, en étroite relation avec Liliane Meffre, est à l’origine de l’association Carl Einstein, de Boeil-Bezing, dont les statuts furent déposés à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le 10 avril 1996.
[207] Des faits curieux précédèrent la naissance de l’association, que François Mazou lui-même a relatés dans des lignes destinées à un recueil de récits et de témoignages sur "Le Béarn à l’heure de la guerre d’Espagne" :
Les jours qui précédèrent la Toussaint de 1995 procurèrent à monsieur Pierre Fouchet, maire honoraire de Boeil-Bezing, de vivifiants instants d’étonnement marqués d’une pointe d’émotion. Fait pratiquement insolite, il découvrit, au cimetière, sur la tombe du citoyen allemand Carl Einstein, un imposant bouquet de fleurs. Il considéra que ce dépôt correspondait au geste d’un concitoyen du défunt, de passage en Béarn. Le lendemain, un vase de chrysanthèmes ornait la tombe ; puis vinrent s’en ajouter un autre, puis encore un nouveau. Le 1
er novembre, toute la surface de la tombe était intégralement fleurie. Ce ne pouvait être l’effet du hasard. Ce mouvement d’hommage était palois. Le 6 octobre, au cinéma le Méliès, avait eu lieu la projection-débat d’un film sur la guerre d’Espagne "Land and Freedom" du cinéaste anglais Ken Loach. Après la projection, les échanges furent vibrants, souvent passionnés [...]. Vint l’instant où fut évoquée la participation aux combats d’un nombre imposant de volontaires étrangers enrôlés, non pas dans les Brigades internationales, mais dans les forces espagnoles, comme Willy Brandt dans le POUM et Carl Einstein dans la "Columna Durruti", de tendance anarcho-syndicaliste.
[208]Et, après avoir retracé à grands traits - et non sans quelques grosses erreurs ou imprécisions
[209] - la vie d’Einstein et ses combats jusqu’à son suicide et à la découverte de son cadavre à Boeil-Bezing, puis évoqué les faits locaux concernant sa sépulture jusqu’en 1985, François Mazou de poursuivre :
Enfin, le 2 octobre 1993, un vétéran de la Brigade internationale composée d’Américains de la Lincoln Brigade, Gorge Sossenko, originaire d’Atlanta, va se recueillir et fleurir la tombe du volontaire de la liberté. Ses camarades aux USA et dans d’autres pays le félicitent et l’invitent à écrire ses observations dans le bulletin de la Lincoln Brigade The Volunteer.
En ce jour de la Toussaint, Pierre Fouchet m’a remémoré tous ces souvenirs et il m’a confié sa joie de ce que, au départ d’un débat dans la salle du Méliès, un hommage concret se soit réalisé : "Rendez-vous compte de mon émotion, alors que j’ai vu un couple d’inconnus déposer un nouveau pot de fleurs ! "
Le 11 novembre, jour de l’Armistice, l’association des anciens combattants et la mairie de Boeil-Bezing ont fleuri en commun la tombe.
L’effet de surprise dépassé, la population de la commune, échangeant ses impressions, a envisagé, par-ci, par-là, de participer à cet hommage lors de la prochaine Toussaint, en fleurissant individuellement la tombe de cet inconnu célèbre, un poète allemand, volontaire de la liberté.
Ce sera peut-être le début d’une tradition d’hommages.
[210]
François Mazou a eu, avant sa mort en 1999, la satisfaction de voir son espoir se réaliser. En effet, constituée en 1996 à Boeil-Bezing, sous la présidence du maire du moment, Jean-Jacques Pées,
[211] l’association Carl Einstein rend chaque année, à l’occasion de son assemblée générale, hommage à la mémoire d’Einstein par le dépôt d’une gerbe sur sa tombe. Et c’est à l’instigation de cette association qu’en décembre 2000, il a été décidé par la municipalité de Boeil-Bezing de baptiser une rue du village "rue Carl Einstein, combattant de la liberté". Présidée aujourd’hui par Pierre Despré, président depuis de très nombreuses années de l’association locale des anciens combattants, qui a succédé dès 1997 à Jean-Jacques Pées, l’association a pris en 2002 le nom d’"association Carl Einstein - François Mazou, combattants de la liberté », et elle poursuit aujourd’hui plus activement que jamais ses buts qui sont d’« honorer la mémoire de ce poète et historien de l’art", de "maintenir le souvenir de son engagement actif dans la lutte contre le fascisme, en particulier pendant la guerre d’Espagne", et d’"aider à promouvoir son œuvre littéraire, artistique et historique".
[212]C’est à ces fins que l’association Carl Einstein-François Mazou a, en 2003, collaboré avec la bibliothèque intercommunale de Pau-Pyrénées, l’université de Pau et des pays de l’Adour et l’institut Heinrich Mann, de Pau, à une importante manifestation, soutenue par la municipalité de cette ville et le conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques : "1940. Les Pyrénées, ultime frontière. Carl Einstein, Walter Benjamin et Wilhelm Friedmann". Le 13 mars, fut inaugurée en la salle d’art de la bibliothèque de Pau la riche exposition présentant ces "trois intellectuels opposés au nazisme et qui avaient choisi la France". Comme le précise, après un rappel des grands événements du XX
e siècle, l’introduction de la plaquette éditée à cette occasion :
[213]Nés en Allemagne et en Autriche, peu avant le début de ce siècle, dans des familles juives, ils [Walter Benjamin, Carl Einstein et Wilhelm Friedmann] ont subi toutes ces tragédies et sont venus volontairement en France, espérant la liberté. Après la défaite de juin 1940, ils ont choisi de mettre fin à leur vie au pied des Pyrénées et à quelques pas d’ici.
Il nous a semblé qu’ils étaient réellement le symbole de toutes les actions, de toutes les souffrances et aussi de tous les espoirs et les désespoirs des victimes de ce siècle :
- Carl Einstein, le 5 juillet 1940, s’est jeté dans le gave du pont de Bétharram et il a été retrouvé à Boeil-Bezing où il a été inhumé.
- Walter Benjamin, le 26 septembre 1940, s’est donné la mort à Port-Bou où il a été inhumé.
- Wilhelm Friedmann, le 11 décembre 1942, s’est donné la mort à Bedous, et il repose désormais avec son épouse à Osse-en-Aspe.
Trois destins et trois chemins parallèles jusqu’à l’ultime frontière, devant les Pyrénées, devant l’Espagne, alors franquiste, et fermée à leur chemin vers la liberté.
[214]Accompagnée, le soir du 13 mars, de la projection du film
Toni que Jean Renoir réalisa en 1934 en collaboration avec Einstein,
[215] l’inauguration de l’exposition fut suivie, le lendemain, dans l’amphithéâtre de la présidence de l’université de Pau, d’un colloque au programme duquel figuraient cinq exposés,
[216] et que clôtura la projection, en version originale espagnole et en présence de son réalisateur, le Catalan Manuel Cusso-Ferrer, du film mi-documentaire, mi-fictionnel
La ultima frontera, qui essaie de retracer les derniers jours de la vie de Walter Benjamin et les circonstances de son suicide à la frontière franco-espagnole, dans les Pyrénées orientales.
[217] À quand le film qui montrera de même, c’est-à-dire avec autant d’intelligence et de sensibilité, l’ultime parcours de Carl Einstein et sa fin dans les eaux du gave de Pau ?
[1] Sibylle Penkert : Carl Einstein. Beiträge zu einer Monographie, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht 1969 [= PEN], p. 126-129, Liliane Meffre : Carl Einstein 1885-1940. Itinéraires d’une pensée moderne, Paris : Presses de l’Université de Paris-Sorbonne : 2002 [= MEF], p. 224, 302-305
[3] Cf. infra notes p. 32-35.
[4] Österreicher im Exil. Frankreich 1938-1945. Eine Dokumentation, hg. v. Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Wien u. München 1984, p. 105-106 ; Julius Deutsch : Ein weiter Weg. Lebenserinnerungen, Zürich u.a. : Amalthea-Verlag 1960, p. 322-323.
[5] Pierre Milza : Voyage en Ritalie, Paris : Plon 1993, p. 275-286.
[6] Une copie de ces documents conservés aux archives départementales des Landes m’a été aimablement communiquée par M. Pierre Groc (Mont-de-Marsan). Je remercie aussi très sincèrement la fille de Sante Garibaldi, Mme Annita Garibaldi (Bordeaux/Rome), qui prépare une biographie de son père, pour la documentation qu’elle a eu l’obligeance de mette à ma disposition.
[7] Milza : Voyage en Ritalie, p. 295-296.
[8] Cf. infra note 124. - Sur l’engagement de Carl Einstein dans la Légion garibaldienne, voir aussi l’article de Liliane Meffre dans le présent ouvrage.
[9] Österreicher im Exil, p. 106 ; Deutsch : Ein weiter Weg, p. 287-289.
[10] Milza : Voyage en Ritalie, p. 296-297.
[11] Barbara Vormeier : Législation répressive et émigration (1938-1939) (cité Vormeier I), in : Gilbert Badia et alii : Les barbelés de l’exil. Études sur l’émigration allemande et autrichienne (1938-1940), Presses universitaires de Grenoble, 1979, p. 159-167, ici p. 165.
[12] Barbara Vormeier : La situation des émigrés allemands en France pendant la guerre (1939-1945) (cité Vormeier II), in : Emigrés français en Allemagne. Émigrés allemands en France 1685-1945. Une exposition réalisée par l’Institut Goethe et le ministère des Relations extérieures, Paris 1983, p. 155-171, ici p. 155, 159 ; Id., Quelques aspects de la politique française à l’égard des émigrés allemands 1933-1942 (cité Vormeier III), in : Hanna Schramm et Barbara Vormeier, Vivre à Gurs. Un camp de concentration français 1940-1941, Paris : Maspero 1979, p. 179-283, ici p. 244-250 ; Id., La situation des réfugiés en provenance d’Allemagne (septembre 1939-juillet 1942) (cité Vormeier IV), in : Jacques Grandjonc et Theresia Grundtner (dir.) : Zones d’ombres 1933-1944. Exil et internement d’Allemands et d’Autrichiens dans le sud-est de la France, Aix-en-Provence : Alinea, 1990, p. 189-211, ici p. 190-192.
[14] De retour d’Espagne à Paris à la mi-février 1939, Einstein fut d’abord recueilli par ses amis, les Kahnweiler et les Leiris, et logea ensuite environ deux mois chez sa fille Nina et son gendre Jean Auproux, rue des Saints-Pères. Puis il alla habiter rue Vavin avec sa femme Lyda quand celle-ci l’eut rejoint, une fois sortie du camp de Juillac où, séparée de lui en rentrant d’Espagne, elle avait été internée jusque-là (Cf. MEF, p. 227, 302). Mais le couple ne resta apparemment pas longtemps dans cette nouvelle demeure puisqu’un document datable de septembre-octobre 1939 situe son domicile au n° 16 (ou 19 ?) de la rue Censier. - Cf. MEF, p. 256 et infra note 27.
[15] Vormeier II, pp. 155, 159 ; Vormeier III, p. 249 ; Vormeier IV, pp. 191-192.
[16] MEF, p. 303, note 190. - La liste n’est pas datée, mais il paraît hors de doute qu’elle fut établie à l’automne 1939, ainsi que l’a déjà indiqué Marianne Kröger dans sa thèse Das „Individuum als Fossil“. Carl Einsteins Romanfragment BEB II. Das Verhältnis von Autobiographie, Kunst und Politik in einem Avantgardeprojekt zwischen Weimarer Republik und Exil, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2003, p. 87, note 205. En effet, il est bien établi pour certaines des autres personnalités, dont les noms figurent sur la liste, qu’elles furent, à l’époque, internées au stade de Colombes. Cf. infra note 27.
[17] Citons, parmi les témoignages, celui d’Arthur Koestler : La lie de la terre (Œuvres autobiographiques. Edition établie par Phil Casoar, Paris : 1994, p. 1014-1029), et l’article de Magdeleine Paz paru dans le journal "Le Populaire", 12 septembre 1939, p. 1-2 (reproduit in Vormeier III, p. 287-290 : "Aux portes du camp de rassemblement des sujets allemands et autrichiens"). - Cf. Françoise Joly, Jean-Baptiste Joly & Jean-Philippe Mathieu : Les camps d’internement en France de septembre 1939 à mai 1940 (cité Joly/Mathieu), in : Badia et alii, Les barbelés de l’exil, p. 169-220, ici p. 175-178 ; Vormeier III, p. 248.
[18] Joly/Mathieu, p. 176, 178.
[19] Koestler : Œuvres autobiographiques, Chronologie, p. XLVIII-XLIX.
[20] Koestler : La lie de la terre, p. 966. - Cf. infra notes 186-187.
[22] Cf. à ce sujet Alain Ruiz, Après Carl Einstein et Walter Benjamin. La fin tragique de Wilhelm Friedmann, émigré du III
e Reich, in : Pyrénées 1940. Ultime frontière pour Carl Einstein, Walter Benjamin, Wilhelm Friedmann, Paris : L’Harmattan 2006, p. 123-171, ici p. 133-142. - Cf. infra notes 213- 214.
[23] Chryssoula Kambas, Bulletin de Vernuches. Neue Quellen zur Internierung Walter Benjamins, in : Exil, Nr. 2, 1999, p. 5-30.
[24] Koestler ne devait être relâché du camp du Vernet qu’à la mi-janvier 1940, grâce à un officier de l’Intelligence Service, avec l’aide d’André Malraux. - Cf. Koestler, Œuvres complètes, Chronologie, p. L.
[25] Chryssoula Kambas, p. 19.
[27] MEF, p. 303. - Cf. Jacques
Body : Jean Giraudoux, Paris : Gallimard 2004, p. 704.
[28] Pierre Bertaux : Mémoires interrompus, Publications de l’Institut d’allemand d’Asnières, PIA, n° 27, 2000, p. 141-142.
[29] Ainsi, par exemple, le romaniste Wilhelm Friedmann, émigré à Paris depuis 1933, qui fut utilisé à la Radiodiffusion française comme "écouteur traducteur" pour les émissions allemandes, anglaises, espagnoles, italiennes et russes. - Cf. supra note 22 et infra notes 213-214.
[30] Carl Einstein - Daniel-Henry Kahnweiler. Correspondance 1921-1939, traduit et annoté par Liliane Meffre, Marseille : Dimanche 1993 [= EKC]
, p. 116. Il existe plusieurs variantes de ces paroles rapportées par Daniel-Henry Kahnweiler. - Cf. MEF, p. 305.
[31] MEF, p. 303 ; Kröger, p. 86.
[32] MEF, p. 255 ; Kröger, p. 86.
[33] Deutsche Intellektuelle im Exil. Ihre Akademie und die „American Guild for German Cultural Freedom“. Eine Ausstellung des Deutschen Exilarchivs 1933-1945 der Deutschen Bibliothek Frankfurt a.M., bearbeitet von Werner Berthold, Brita Eckert und Frank Wende, München 1993.
[36] Vormeier II, p.155-156, 160 ; Vormeier IV, p. 194 ; Badia : Les barbelés de l’exil, p. 39.
[37] Vormeier II, p. 160 ; Schramm, p. 7-8.
[38] MEF, p. 223, 227, 300-301.
[39] Lisbeth Exner u. Herbert Kapfer (Hg) : Pfemfert. Erinnerungen und Abrechnungen. Texte und Briefe, München : belleville 1999, p. 164. - A noter que Liliane Meffre parle d’arrestation (MEF, p. 224).
[40] Koestler : La lie de la terre, p. 1091-1092. - Cf. infra notes 177-180.
[42] Koestler : La lie de la terre, p. 1092.
[43] Gero von Wimpert : Deutsches Dichterlexikon, Stuttgart : Metzler 1963, p. 126-127. - De même, Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller von den Anfängen bis zur Gegenwart, t. 2, Kronberg/Ts. : Scriptor Verlag 1974, p. 165, où il est question des « moines de Giers [sic] », chez lesquels Einstein se trouvait « à la fin », avant de se donner la mort dans les jours qui précédèrent l’arrivée des troupes allemandes.
[44] Jean-Michel Palmier : Weimar en exil. Le destin de l’émigration intellectuelle allemande antinazie en Europe et aux Etats-Unis, Paris, éd. Payot 1990, p. 387.
[45] Jürgen Serke : Die verbrannten Dichter. Lebensgeschichten und Dokumente. Erw. Neuausgabe, Weinheim u. Basel : Beltz Verlag 1992, p. 295.
[46] Vormeier II, p. 162.
[48] Claude Laharie : Le camp de Gurs 1939-1945. Un aspect méconnu de l’histoire de Vichy, Biarritz, J&D éd. 1993, p. 381.
[49] Ibid., p. 160. - Cf. infra note 172.
[52] Cf. infra notes 162-166, 168-170.
[53] Cf. infra notes 100, 120-127, et 101, 110, 119, 128-130, 140
[54] PEN, p. 128. - Cf. infra
notes 56, 100, 156, 166, 168. - À noter que "camp de concentration" était alors le terme administratif par lequel étaient officiellement désignés employé les camps d’internement pour étrangers comme celui de Gurs.
[55] Wilfried Ihrig : Carl Einstein, in : Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache, hg. v. Walther Killy, t. 3, Munich 1989, p. 213-215, ici p. 214.
[56] Souligné par Ruiz. - Cf. infra note 100.
[57] Carl Einstein 1885-1940. Une présentation de sa vie, par l’Association "Carl Einstein, combattant de la liberté", Boeil-Bezing, s.d., p. 5 ; François Mazou, À Boeil-Bezing, en 1995, in : Le Béarn à l’heure de la guerre d’Espagne. Récits et témoignages (Bulletin n° 10 de l’Association Mémoire Collective en Béarn), 1995, p. 213-216, ici p. 214. - Cf. infra note 208.
[58] Badia et
alii : Les barbelés de l’exil, hors-texte ; Anne Grynberg : Les camps de la honte. Les internés juifs des camps français 1939-1944, Paris, La Découverte 1999, p. 8 ; Denis Peschanski : La France des camps. L’internement 1938-1946, Paris, Gallimard 2002, p. 79
[60] S. Law : Georg Bernhard in London, in : Aufbau, 7
e année, n° 22, 30 mai 1941, p. 7. - Les références de cet article m’ont été aimablement communiquées par Hans-Albert Walter que je remercie très sincèrement pour son aide.
[61] Pour les développements qui suivent et leurs références, il est renvoyé ici une fois pour toutes à l’étude détaillée - et déjà très avancée "Les camps d’internement en Gironde pendant la ’drôle de guerre’" que je prépare en complément à mon article "Mai-juin 1940. Traces et témoignages d’émigrés du III
e Reich en Gironde", in : Cahiers d’études germaniques, n° 42, 2002 : Marx et autres exilés. Études en l’honneur de Jacques Grandjonc réunies par Karl Heinz Götze, p. 229-244, ici p. 238-240.
[62] Archives municipales de Bassens : registre de l’état-civil, année 1940.
[63] Werner Röder / Herbert A. Strauss (Hg.) : Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933, 3 vol., München, K.G. Saur 1999,
t. 1, p. 82-83 ; Jacques Droz (dir.) : Dictionnaire biographique de mouvement ouvrier international. L’Allemagne, Paris : Les éditions ouvrières, 1990, p. 119-120.
[64] Henry Jacoby : Davongekommen. 10 Jahre Exil 1936-1946, Prag, Paris, Montauban, NewYork, Washington. Erlebnisse und Begegnungen, Frankfurt a.M. : Sendler Verlag 1982. - C’est du camp de Bassens qu’il est question quand Jacoby parle de "Domfront", qui est en fait une localité située, non pas "près de la ville de Bordeaux" (p. 82), mais en Normandie, dans le département de l’Orne, et où exista aussi, en 1939-1940, un camp d’internement pour étrangers.
[65] MEF, p. 48-57, 165, 225-227 et passim.
[66] Julijana Ranc : Alexandra Ramm-Pfemfert. Ein Gegenleben, Hamburg : Edition Nautilus 2003, p. 134-135. - Cf. Laharie : Le camp de Gurs, p. 143-150.
[67] Ibid., p. 147-167 ; MEF, p. 57.
[69] Tanja Frank : Aspekte deutscher Kunstkritik der dreißiger Jahre, in : Kunst und Kunstkritik der dreißiger Jahre, p. 63sq ; Gabriele Saure : "Nacht über Deutschland". Horst Strempel, Leben und Werk, Hamburg : Argument-Verlag 1992, p. 67sq.
[71] Saure : Nacht über Deutschland, p. 67sq.
[72] MEF, p. 35 ; Hans Jürgen Heinrichs, Max Raphael ; „Wenn ich Maler wäre“, in : Alfred Paffenholz (Hg.) : Spurensicherungen. Kunsttheoretische Nachforschungen über Max Raphael, Raoul Hausmann, Sergeij Eisenstein, Victor Schklowskij, Hamburg 1988, p. 26. - Cet auteur indique qu’après avoir été libéré du camp de Bassens, Raphael s’enfuit dans les Basses Pyrénées, trouva refuge dans une cabane vide, fut à nouveau arrêté en octobre avec sa femme et interné au camp de Gurs, "tout comme C. Einstein" !
[73] Otto Freundlich et ses amis. Hommage à Otto Freundlich, Musée de Pontoise, 1978, p. 147. - Cf. Ranc, p. 140.
[74] Kurt Kersten, "Aktion" in Kunst und Politik. Zu Franz Pfemferts 70. Geburtstag, in : Frankfurter Rundschau, 19.11.1949. - Cf. Ranc, p. 140.
[76] Jacoby, Davongekommen, p. 82-83.
[77] Voir l’étude d’Alain Ruiz citée supra note 61.
[79] Jacoby : Davongekommen, p. 83.
[80] Louis-Georges Planes & Robert Dufourg : Bordeaux capitale tragique et la base navale de Bordeaux-Le Verdon. Mai-juin 1940, Paris 1956, p. 130-132 ; Jean Chedaille : Bordeaux, capitale de la France, éd. CMD 1998, p. 65 ; Peter Krause : Bordeaux. Les bombardements, éd. CMD 1999.
[81] Jacoby : Davongekommen, p. 83-84.
[83] Cité in PEN, p. 128.
[85] Archives du Service Historique de l’Armée de Terre.
[87] Cité in PEN, p. 128.
[88] Jacoby : Davongekommen, p. 84-85.
[91] Cité in PEN, p. 128.
[92] Cité in PEN, p. 128.
[93] Ruiz : Mai-juin 1940, p. 233-235, 237-238.
[96] Ainsi, par exemple,
Anna Seghers, dont le roman
Transit, paru en 1943, évoque son séjour à Marseille en 1940.
[97] Cité in PEN, p. 128.
[98] Philippe Souleau : La ligne de démarcation en Gironde. Occupation, Résistance et société 1940-1944, Périgueux, éd. Fanlac 1998, p. 20
[99] Cité in PEN, p. 127.
[100] Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau, 1031 W 228 : dossier Carl Einstein.
[101] Cité in PEN, p. 128.
[102] Statistique établie par Pierre Groc, qui prépare une chronique de Mont-de-Marsan, de 1940 à 1944.
[103] Archives du Centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Je remercie très sincèrement M. Xavier Dumonlin, directeur adjoint de cet établissement, pour les renseignements d’ordre historique qu’il m’a donnés à son sujet et pour l’aide très précieuse qu’il m’a apportée dans l’exploration de ses archives.
[104] Cité in PEN, p. 128. - Il n’a pas été possible, malgré les recherches effectuées par M. Dumoulin, d’identifier le docteur Labarthe (?) qui aurait soigné Einstein, d’après ce que celui-ci raconta au Père Buzy (Ibid.).
[105] Francis Sallaberry : Aquitaine allemande. Bordeaux - Gironde - Landes - Pays basque. 1940-1945, Biarritz : J&D éditions 1995, p. 12-13 ; Dominique Lormier : Bordeaux pendant l’Occupation, Bordeaux : éd. Sud-Ouest 1992, p. 27-28.
[106] La Petite Gironde, dimanche 30 juin 1940. Une copie de cet article m’a été aimablement fournir par M. Pierre Groc.
[107] Cité in PEN, p. 127.
[108] Cf. supra note 103.
[109] Renseignement aimablement fourni par M. Dumoulin.
[110] Cité in PEN, p. 128.
[111] Le Béarn à l’heure de la guerre d’Espagne. Récits et témoignages
. Bulletin n° 10 de l’Association Mémoire Collective en Béarn, 1995.
[112] Alma Mahler-Werfel : Mein Leben, 36. Aufl., Frankfurt/M : Fischer TB 2000, p. 309-310.
[113] Laharie : Le camp de Gurs, p. 143-150.
[114] Jacoby : Davongekommen, p. 93-94.
[116] Cité in PEN, p. 127.
[117] Le Révérend Père Denis Buzy, in : L’Echo de Bétharram, n° 228, mai-juin 1965, p. 10-13 ; In Memoriam !, ibid., p. 13-21 ; Père Medebielle : Le T.R.P. Denis Buzy, S.C.J., 1883-1965, ibid., n° 230, sept.-oct. 1965, p. 7-10 ; Père Pierre Duvignau : Le Très Révérend Père Denis Buzy, ibid., p. 72-78, 96-106, 132-146, janvier-février 1966, p. 12-24, 48-58, 76-89
; Luce Laurand : Dans la lumière de Bétharram : le Père Denis Buzy, ibid., juillet-août 1969, p. 104-106 ; F.V.D. Nouvelles en famille, Lourdes, n° 149, 20 juin 1965, p. 82-103.
[118] Duvignau,
p. 53-54.
[119] Cité in PEN, p. 127.
[120] Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau, 1031 W 228 : dossier Carl Einstein.
[121] Cf. infra notes 135-136.
[122] C’est en mai 1928 qu’Einstein vint s’installer définitivement
à Paris (MEF, p. 231).
[123] Nina, la fille d’Einstein, avait épousé en juillet 1936 Jean Auproux, alors étudiant en architecture, qui était originaire de Nancy (MEF, p. 228).
[124] Cf. supra notes 4 -7.
[125] Cf. l’article de Liliane Meffre dans le présent recueil.
[126] Cf. infra notes 135-136.
[127] Les sœurs religieuses du collège de Bétharram venaient traditionnellement du couvent des Filles de la Croix établi au village tout proche d’Igon.
[128] Cité in PEN, p. 128-130.
[129] Lyda Guévrékian, la seconde épouse d’Einstein, n’était pas catholique (PEN, p. 131). Il est intéressant de noter ici que la fille d’Einstein, Nina Auproux, née de son premier mariage, devait se convertir au catholicisme (Renseignement aimablement donné par Liliane Meffre).
[130] Cette précision ne peut qu’inciter à se demander avec quelles affaires Einstein était arrivé à Bétharram et ce qu’elles sont devenues après son départ.
[131] L’Écho de Bétharram, n° 230, sept.-oct. 1965, p. 9.
[132] Ibid., n° 228, mai-juin 1965, p. 10.
[133] Cf. PEN, p. 130-133 ; MEF, p 303-304.
[136] Cf. supra note 121. - Pour quelle raison Einstein se présenta-t-il ainsi ? Pour susciter davantage d’intérêt de la part du Père Buzy ? Il n’est pas interdit de le penser.
[137] Werner Röder und Herbert A. Strauss : Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933, t. 2, München : K.G. Saur 1999, p. 245-248, ici p. 247-248.
[138] MEF, p. 303 ; Lexikon deutsch-jüdischer Schriftsteller, hg. v. Andreas B. Kilcher, Stuttgart/Weimar : Metzler 2000, p. 132 ; Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, t. 6, München : K.G. Saur 1998, p. 159.
[139] Lettre du Bundesarchiv - Militärarchiv (Berlin) du 21 décembre 2000 au consul général de la République fédérale d’Allemagne à Bordeaux, en réponse à une demande de renseignements formulée par M. Pierre Despré, président de l’Association Carl Einstein - François Mazou, à Boeil-Bezing.
[140] Cité in PEN, p. 129.
[141] Cf. infra note 147.
[142] Cf. infra note 154.
[143] La nouvelle ne devait paraître que le 9 juillet dans les deux journaux en question. - Cf. infra notes 149-151.
[144] Cf. infra note 147.
[146] Archives municipales de Boeil-Bezing, registres de l’état civil. Je remercie M. Pierre Despré de m’avoir aimablement communiqué une copie de cet acte, dont une reproduction est donnée dans MEF, p. 305.
[147] Cf. supra notes 141 et 144.
[149] Le Patriote, 9 juillet 1940, p. 2.
[150] C’est en fait le 7 juillet que fut découvert le cadavre d’Einstein. - Cf. supra note 146.
[151] L’Indépendant, 9 juillet 1940.
[152] Sans autre précision. Même erreur que dans "le Patriote". - Cf. supra notes 149-150.
[153] Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau, 1031 W 228 : dossier Carl Einstein.
[154] Cité in PEN, p. 129.
[155] Cf. supra note 153.
[156] Pau, le 10 juillet 1940. Le commissaire divisionnaire, chef de la 17
e Brigade régionale de Police mobile à Monsieur le préfet des Basses-Pyrénées, à Pau.
"Objet : Suicide du juif allemand Carl Einstein, née [sic] en 1885 ? [sic]. Photographie du cadavre.
J’ai l’honneur de vous adresser, ci-joint, le rapport établi par l’inspecteur Amalric, de mon service, relativement à la découverte d’un cadavre, le 8 juillet courant [!], dans le Gave, sur la commune de Boeil-Bezing (B.P.).
Tout d’abord cette mort avait paru suspecte et le Parquet de Pau s’était rendu sur les lieux. J’avais délégué deux collaborateurs.
Les recherches entreprises ont permis d’identifier la victime et d’établir qu’il s’agit du suicide d’un juif allemand s’étant dit : Einstein, Carl, né en 1885, homme de lettres et conférencier, neveu du savant du même nom. Il aurait été en relations avec les nommés Jacques Maritain et Marcel Schwob, de Paris.
Interné dans un camp de concentration dans les environs de Bordeaux et libéré lors de l’arrivée des Allemands dans la région, Einstein avait déjà tenté de se suicider, le 27 ou 28 juin dernier, dans un bois, près de Mont-de-Marsan, en essayant de se sectionner les veines des poignets avec un canif.
Ces détails, les blessures très caractéristiques portant encore les points de suture, la présentation de la photographie du cadavre ont permis l’identification par M. Buzy, Supérieur Général du collège de Bétharram (B.P.), qui avait donné asile à Einstein et reçu ses confidences.
Le commissaire divisionnaire"
Signé : illisible
[157] Comment expliquer cette absence de vêtements ? Ce seront sans doute, dans le lit du gave, les pierres sur lesquelles les eaux roulèrent le cadavre, qui les ont déchirés et arrachés du corps.
[158] Einstein s’était-il servi de la corde pour se suicider ou celle-ci, apportée sur les lieux après la découverte du cadavre, a-t-elle été utilisée pour le tirer du lit du gave sur la berge ? À noter que le journal "La Petite Gironde"rapporta que le cadavre avait été trouvé "avec une pierre attachée autour du cou". - Cf. infra note 173.
[159] D’où provenaient ces planches ?
[160] Cf. supra note 120.
- Que sont devenus ces papiers d’identité ? Une demande de renseignements adressée par M. Pierre Despré au Vatican, où sont conservées les archives de la Société du Sacré-Cœur de Jésus, n’a pas reçu de réponse.
[161] Cf. supra note 146. - Il convient de noter ici qu’il n’y apparemment pas eu d’autre examen médical que celui, pratiqué à Boeil-Bezing même, qu’indique le rapport de police précédemment signalé. En tout cas, le résultat négatif des recherches effectuées à Pau par M. Pierre Despré ne permet pas de confirmer qu’une autopsie en forme fut pratiquée, comme les mots du Père Buzy, dans sa lettre à Gabriel Guévrékian, pourraient donner à le penser : "Il [Einstein] aura été inhumé par les soins de la morgue, à Pau." (Cité dans PEN, p. 129). Il est clair, en tout cas, que le Père Buzy ignorait qu’Einstein avait été enterré à Boeil-Bezing.
[162] La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, 10 juillet 1940. À remarquer l’erreur de date ! Je remercie M. Pierre Groc (Mont-de-Marsan) pour la copie qu’il m’a aimablement fournie des articles de ce journal.
[163] L’Indépendant, 10 juillet 1940, p. 2.
[164] La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, 12 juillet 1940.
[165] Le Patriote, 11 juillet 1940.
[166] Inexact. C’est à Mont-de-Marsan, dans les Landes, et non "en Béarn", qu’Einstein fut hospitalisé et soigné après sa première tentative de suicide.
[167] Cité in PEN, p. 130.
[168] L’Indépendant, 12 juillet 1940.
[169] Inexact. Ce n’est pas à Mont-de-Marsan même qu’Einstein fit sa première tentative de suicide.
[170] La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, 13 juillet 1940.
[171] L’édition de Pau de "La Petite Gironde" n’est conservée dans aucune bibliothèque du département des Pyrénées-Atlantiques (Bibliothèque de la presse française politique et d’information générale des origines à 1944, t. 64, Bibliothèque nationale de France, 2002) et des autres départements du Sud-Ouest. Pas davantage à la Bibliothèque nationale, à celles de l’Assemblée nationale, de l’Institut et à la Mazarine. Elle ne figure pas non plus dans le Catalogue collectif des périodiques microfilmés, Centre national de coopération des bibliothèques publiques, Massy, 2
e éd.,1990, qui ne signale que l’édition de Bordeaux (p. 179).
[172] Laharie, Le camp de Gurs, p. 160.
[173] Koestler : La lie de la terre, p. 1139.
[174] Cf. supra notes 43-47, 49-51.
[175] Hertha Pauli : Der Riss der Zeit geht durch mein Herz. Erlebtes - Erzähltes, Frankfurt/M, Berlin : Ullstein 1990, p. 231-232.
[176] Varian Fry : Auslieferung auf Verlangen. Die Rettung deutscher Emigranten in Marseille 1940/41, München : Carl Hanser 1986, p. 45.
[177] Né à Brünn en 1882, Ernst Weiss, qui était médecin de formation, émigra en 1938 à Paris, où il se suicida le 14 juin 1940 dans la baignoire de sa chambre d’hôtel en prenant du poison et en s’ouvrant les veines.
[178] À l’été 1940, la nouvelle courut dans la presse internationale que la romancière Irmgard Keun s’était suicidée avec Walter Hasenclever (Cf. note suivante) au camp des Milles, près d’Aix-en-Provence, où elle n’a en fait jamais été internée. Cette fausse nouvelle permit à Irmgard Keun, qui avait émigré en 1935, de revenir en Allemagne où elle put passer tout le temps de la guerre grâce à de faux papiers.
[179] Interné au camp des Milles, près d’Aix-en-Provence, le célèbre dramaturge expressionniste Walter Hasenclever s’empoisonna dans la nuit du 21 juin 1940.
[180] Le fameux "magnat de la presse rouge" Willi Münzenberg s’est-il suicidé alors que, fuyant l’approche des troupes allemandes, il tentait de gagner la Suisse ? Il est plus vraisemblable qu’il a été assassiné, non par des agents nazis, comme on a pu le dire, mais par des agents de Staline.
[181] Ingrid Scheuermann : "Als Deutscher in Frankreich. Walter Benjamins Exil 1933-1940", in : Für Walter Benjamin. Hg. v. Ingrid u. Konrad Scheurmann. Eine Publikation des Arbeitskreises selbständiger Kultur-Institue e.V. - AsKI, Bonn, und des Suhrkamp Verlags, Frankfurt a.M., 1992, p. 75-113, ici p. 99-100.
[182] Cf. supra note 180.
[183] Cf. supra note 173.
[184] Koestler : La lie de la terre, p. 1139-1161.
[185] Koestler : Scum of the Earth, Londres 1941.
[186] Koestler : La lie de la terre, p. 966. - Cf. supra note 20.
[187] MEF, p. 104. - Clara Malraux garda des contacts avec la veuve d’Einstein et se brouilla finalement avec elle, encore pendant l’Occupation (Ibid., p. 10).
[188] Pierre Bertaux : Mémoires interrompus, p. 154.
[189] Clara Malraux : Voici que vient l’été, Paris : Grasset 1973, p. 62. - Cf. MEF, p. 304.
[190] MEF, p. 304 ; PEN, p. 133.
[191] Carola Giedon-Welcker : Poètes à l’écart. Anthologie der Abseitigen, Bern : Arche 1946, p. 141-142. - Cf. PEN, p. 131.
[192] Alain Bernard : Ces inconnus célèbres. L’autre Einstein noyé dans le gave de Pau, in : Sud-Ouest TV. Loisirs 28, 17novembre 1985. - Cf. l’interview de Pierre Fouchet, interrogé au bord du gave, à Boeil-Bezing, à l’endroit même où fut découvert le corps d’Einstein, dans le film "Einstein oder der Dilettant des Wunders", de Mechthild Rausch (Hessischer Rundfunk, 1885).
[193] Détails aimablement donnés par M. Pierre Despré.
[194] Bernard : L’autre Einstein noyé dans le gave de Pau. - Sur la constitution des archives Carl Einstein à Berlin-Ouest, cf. PEN, p. 18-25, et MEF, p. 10.
[195] Cité in PEN, p. 133-134. La référence "Basses-Pyrénées, 5 juillet 1966" ne nous a pas permis de retrouver la source.
[196] La vie de mon pays. En Béarn, Tarbes : Presses d’Occitanie 1978, p. 119-120.
[197] Photographie datant de la fin des années 1960 in : Sibylle Penkert : Verschollene und Vergessene. Carl Einstein. Existenz und Ästhetik, Wiesbaden : Franz Steiner Verlag 1970, p. 40-41.
[198] Photographie dans la plaquette Carl Einstein 1885-1940. Une présentation de sa vie par l’Association "Carl Einstein. Combattant de la liberté", Boeil-Bezing, 2
e éd., 2000, p. 6. - Il convient de noter que le cadre dans lequel se présente aujourd’hui le petit monument n’est plus du tout celui que montre la photographie signalée à la note précédente. L’arbre fourni qui se dressait à cet endroit a disparu. De plus, on voit aujourd’hui du même côté de l’allée, contre le mur du cimetière, des pierres tombales qui n’existaient pas encore dans les années 1960.
[201] Carl Einstein 1885-1940. Une présentation de sa vie par l’Association "Carl Einstein. Combattant de la liberté", p. 6.
[202] Bernard : L’autre Einstein noyé dans le gave de Pau.
[203] Sibylle Penkert : Carl Einstein. Beiträge zu einer Monographie, Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht 1969.
[204] MEF, p. 13-14, 325-326.
[206] Bernard, L’autre Einstein noyé dans le gave de Pau. La citation est de Liliane Meffre.
[207] Journal officiel de la République française, 8 mai 1996.
[208] Le Béarn à l’heure de la guerre d’Espagne. Récits et témoignages, Bulletin n° 10 de l’Association Mémoire Collective en Béarn, 1995, p. 213-216 : À Bœil-Bezing, en 1995 (Témoignage daté du 12 novembre 1995).
[209] Ainsi Mazou écrit (p. 214) : "En février 39, les franquistes s’emparent de la Catalogne. Einstein, après une période d’internement dans le camp d’Argelès-sur-Mer[ ?], est transféré au camp de Mérignac[ !]. Il s’évade et erre dans la forêt landaise afin de ne pas tomber aux mains des nazis. Près de Mont-de-Marsan [ !], le 29 juin, un boy-scout le prend en charge et le conduit chez les pères de Bétharram. [...] Toutefois, subite dépression, le 6 juillet, il se jette dans le gave de Pau, au pont de Lestelle-Bétharram [ ?]".
[210] Mazou, À Boeil-Bezing, en 1995, p. 216.
[211] En 1996, Lucie Pées, tante de Jean-Jacques Pées, a reçu de l’État d’Israël, à titre posthume, la médaille des Justes pour avoir, à Boeil-Bezing, aidé et sauvé des juifs pendant l’Occupation. - Cf. Sud-Ouest, 2 août 1996.
[212] Carl Einstein 1885-1940. Une présentation de sa vie par l’Association "Carl Einstein. Combattant de la liberté", p. 11.
[213] Pyrénées 1940. Ultime frontière pour Carl Einstein (1885-1940), Walter Benjamin (1892-1940), Wilhelm Friedmann (1884-1942). Exposition réalisée par la bibliothèque intercommunale Pau-Pyrénées et l’association Carl Einstein - François Mazou, combattants de la liberté, 2003.
[214] Éminent romaniste d’origine viennoise, professeur à l’université de Leipzig, Wilhelm Friedmann émigra dès 1933 à Paris où il donna des cours à la Sorbonne et à l’École pratique des hautes études. Momentanément interné en septembre 1939 au stade de Colombes, à Paris, comme Einstein et Benjamin qu’il peut avoir connus, il fuit la capitale avec sa femme et sa fille en juin 1940 vers Bordeaux et trouva refuge avec elles à Osse, en vallée d’Aspe. Arrêté en décembre 1942 par une patrouille de gardes-frontière allemands au sortir de la gare de Bedous, alors qu’il revenait d’un voyage à Pau, il se suicida pendant son interrogatoire en absorbant de la digitaline. - Cf. Claudine Delphis : Wilhelm Friedmann (1884-1942). Le destin d’un francophile, Leipzig : Universitätsverlag 1999, et l’article d’Alain Ruiz signalé supra note 22, ainsi que l’article du même et ceux de Stephen Steele et de Claudine Delphis dans : Grenzgänge. Beiträge zu einer modernen Germanistik, 12. Jahrgang, 2005, p. 4-83.
[216] Pyrénées 1940. Pour Carl Einstein, Walter Benjamin, Wilhelm Friedemann. Actes du colloque international du 14 avril 2003. Paris, L’Harmattan, 2006.
[217] Voir Manuel Cusso-Ferrer, Walter Benjamins letzte Grenze. Sequenzen einer Annäherung, in : Für Walter Benjamin. Herausgegeben von Ingrid und Konrad Scheuermann. Eine Publikation des Arbeitskreises selbständiger Kultur-Institute e.V. Frankfurt a.M. : Suhrkamp 1992, p. 158-157.