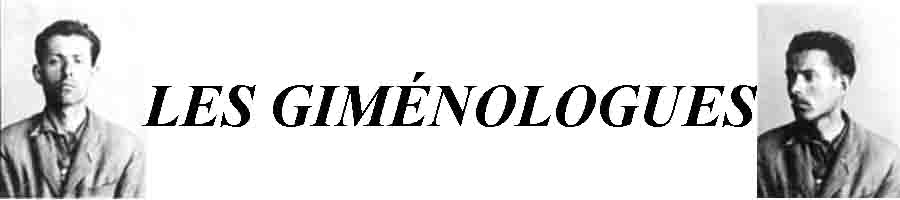DOCUMENT TRADUIT PAR l’équipe de ECHANGES ET MOUVEMENT
Les camarades du groupe Etcétera de Barcelone ont décidé d’arrêter la publication de leur revue. Le n° 59 et dernier est constitué du texte suivant retraçant cette aventure lancée en 1976 et du catalogue des publications, revue et livres
« Etcétera » (Barcelone) : 1976-2019, un itinéraire collectif
Comme nous l’indiquions dans notre précédente édition, les camarades du groupe Etcétera de Barcelone ont décidé d’arrêter la publication de leur revue. Le n° 59 et dernier est constitué du texte suivant retraçant cette aventure lancée en 1976 et du catalogue des publications, revue et livres
Nous vous remettons la livraison 59 qui correspond au dernier numéro de la publication périodique en papier Etcétera, correspondance de la guerre sociale, que nous avons débutée en 1983. Il est difficile de parler de ce qui se termine, des dernières choses, elles ne finissent jamais, elles commencent toujours.
Voir la géniale affirmation de Kracauer intitulant son dernier livre (inachevé à sa mort en 1966) L’Histoire des avant-dernières choses (1).
Nous poursuivrons cependant notre itinéraire en misant de nouveau pour une société sans capital et sans État, mais dorénavant sans le bulletin qui faisait état de nos discussions. Nous continuons sur la même page web [[https://sindominio.net/etcetera]->https://sindominio.net/etcetera] de critiquer la logique de ce monde, de parler de la nôtre ancrée dans le don, la gratuité, l’aide mutuelle…
Nous continuons aussi de faire connaître ces textes qui nous semblent importants pour comprendre la société dans laquelle nous habitons ou mieux dit « qui nous habite » en continuant la collection de livres que nous avons déjà édité. Voilà, voyons-nous et parlons-en après l’été.
Etcétera, juin 2019
Depuis les lointaines années 60 du siècle dernier, notre collectif a voulu être, et a été, un lieu de rencontre par où de nombreux compagnons de route sont passés. Certains nous ont laissé, d’autres ont suivi différents parcours bien que leurs empreintes soient restées présentes dans notre devenir et d’autres encore continuent dans cet espace à s’interroger et à dénoncer les structures de pouvoir capitaliste. À un moment donné, dans la seconde partie de 1983, on a envisagé d’élaborer ce bulletin pour disposer d’un instrument de communication avec des compagnons proches de nous ou d’autres horizons avec lesquels nous partagions et avec lesquels nous partageons les mêmes préoccupations concernant les relations de domination capitaliste, et ainsi commencer une « correspondance de la guerre sociale ».
Notre parcours a été long, notre réflexion a eu la volonté d’être rigoureuse et partagée sans avoir été exhaustive car, en effet, nous sommes conscients que certains thèmes importants sont restés à quai. Nos réflexions et interrogations, sans dépendre de l’actualité passagère, source de pertinence des média qui marquent l’agenda, ne pouvaient toutefois se soustraire aux « guerres » qui nous environnaient, certaines belliqueuses, et d’autres, sociales.
Aujourd’hui nous mettons une parenthèse, rien de définitif, car nous désirons suivre notre réflexion, nos critiques et notre communication avec tous ceux qui partagent nos questionnements et nos inquiétudes de lutte pour une relation sociale distincte de celle du Capital. Parenthèse concernant la publication périodique de papier du bulletin : il est difficile de maintenir fraîcheur et enthousiasme après tant d’années sans tomber dans la routine, les clichés qui donnent l’impression qu’ils servent pour tout. C’est pour cette raison, alors que le bulletin courait le danger de devenir pour nous une habitude, une obligation, que nous voulons « larguer les amarres » et chercher une nouvelle forme de faire. Le devenir de notre vie au jour le jour et la recherche permanente d’autres manières d’agir à la marge de cette société mercantile marqueront les jalons vers une autre manière d’être et d’exister dans l’instant.
De grands changements ont eu lieu depuis que nous avons commencé à nous rencontrer et nous avons vu comment nos vies, lors de périodes distinctes (le franquisme suivi du pacte de transition et de la « normalisation démocratique »), ont finalement débouché sur un ordre social opposé à nos désirs et intérêts ; sur un monde qui, vu globalement, nous semble tout aussi cruel que celui qui nous avait fait réagir alors (violence, exploitation, guerres, migrations, misères…) ; un monde qui pour l’essentiel continue d’être défini comme capitaliste du fait de son mode de production de valeur qui reste le même. Il faut donc continuer de dénoncer ce qui se passe, les causes du mal-être humain provoqué par les actions prédatrices du capital dans son effort à être le seul ordre à organiser monde. Il faut continuer à nous coordonner avec d’autres personnes, d’autres groupes afin de faire connaître les luttes de résistance qui ont lieu, tâche à laquelle nous nous sommes consacrés à travers notre correspondance de la guerre sociale.
Notes sur le parcours
Dans les premières années de notre trajectoire commençaient à s’infiltrer en Espagne les nouveaux courants venus d’Europe et d’Amérique du Nord. À Barcelone, du fait de sa proximité, ils venaient de France. Ils étaient chargés de critiques envers la politique et le modèle social et de désirs de liberté individuelle. À ce moment-là, pour la majorité de notre génération, le problème majeur était de nous débarrasser de la dictature franquiste qui continuait sa répression sur n’importe quelle revendication ouvrière ou civile en torturant ou tuant tout opposant.
Nous sommes des enfants grandis dans l’après-guerre. Autrement dit, nous sommes les produits d’une école et d’une ambiance sociale polarisées pour faire de nous des travailleurs dociles au service du système productif précaire du pays. On nous maintenait dans l’ignorance de l’anéantissement que la défaite de la classe ouvrière et des fractions progressistes représenta durant la guerre civile que nos parents avaient vécue. Tout était occulté par la pauvre et mauvaise éducation que dispensaient les collèges religieux ou « nationaux catholiques » et par la génération précédente rendue muette de peur par la répression de l’État et ainsi incapable de se révéler face aux injustices subies.
Toutefois, dans les années 1960, les luttes ouvrières et de protestation prirent de l’importance sur les différents fronts de la guerre sociale (centres de travail, enseignement universitaire, etc.) à un tel degré qu’elles ne pouvaient plus être occultées, ouvrant une brèche qui nous permis de respirer. Les grandes grèves (les mineurs dans les Asturies en 1962, les sidérurgistes en 1966, par exemple) et d’autres affrontements dans d’importants centres de travail commençaient déjà à promouvoir le développement d’organisations syndicales et de partis politiques impulsés par des groupes de militants clandestins.
Nous autres, participants du collectif, avons accumulé les expériences dans les luttes qui touchaient les centres de formation, ceux de travail ou les nouveaux quartiers ouvriers. Cette pratique nous mena jusqu’à une forme de lutte autonome d’assemblées, contraire aux structures verticales dirigées par des avant-gardes qui tentaient de s’imposer partout. La lutte des dockers et la revue La Estiba, modèle d’expression populaire, en sont un exemple. Critiques du syndicalisme et de la démocratie que nous voyions venir, nous promouvions une lutte anticapitaliste qui dépassait l’anti-franquisme. Ce positionnement idéologique, remettant en question radicalement le modèle social, était pour la rupture. C’était dans ces années illusoires où on pouvait encore penser à la possibilité d’un changement social radical.
Nous avons toujours évité d’être étiquetés (de marxistes ou d’anarchistes…) ce qui peut apparaître dans nos textes édités à l’époque. Nous nous sentions bien derrière la définition de « critiques du mode de vie capitaliste pour son dépassement dans un sens communiste et libertaire, pour une société sans Capital et sans État. Pour un monde sans argent ».
Nous collaborions à révéler ce que dissimulaient les mensonges diffusés par les « media » contrôlées, facilitant ainsi la mise au jour tant de la pensée critique occultée comme des textes élaborés à partir de la lutte sociale du moment sur les différents fronts dans les entreprises (les conflits étaient innombrables à la fin du franquisme), dans les institutions d’enseignement et de santé ; des luttes dénonçant la situation au sein des quartiers ouvriers récents avec une urbanisation restreinte, etc.
Entre 1976 et 1978 nous avons publié six numéros du bulletin Quienes no tienen derecho a la palabra la toman ya (Ceux qui n’ont pas droit à la parole la prenne maintenant), tirée à 10 000 exemplaires, dans lesquels nous traitions des différentes répressions dans la vie quotidienne (discrimination des femmes, des enfants, des gitans, des émigrés, des fous…) même si le contenu dénonçait principalement la situation des prisonniers dans les prisons franquistes et se faisait l’écho de la lutte menée par la Copel (Coordination des prisonniers en lutte). Nous avons de même participé aux comités de soutien à la Copel sans oublier de dénoncer le traitement réservé aux internés dans les institutions psychiatriques.
L’imbrication entre prison et société, la prison comme révélateur de la vérité de la société, était le point de confluence du collectif dans le bulletin dont ils étaient auteurs et éditeurs comme dans les discussions. À partir de la vie quotidienne dans la prison et en dehors d’elle se dévoilait le monde carcéral, la réalité derrière la loi et la justice, son caractère de classe et sa fausseté, montrant sa véritable utilité. Le caractère de classe du code pénal et de toute son institution apparaissait clairement et on ne critiquait pas seulement les injustices de la justice mais la justice elle-même. On en tirait les aspects carcéraux de la société : réglementation, surveillance et contrôle à l’école, à l’usine, dans la famille, en internement, etc. La critique de la prison et du système carcéral était radicale : nous étions pour l’abolition, pour la fin de toutes les prisons. Nous proclamions que la prison était la source du délit et elle-même le délit majeur en cherchant à comprendre le délit à partir de la société, autoritaire et hiérarchisée, capitaliste.
À mesure que passaient les années de la transition, nous étions poussés à faire la critique des différents pactes qui se succédaient pour camoufler les situations de conflit pendant que se produisaient la reconversion industrielle et la modernisation du Capital…Une période (transition vers la modernité et transaction démocratique, comme nous la définissions dans le n° 25 d’Etcétera) de réponse de l’État et du Capital à l’extension des luttes qui, du fait de leur caractère assembléiste et autonome, ne purent jouer un rôle jusqu’aux pactes imposés de la Moncloa de 1977, pas plus pour l’échec de la tentative de coup d’état en 1981 sur lequel nous avons sorti un tract la nuit même, titrant « Le coup a triomphé », ni pour l’arrivée au pouvoir du Parti socialiste.
Durant cette époque nous lisions et divulguions des textes d’auteurs qui nous aidèrent à connaître la pensée critique et à l’interpréter de manière différente de celle qui dominait dans notre entourage, mais aussi à observer les faits historiques d’un autre angle et ainsi à analyser notre monde par des analyses faites depuis une critique indépendante et non instrumentalisée.
En lisant Rubel nous apprîmes à lire Marx, le Marx critique du marxisme : « Si je suis sûr d’une chose c’est que je ne suis pas marxiste », confia-t-il à sa fille Laura. Le Marx critique du capital et de l’État : « L’existence de l’État et de l’esclavage sont inséparables » écrivait-il dans Vorwärts (2), idée qu’il reprit après la Commune de Paris. De Marx, nous avons compris ce qu’est le capital, cette relation sociale dont nous sommes constitués, ce mode de production de marchandises, de valeur d’échange et de production de valeur.
Avec Dézamy, Hess, Bremond, Feuerbach, Proudhon, Bakounine… nous avons pensé la révolution communiste. Stirner, avec L’Unique et sa propriété, nous a permis de discuter à partir de la subjectivité radicale, le déterminisme des conditions économiques et, dans la réplique adressée par Marx avec L’Idéologie allemande, nous vîmes ce qu’il y avait de faux à proposer de changer le monde en modifiant uniquement la conscience qui l’appréhende, cette vieille illusion qui veut que changer les conditions d’existence ne dépend que de la volonté des hommes.
Korsch, Mattick, Brendel, Gorter, Pannekoek, Rosa Luxembourg… nous firent connaître le parcours, pratique et théorique, d’un prolétariat qui s’organise pour lui-même. Connaissance qui nous permit d’entrer dans l’autre histoire du mouvement ouvrier. Mouvement qui débouche sur une expérience autonome et autogérée avec les Soviets en Russie en 1904 et 1917, les conseils dans l’Allemagne de 1919 et les collectivisations en Espagne en 1936.
Dans le Discours de La Boétie, nous avons compris la servitude volontaire ou, plus exactement, le conflit entre le désir de liberté et le désir de servitude.
Ciliga nous apprit la nature de l’URSS comme capitalisme d’État en dehors de sa mystification soutenue par l’« intelligentsia » européenne à qui il a fallu attendre l’entrée des tanks en Hongrie en 1956 pour délaisser ce mythe.
Nous nous sommes familiarisés à la Technique, au phénomène technique, en lisant Mumford, Ellul, Anders. Comme Marx a compris à la source le capital et la nouvelle relation sociale qui s’imposait, analyse qui reste certaine, celle de ces trois analystes de la Technique est aussi valide après plus de soixante-dix ans : la Technique est régie sur le principe de l’efficacité maximale ; c’est une conception du monde ; l’ouvrier devient un engrenage de la machine ; la Technique devient autonome. Ambivalence, tout dépend de son utilisation ou tout est inscrit dans son essence ?
Bien que prétendant à une analyse interdisciplinaire, nous donnions une préférence à la lecture économique que nous modérions par les textes de Nietzsche, Freud et ses déviants : le communiste Reich, le libertaire Gross et par les analyses sur d’autres sociétés sans État dans Sahlins et Clastres.
Plus récents, Vaneigem, Lefebvre, Foucault, Debord, Illich, Garcia Calvo, nous ont aidé dans cette connaissance de la société. Nous les avons lus avec un intérêt critique regroupant ce que nous considérions comme intéressant.
Nous prîmes le nom de Collectif Etcétera en 1976 dans l’intention de faire connaître une série de matériaux que nous considérions intéressant pour critiquer le mode de vie capitaliste. Ainsi nous avons édité des livres dans les collections :
« Critique de la politique » : Gloses critiques marginales pour l’article « Le roi de Prusse et la réforme sociale ». Par un prussien, de Karl Marx ; Un monde sans argent : le Communisme (1) et (2), texte de Les Amis de 4 millions de jeunes travailleurs ; L’Illusion démocratique, de Amadeo Bordiga ; L’État vu par Karl Marx, de Maximilien Rubel et Louis Janover ; Discours sur la servitude volontaire, de La Boétie ; Notes sur l’autonomie ouvrière, de différents auteurs ; La Communauté, de Raoul Bremond ; Le Code de la communauté (1) et (2) de Théodore Dézamy ;
– « Histoire Critique » : Fac-similé du journal « El amigo del pueblo » (l’ami du peuple) et divers tracts et textes des « Amigos de Durruti » ; de la revue Bilan : Textes sur la révolution espagnole, 1936-1938 ;
– « Critique de la vie quotidienne » : Sobre la delincuencia, que nous avons signé Colectivo Margen.
Comme nous l’avons déjà dit, en 1983 nous avons édité le numéro 0 de la revue Etcétera, correspondencia de la guerra social, en continuité d’une correspondance avec des amis et des collectifs (Échanges et mouvement, La Guerre sociale, Collegamenti, Fifth Estate, entre autres…) dont la finalité était d’échanger l’information sur les luttes et sur la pensée critique qui n’étaient pas diffusés par d’autres moyens. À cette époque de « normalisation démocratique », les médias arrêtèrent de se faire l’écho des conflits sociaux qui continuaient de se produire, principalement de ceux qui ne s’ajustaient pas au jeu de négociation des grands syndicats. Ainsi, sans laisser l’édition de livres et de bulletins, nous avons entrepris d’approfondir la connaissance de notre réalité sociale, des changements du mode de production capitaliste, et des luttes autonomes et anticapitalistes provoquant un échange d’information et de réflexion sur les avatars de la lutte de classe.
L’analyse de conjoncture des événements qui pouvaient principalement nous intéresser (Espagne des années 1980, changement politique et reconversion industriel, la Transition, Portugal, Angleterre, Tiananmen, Russie et les pays de l’Est, la crise et le Golfe, les Balkans, Algérie, Mexique), parallèlement à nos discussions sur les questions plus théoriques, nous ont aidé à la compréhension de la situation et à ses possibilités de dépassement (la technique, la culture, le syndicalisme, les médias, le fordisme, la critique du travail et de l’argent, l’immigration, l’urbanisme, la médecine, la religion, le genre, l’approche de l’histoire, la crise…). Des réflexions qui avaient pour objectif d’en savoir plus sur les processus révolutionnaires et contre-révolutionnaires sur lesquels on avait des informations et qui nous permettaient de critiquer : les idéologies comme credo de la pensée, la démocratie comme une forme de l’État dominateur, le nationalisme qui convertit la différence en mythe. Autrement dit, nous effectuions une critique de la politique.
Nous nous sommes intéressés spécialement aux changements produits dans l’organisation sociale : le système productif et le système d’exploitation (l’organisation du travail, la reconversion industrielle, le chômage, la précarité du travail), l’extension du marché capitaliste, la consommation, l’assistance, la vie dans les villes. Nous avons fait la critique de la culture et nous avons aussi abordé l’inégalité selon le genre, la médecine, la religion. Sur certaines de ces questions, nous avons organisé de larges rencontres avec d’autres amis, ainsi sur la critique de la politique, l’utopie, la technique, la critique du travail, la transition.
Tout cela a donné forme aux 58 numéros que nous avons publiés. Une tâche principalement ciblée sur la diffusion de nos réflexions, la révélation d’informations qui nous venaient de sources amies et cherchant à se faire l’écho de publications apparentées en privilégiant toujours le travail et la réflexion collective pour ensuite présenter des textes signés collectivement. Cette signature pour continuer d’éviter le leadership et les personnalismes. Une façon de faire qui nous a obligé à nous écouter pour comprendre et chercher le consensus devant les différents points de vue, et ainsi respecter les différents niveaux de compromis avec le groupe, dans l’inévitable et spontanée distribution des tâches inhérentes aux éditions artisanales. Un artisanat intentionnel pour éviter la faillite économique dont ont souffert tant de groupes. Cette activité s’est développée tout au long des années autour d’un groupe d’amis, bien loin du militantisme qui est de faire les choses pour les faire, de les faire au nom d’autres ou en représentant à d’autres. En bref, loin de faire de la politique mais avec un engagement qui impliquait une transformation sociale.
En parallèle, à partir de 1997, en plus de la revue nous avons cherché à faire connaître des textes peu ou pas du tout connus d’auteurs que nous avons considérés comme intéressant. En format livre, dans la collection « con.otros », nous avons édité : les Amis de Durruti, Stig Dagerman, Fredy Perlman, Guy Debord, Marta/Marcos, Wilhelm Reich, Augustin Souchy, Ricardo Mella, Émile Armand, A. Berkman, S. Petrichenko, Simone Weil, Lewis Mumford, Eric Mühsam, un texte contre la célébration des Olympiades à Barcelone et le texte « Carcel Modelo : 100 anos bastan » (La prison Modelo : 100 ans ça suffit).
Nous avons aussi impulsé la publication des livres : La Barcelona rebelde (la Barcelone rebelle), Guia de una Ciudad silenciada (Guide d’une ville mise sous silence) en 2003 et Dias rebeldes (jours de rébellions), Cronicas de insumision (Chroniques d’insoumission) en 2009, ces deux derniers élaborés avec des textes venant d’amis internes et externes du collectif.
Mais, sans aucun doute, ce qui est le plus appréciable dans cette tâche de divulgation, ce sont les 87 textes de la collection « Minima » que nous continuons d’éditer.
Les changements qui ont eu lieu
Les changements subis dans notre mode de vie et l’analyse que nous avons menée sur les transformations impulsées par le système capitaliste et par la technique ont aussi modifié irrémédiablement notre point de vue sur quelques questions. Cela peut se voir à travers les réflexions publiées tout au long des années. Beaucoup des certitudes sur lesquelles nous nous basions dans les années 1960 ont été fragilisées face aux évidences de certains faits historiques qui nous ont bousculé de façon inespérée (comme la fin du centralisme ouvrier, par exemple), donnant lieu à des interrogations et des doutes sur le présent et l’avenir. Des doutes dont nous nous sommes servis pour continuer à creuser afin de rompre avec la sécurité de la pensée fermée, avec ce qui était su : ce qui déconnecte des nouvelles formes de résistances et de lutte et des autres formes d’action. Des doutes qui servent à la pratique de la critique radicale et qui évitent le radicalisme.
Nous avons aussi adopté, néanmoins, quelques certitudes qui nous ont servies et qui nous servent encore. Par exemple, sur la guerre sociale (lutte de classes), thème vertébral de notre revue ; nous continuons de penser que le conflit d’intérêts s’exprime et continue de s’exprimer dans une guerre sociale permanente entre les tenants du pouvoir (le Capital) et les spoliés et exploités et que c’est entre les différentes classes que le Capital se recrée. Nous n’oublions pas que le capitalisme est un système qui promeut la constante et quotidienne séparation entre les personnes de classes différentes développant ainsi une société divisée qui ne peut lui faire front.
Nous parlons d’une guerre sociale qui devient visible face à une résistance qui prend des formes variées : grèves, sabotages, communautés en lutte pour la défense de leur environnement, occupations, mouvements urbains, la défense de la qualité de vie, etc. Des luttes qui freinent sans paralyser les plans d’expansion du capital et sa reproduction.
Le fait que dans nos sociétés les plus proches (occidentalisées) les travailleurs aient perdu le pouvoir qui leur donnait une place stratégique dans le cœur du système productif et que ce soit étendu le conformisme qui génère l’auto-emploi et les allocations ou encore que le travail de fonctionnaire ait augmenté exponentiellement dans les multiples départements de la bureaucratie d’État (centrale, d’autonomie, régionale, municipale, législative, syndicale, des partis et des fondations…), tout cela ne doit pas nous faire oublier que l’exploitation et l’expulsion s’étendent au niveau mondial et qu’en même temps sont apparus de nouveaux cycles de lutte dans les pays d’industrialisation récente tout comme de massives opérations de dépossession.
La guerre sociale, comprise comme lutte de classe, est inhérente au capitalisme alors qu’à l’heure actuelle la prédominance du modèle néolibéral fait penser que la résistance est impossible.
La politique s’est convertie en spectacle accessoire d’accompagnement au phénomène principal qu’est l’économie. L’économique a colonisé la majorité des sphères et des facettes de la vie sociale où chaque action se convertit en conduite mercantile ; c’est le temps de la corruption générale, de la vénalité universelle. Alors que nous avions cru que l’État avait tendance à s’étendre, nous avons pu contempler comment lors des dernières décennies du siècle passé et celles de celui-ci, les fonctions de l’État ont été chaque fois plus contrôlées et restreintes par les propres pouvoirs économiques et on assiste maintenant à ce qu’il est et a toujours été réellement : l’État du Capital. Cependant, et bien que les actuels hommes politiques aient la mission d’assurer son rétrécissement, l’État doit se maintenir à tout prix comme appendice au service du pouvoir économique. En effet, sa disparition signifierait la fin du Marché capitaliste. À observer l’État et sa fonction, nous ne pouvons pas oublier le fait que les militaires et leurs forces armées ont une significative prépondérance – l’armée et la guerre constituent une part très importante de la trame économico-politique – tant pour leur étroite relation avec les pouvoirs économiques que pour leur action dans les mécanismes de contrôle et de répression sociale, parties décisives du système capitaliste.
Quant à la nécessité actuelle de faire la critique de la politique, nous sommes convaincus en voyant le pouvoir croissant de propagande des médias qu’il est absolument obligatoire de continuer de démonter les mensonges qui soutiennent la structure du pouvoir de l’État du Capital. L’ordre capitaliste, comme toute forme de pouvoir, se maintient à travers sa rhétorique narrative de ce qui est le meilleur pour l’intérêt commun, que ce meilleur est inévitable et nécessaire. En dehors de lui, la barbarie règnerait. La principale tâche de la critique est donc d’insister sur le caractère historique de la société qui répond à un ordre politique conjoncturel qui n’est pas naturel. Ceci la rend modifiable selon la force qui la pousse, selon les intérêts qui la soutiennent. De cet ordre nous n’avons cependant jamais sous-estimé sa puissance ni sa force, et son utilisation en lieu et heure où cela lui convient et où il le considère comme nécessaire, sous forme de guerre, de répression et d’assassinat. Pour cela aussi, nous avons discuté la banalisation avec laquelle quelques auteurs et collectifs décrètent depuis des années la fin du capitalisme.
La critique de la politique que nous pensons nécessaire est celle qui dévoile les intérêts que cache l’activité des institutions politiques garantes de l’ordre capitaliste, et ainsi nous aide à faire ressortir des possibilités de résistance et d’affrontement et à libérer des espaces afin de développer un autre mode de vie libres de la tyrannie du capital. Un mode de vie qui, sans être utopique ni idéaliste, serait plus en accord avec nos désirs d’autonomie et satisferait mieux les besoins humains.
Toutefois, la lutte anticapitaliste a, elle, changé, de la même façon qu’a changé le concept de révolution. Chaque fois plus conscient de l’évidence que le pouvoir n’est pas dans l’État, l’anticapitalisme ne le désire plus. Il n’attend plus qu’un soulèvement généralisé contre le pouvoir lui permette d’imposer un nouvel ordre social non capitaliste. Il a constaté que les révolutions passées et leur prise rapide de l’État, n’ont pas été autre chose qu’un changement d’élites. Il n’y a donc pas à attendre l’événement révolutionnaire du futur. Le pouvoir nous traverse et pénètre la totalité des structures sociales. Il a été démontré qu’on ne pouvait pas changer l’essentiel de l’ordre social depuis l’État vu que ce dernier se conforme à la logique et aux intérêts du Capital. Pour cette raison, il n’est ni possible, ni désirable de prendre le pouvoir. Le pouvoir transforme celui qui s’en approche…Plus que de prendre le pouvoir il s’agit de ne pas être pris par lui. La signification du pouvoir qui nous intéresse, il est dans celui de créer et développer des espaces où dominent d’autres valeurs et d’autres manières de nouer des relations. C’est un pouvoir faire impulsé par d’autres logiques, un autre sens pratique plus à même de satisfaire les besoins humains.
Le nouvel anticapitaliste rejette l’idée du sujet révolutionnaire et accepte la diversité qui oblige à négocier les différences et privilégie l’organisation horizontale et en réseau. Il s’intéresse à toutes les résistances qui s’opposent au pouvoir dans le but d’obtenir la liberté de pouvoir faire, de créer et de s’organiser. Il y a mille formes de lutter contre le pouvoir dont chacun souffre : en luttant pour l’autonomie contre l’hétéronomie. La révolution se fait chaque jour, chaque fois que s’ouvre un espace où domine un mode distinct de relations sociales ; de relations horizontales sans structure politique. Ceci n’écarte pas la possibilité d’événements révolutionnaires à certains moments, d’émeutes et de rébellions inévitables contre l’oppression et l’abus de pouvoir concrets. Toutefois, ce n’est que quand la lutte crée des espaces d’autonomie que se crée une faille dans le système capitaliste.
Un monde s’achève, un autre commence
Comme nous l’avons vu tout au long d’Etcétéra, nous avons porté le plus grand intérêt à analyser cette société « nôtre » pour mieux la comprendre et mieux la combattre : régentée par la loi de l’accumulation du capital qui établit une corrélation fatale avec l’accumulation de la misère.
Nous comprenons cette société « comme (une) société capitaliste » : mode de production de marchandise dans laquelle ce qui importe n’est pas la valeur d’usage des objets produits mais sa valeur d’échange, la production de valeur. Ce mode de production crée des objets (choses) pour le sujet et des sujets pour l’objet. Société capitaliste qui convertit la force de vie en force de travail et établit entre les humains une relation sociale mercantile ; les relations qui s’établissent entre les personnes prennent la forme de relations sociales réifiées. Société qui a initié son parcours de l’usine jusqu’à aujourd’hui (fordisme ; société de consommation ; société d’assistance ; capital financier).
« Comme (une) société technique » : régie par le principe de l’efficacité maximale. L’efficacité comme unique critère de vérité. Il est certain qu’il n’y a pas de société sans technique mais actuellement la technique a cessé d’être un moyen pour devenir une fin, l’homme devenant un instrument de la technique au service de ce qu’il a lui-même créé. La technique est ambivalente, nous ne pouvons séparer ses aspects néfastes de ses aspects positifs.
« Comme (une) société médiatique » : l’image souveraine. Seul est réel ce qui sort sur l’écran. L’écran n’apparaît pas comme un reflet de la réalité, c’est la réalité qui apparaît comme un reflet des écrans qui moulent la réalité à leur guise et lui donne leur « vérité ». Société basée chaque fois plus dans la production de signes, d’images. Le support est le message. L’information se réduit à de la propagande. Elle possède aussi un autre visage : l’accumulation de données sur nous tous (Big Data). Des données qui facilite une information stratégique pour les affaires du capital. Une information que nous facilitons nous-mêmes, chaque fois plus forcés à utiliser la « Toile », ce qui nous convertit à des intérêts et des comportements dirigés et conditionnés.
« Comme (une) société occidentale » : avec ses propres catégories, société ancrée dans le temps présent (shizophrénie, A = A, sans passé ni futur, sans mémoire ni rien à suivre). Un présent tautologique, espace sans temps (Joseph Gabel). Sans ouverture à l’avenir, ce qui est à suivre doit modifier le présent en notre faveur. Pour nous, l’avenir n’est pas une utopie, toujours inatteignable, hors du monde et du temps, c’est plutôt comme ce qui ne serait pas encore présent mais qui est présent sous la forme d’absence.
« Et bien entendu, comme (une) société patriarcale » : cette caractéristique recouvre et vient en soutien du monde que nous connaissons. Le monde de la domination et de l’exploitation des forts sur les faibles ; de l’homme sur la femme et leurs enfants en l’occurrence. Une domination qui a occulté et occulte toujours les travaux de la femme dans ses tâches fondamentales pour le soutien à la vie et qui bénéficie au système capitaliste par deux aspects : en libérant l’homme des charges familiales afin de mieux le soumettre aux longues journées de travail, et aussi en utilisant la femme comme travailleuse sous-payée pour les activités économiques réalisées en dehors du foyer. Cette structure est basée sur la différence, renforcée au long de l’histoire par les récits des idéologues chargés de justifier cette inégalité. Ces idéologues liés aux doctrines religieuses si utiles pour le contrôle social de toute la population. Des religions qui ne disparaissent pas malgré les changements de mode de vie qui se développent à travers le monde.
Cette société techno-capitaliste, aujourd’hui hégémonique, est traversée par la contradiction qui est d’avoir un développement illimité (grâce à la technique) dans un monde fini ; traversée aussi par une limite interne, l’économique, qui se manifeste par la difficulté de reproduction du Capital due à la tendance de baisse du taux de profit qu’il est impossible de valoriser sans la force de travail, et une limite externe, l’écologique, dont l’origine est la dégradation de la planète (réchauffement, contamination, disparition d’espèces…). Société régie par la loi du profit et de l’efficacité maximum, elle tend à remplir tout l’espace et à tout convertir en marchandise.
Cette tendance à tout convertir en marchandise est impossible à atteindre : il restera toujours une valeur d’usage pour soutenir la valeur d’échange, il restera toujours des activités humaines, malgré le travail salarié et en lui-même. La relation sociale capitaliste est aujourd’hui hégémonique mais pas totale ; il existe un « en dehors » de cette relation sociale, des relations non mercantiles existent en dehors des relations mercantiles, des relations humaines restent au-delà des relations réifiées. Si cet en-dehors n’existait pas, si tout était conforme à la relation sociale capitaliste, si l’aliénation était totale, il n’y aurait pas d’espaces de révoltes ni de réformes, tout serait récupérable par le capital.
Si la relation sociale capitaliste occupait tout l’espace, nous serions dans l’obligation d’attendre sa chute pour pouvoir développer d’autres relations sociales non capitalistes. N’importe quel changement serait suspendu à la fin du capitalisme. Et cette fin serait mesurée à la nécessité historique d’attendre les conditions objectives de maturité. Le « Ya basta » (« maintenant ça suffit ») serait impossible, il ne pourrait intervenir comme événement impromptu dans l’histoire.
Un déterminisme déjà critiqué par Marx après qu’il eut étudié les relations de propriété en Russie. Dans sa correspondance avec Véra Zassoulitch sur les formes archaïques de la propriété, Marx avait refusé l’accusation qui lui était faite de présupposer une fin fatale au capitalisme en affirmant que la commune rurale russe pourrait se convertir en un point de soutien de la révolution sociale en Russie et ceci sans nécessité de passer par le capitalisme (3).
La contradiction qui traverse la société capitaliste lui impose donc une limite qu’il est plus difficile de voir dans la société technique. Si, comme l’affirme, Dennis Gabor : « Tout ce qui peut se faire, se fera » définit la technique, ce à quoi Anders ajouta : « Tout ce que nous sommes capables de produire, nous devons le produire » et si, à la différence des utopistes qui pouvaient imaginer plus que ce qu’ils pouvaient faire, au contraire de nous qui pouvons faire plus que nous imaginons, il est alors difficile de voir la limite au progrès technique. La société techno-capitaliste pourrait donc cesser d’être capitaliste tout en continuant à être technique.
À partir de la crise de 2007, les écrits sur la fin du capitalisme ont proliféré et ceci sans définir ce qui était entendu par « capitalisme ». Quelques critiques suffisaient sur la corruption que ce système facilite, sur l’injustice qui se généralise… pour proclamer la nécessité de sortir du capitalisme. De cette façon, on réduit le capitalisme à un système injuste et corrompu. On fait référence alors à un capitalisme moins dévastateur, à un capitalisme plus humain. C’est ainsi qu’on banalise ce mode de production de marchandises en le réduisant à une forme extrême de corruption et de malversation sans montrer que le capitalisme est une relation sociale, que ce qui se produit, ce ne sont pas des objets mais bien des marchandises. Autrement dit, ce type d’analyse prétendait sortir du capitalisme tout en y restant.
Rébellion se confondait avec révolution (anticapitaliste) mais tout en étant certain qu’oppression va avec rébellion, une révolution qui établit d’autres relations sociales est tout autre chose. Nous parlons d’une révolution qui génère des sociétés sans État et sans production de marchandises où la solidarité, l’aide mutuelle, la gratuité s’imposent à la concurrence, à l’efficacité et au profit.
Il est toujours possible de contempler la fin du capitalisme, plus insensé serait de penser qu’il va continuer éternellement. Mais alors, comment ? Quand, dans quelle circonstance ? Beaucoup a été théorisé par le milieu anticapitaliste : effondrement, autodestruction… Dans cette théorie, il y a celle qui persiste à associer la fin du capitalisme à la contradiction même du capital : une fois atteint un niveau de développement historique, il s’autodétruit (sujet historique, nécessité historique).
Il existe une autre façon de considérer la fin du capitalisme, qui est de l’opposer dès maintenant à d’autres formes de société, à d’autres relations sociales qui questionnent la relation sociale capitaliste aujourd’hui hégémonique. Le changement révolutionnaire vient alors des différents modes de production et d’échange qui se construisent contre lui (comme exemple les différentes unités zapatistes ou encore l’actuelle réalité du Rojava) en érigeant d’autres relations sociales d’échanges non mercantiles : des espaces libérés.
Nous parlons d’espaces libérés parce qu’il y a un extérieur au capitalisme. Parler d’espaces libérés c’est aussi parler de violence. Les maîtres de ces espaces ne vont pas se laisser faire. Ces espaces libérés doivent être défendus, ce qui en fait des espaces de combat.
Nous vivons la vie dans une situation d’extrême violence : la lutte pour le travail et ce travail même une fois obtenu, l’atmosphère dans laquelle nous vivons nous tue littéralement – air, aliments, radiations, déforestations. Ce sont les États modernes qui ont opté ou qui ont cédé pour ce modèle de civilisation développée. Par ailleurs la multitude de « petites guerres » – aucune guerre n’est petite de même qu’aucune mort – tissent un holocauste qui à travers la durée et parfois du fait de sa moindre intensité paraît éloigné d’une grande guerre. Les énormes masses de migrants qui se déplacent sont parquées et emmenées à un éternel désert dans lequel la mort les accompagne ; nous sommes tous entourés d’armes létales, petites et grandes et ce qui se fait aujourd’hui en Libye, en Syrie, au Kurdistan ou en Palestine, pourrait se faire demain sur nous. Quand toutes les réponses « démocratiques » ont été dépréciées et que l’inutilité de tout geste pacifiste a été constatée, surgit l’affirmation de Günther Anders qui impose la légitime défense. Devant l’extrême violence qui est en train d’en finir ou qui est en mesure de le faire : à quoi pourrait servir un appel à la violence ?
Tout autant, pour en revenir à Anders, nous devons prendre en compte l’observation qu’il ne suffit pas de transformer le monde, c’est ce que fait le capitalisme bien malgré nous, il faut encore interpréter cette transformation, précisément pour que le monde ne continue pas à changer sans et contre nous et qu’il ne se transforme pas finalement en un monde sans nous.
Quand nous parlons de révolution anticapitaliste, nous parlons d’une révolution qui ouvre la porte à des sociétés sans capital et sans État, des sociétés hors la tyrannie mercantile et étatique.
Sans capital : un autre mode de production (non mercantile, en dehors de la valeur) et de distribution (de chacun selon ses possibilités, à chacun selon ses besoins). Une nouvelle forme sociale en faveur de la satisfaction de nos besoins. Les produits cessent d’être des marchandises pour devenir des biens sociaux.
Sans État : d’autres formes d’être ensemble, d’assurer le lien social. Nous comprenons l’État comme la fiction d’un espace séparé de la vie réelle où nous serions tous égaux, sans différences de classes, en maintenant la relation sociale que le capital génère et fait de nous des citoyens hétéronome… La nouvelle forme sociale remplace l’État par une organisation antiétatique, non hiérarchique, antiautoritaire, non représentative, autonome (on pourrait se référer au rôle des clubs lors de la révolution de 1848, au rôle des sections pendant la révolution en France en 1792, au rôle des conseils ouvriers en Allemagne en 1919 et à celui des collectivités en Espagne en 1936…).
Un monde s’achève, un autre commence, la société cesse d’être capitaliste. Qu’elle cesse d’être capitaliste ne veut pas dire qu’elle soit communiste, une autre tyrannie pourrait s’imposer. Ce qui nous pousse à miser pour une société sans argent (tant qu’il y a de l’argent cela ne sera que des miettes), vient de la question de l’accumulation d’un petit nombre qui appauvrissent la majorité, sans maître par une organisation partant de la base à partir d’assemblée décisionnelle qui garantit la participation de tous et fait avorter la tyrannie du vote de parti ; sans État où s’expérimentent d’autres formes possibles d’organisation sociale ; sans capital, sans le fétichisme des marchandises où d’autres formes plus humaines d’activités pour le développement individuel et collectif dépassent le travail salarié comme unique forme de droit à la vie. Des sociétés avec un langage propre : aide mutuelle, don, gratuité amitié, solidarité. Des sociétés que nous ne considérons pas utopiques, déplacées, mais « eutopiques », à leur place, et celles vers lesquelles nous nous rapprochons non comme des illusions ou comme espoir mais bien comme un pari justifié.
Justifié par l’échec de ce mode de production et de vie capitaliste traversé par la crise, interne et externe, qui met en crise la Nature et nous-mêmes ; un mode de production de valeur basé sur le travail salarié et qui, dans les pays les plus « développés », ne peut donner du travail à ses travailleurs : justification suffisante. Justifié encore par l’expérience et l’observation faite des nouvelles formes sociales d’activité et d’échange. Justifié toujours par la vie que nous connaissons au-delà de ce nous voyons sur les écrans : résistances, rébellions… de gens normaux plus enclins à la rébellion qu’à la soumission, plus rapides au refus spontané de l’injustice et de n’importe quelle forme de pouvoir.
Etcétera, juin 2019
(traduit de l’espagnol par J.-L. G.)
Correspondance : Etcétera Cera, 1 bis. 08001 Barcelona
etcetera@sindominio.net
www.sindominio.net/etcetera
NOTES
(1) Stock, 2006. Siegfried Kracauer (1889-1966) : journaliste, sociologue, critique de films. . Ami de W. Benjamin et T. Adorno. Etcétera a publié, de Lewis Mumford et S. Kracauer : La Fotografía. (Note d’Échanges.)
(2) Vorwärts, journal du Parti social-démocrate des travailleurs d’Allemagne, de 1876 à 1933. (Note d’Échanges.)
(3) Voir La Question agraire dans la révolution russe, de Loren Goldner, Échanges et mouvement, 2018, pp.8 à 10. (Note d’Échanges.)
http://www.echangesetmouvement.fr/2020/02/etcetera-barcelone-1976-2019-un-itineraire-collectif/